23 février 1455. La révolution Gutenberg
Crépitement des dernières flammèches. Elévation vers le ciel. Ce 3 août 1456, au centre de la place Maubert, à Paris, le bûcher finit de se consumer. Braises et cendre. Mélange d’odeur d’encre et de chair brûlée. D’Etienne Dolet, ne reste plus rien que quelques ossements calcinés. Pas plus de ses ouvrages impies dont le caractère satirique lui a valu sa condamnation à mort par les théologiens de la Sorbonne. Et pour faire pendant à leur décision, le peuple est venu donner son assentiment. Sa mort n’en est que plus cruelle face à leur ignorance : « Non dolet ipse Dolet, sed pia turba dolet » s’est-il écrié à l’instant même où les flammes ont commencé à lécher son corps. (« Ce n’est pas Dolet lui-même qui s’afflige mais la multitude vertueuse »)
Etienne Dolet, victime de l’obscurantisme de la part de ceux qui refusent un plus grand accès au savoir, à la connaissance et, inévitablement, à la liberté de pensée. Différemment. Pourtant, en ce XVe siècle pas encore sorti du Moyen Age, une révolution est en marche. La révolution Gutenberg ! La révolution du livre !
Plus il s’en est approché et plus Johannes Gutenberg a admiré l’élégance de son élévation. Et durant toutes ces années où il a vécu à Strasbourg, lui l’exilé de Mayence arrivé avec toute sa famille dans les années 1420 n’a cessé d’admirer sa cathédrale. Pas un jour où l’orfèvre qu’il est entre-temps devenu n’a pas porté son regard sur la finesse de sa flèche culminant à 142 mètres. La plus haute de la chrétienté. Et qui sait si ce quotidien renouvelé ne lui a pas donné des idées de grandeur. De s’élever au-dessus des hommes. De chercher sa pierre philosophale. Son Graal. L’éternité de son nom.
Orfèvre. Un métier en or. Du moins reconnu. L’orfèvre qui enchâsse les pierres dans l’or. Johannes Gutenberg fait partie de cette corporation qui s’adonne au travail du métal. Graver, ciseler, poinçonner, il sait faire. Maîtriser les alliages également au fil de la vingtaine d’années qu’il passe au bord du Rhin. Il a compris aussi que le temps des moines copistes dans les monastères et des ateliers d’écriture civils est révolu. Malgré une organisation méthodique de la séparation des tâches, les uns et les autres ne peuvent plus répondre à la demande. La fin du Moyen Age a soif de lecture et de livres. Certes, n’est encore qu’une minorité, ce monde des lettrés qui annonce la Renaissance. Suffisamment pourtant pour s’intéresser à de nouvelles techniques permettant une production plus importante et plus rapide d’ouvrages. Car, ne faut-il pas en moyenne deux à trois ans pour écrire ou copier un manuscrit.
Johannes Gutenberg s’est donc attelé à cette tâche. Dans le plus grand secret. Car la concurrence est rude. L’homme, qui plus est, détient, semble-t-il, un sale caractère. Dit-on au regard de quelques documents de justice retrouvés dans les archives. Procédurier ? Plutôt méfiant. A vrai dire, peu d’éléments transpirent de sa vie et bien souvent, avec Gutenberg, l’historien est confronté à la problématique du vide, entre ombre et clarté. A vouloir prouver ce qui n’est qu’incertitude.
Sans doute, alors que les grands voyageurs n’ont pas encore pris la mer, Gutenberg ne sait rien des procédés déjà utilisés depuis plusieurs siècles hors de l’Europe. En Chine, dès le IXe siècle, sont utilisés des caractères inversés et en relief que l’on encre avant de presser soie ou papier. Ainsi du « Sutra du diamant », ce rouleau de 5 m de long composé de sept feuillets de papier. Pas un livre toutefois. Alors, glissons vers la Corée où certains affirment que le « Jikji » serait le premier livre imprimé au Monde en caractères mobiles. Un traité bouddhique de 38 pages en papier fin de mûrier, réalisé par le moine Seon Baegun, surnommé Jikji, tiré en deux volumes dont un exemplaire est précieusement conservé à la Bibliothèque nationale de Paris. Reconnaissons à cette création, sa primauté. Qui ne remet nullement en cause le travail de Gutenberg. Car l’orfèvre n’est pas homme à se contenter de publier un ou deux exemplaires. C’est de la production en masse qu’il veut. Et si possible qui lui rapporte quelques monnaies sonnantes et trébuchantes. Faut-il trouver aussi le moyen d’y parvenir. Le génie est une chose. L’argent y contribue.
Gutenberg a déjà commencé à chercher à Strasbourg l’innovation technique qui lui permettrait d’imprimer en grand nombre des ouvrages. Mais c’est pourtant chez lui, à Mayence, qu’il va développer l’invention dont l’Histoire lui accorde la reconnaissance. Il n’a eu qu’à suivre le Rhin pour y retourner et apercevoir le clocher de la cathédrale, certes plus modeste en hauteur (83 m) que la flèche de Strasbourg. Nous sommes en 1448.
Johan Fuchs est commerçant. Banquier aussi. C’est-à-dire prêteur mais aussi retors. C’est lui qui va financer le travail déjà accompli de Gutenberg. Financer le matériel. Les ouvriers au nombre d’une quinzaine. Un homme d’affaires plus qu’un mécène. L’entreprise doit devenir rapidement rentable. Une double exigence : la qualité de la réalisation et son coût bas. Deux ingrédients de la réussite. Assurer la diffusion aussi.
De 1448 à 1454, Gutenberg cherche et améliore la technique de l’impression mécanique avec l’aide d’un ouvrier, Petrus Schöffer, futur gendre de Fuchs : des caractères métalliques, de même taille et de même épaisseur, parfaitement agencés pour former une page placée ensuite sur une presse à vis. Enfin, l’impression papier peut commencer. Trois ouvrages paraissent en 1454 dans l’atelier de Fuchs-Gutenberg : « Le Livre de la Sybille » ; un ouvrage de grammaire latine le « Donat » et « Le Calendrier Turc ».
Le 23 février 1455 paraît la B42. Un nom aussi laid pour une si belle réalisation ! L’œuvre de référence. Celle qui marque la date de l’invention de l’imprimerie. Une Bible au format in-folio de 324 et 319 feuillets, reproduisant le texte en latin traduit par saint Jérôme. 40 lignes par pages dès les premières pages. Puis 42 lignes par page dans les suivantes. Economie de papier exigée. Fuchs n’est jamais très loin. 2 colonnes en textura. 6 ouvriers à plein temps. 294 encres employées. 290 caractères différents. 180 exemplaires pour commencer. Succès immédiat par souscription.
Quelques années plus tôt, vers 1430, à Haarlem (Pays-Bas), un sacristain nommé Laurens Coster a publié deux éditions du « Donat » et du « Speculum humanae Salvationis » à partir de caractères mobiles et en bois naturel. D’où l’incitation de quelques historiens à lui attribuer la paternité de l’invention de l’imprimerie. Il se dit même que le frère aîné de Gutenberg, Jean Geinsflesh, se serait fait embaucher dans l’atelier avant de se carapater en emportant le matériel de l’imprimerie. Direction Mayence où il aurait remis son précieux butin à son frère. Croire ou ne pas croire ? Reconnaissons à Gutenberg si ce n’est l’invention des caractères métalliques du moins la production de masse des ouvrages, ouvrant une nouvelle ère. De la même manière que Christophe Colomb n’a pas découvert en premier l’Amérique mais qu’il a contribué à faire exister le Nouveau Monde dans l’esprit de ses contemporains.
Le succès est-il monté à la tête des deux associés ? On peut le penser car les relations vont rapidement s’envenimer entre les deux hommes, Fuchs exigeant le remboursement du prêt de 2500 florins. Au point d’entrer en conflit et de se retrouver devant le tribunal de Mayence qui se prononce en faveur de Fuchs. Entré en disgrâce, sans aucun doute aigri par cette décision, peu aguerri aux affaires, Gutenberg tente de se relancer sans grand succès économique, à Mayence puis à Bamberg. Il meurt en 1468 après avoir obtenu une rente de l’archevêque de Mayence. Sans savoir que l’Histoire allait lui rendre ce dont on l’avait privé de son vivant : la reconnaissance.
Le développement de l’imprimerie et la production d’ouvrages vont inonder l’Europe de la Renaissance. Un succès qui ne s’est jamais démenti, au fil des siècles et des progrès technologiques. Il se publie aujourd’hui en France plus de 70 000 ouvrages par an. A travers le Monde, les ventes annuelles s’élèvent à 450,6 millions d’exemplaires. Une nouvelle révolution est née avec le livre numérique qui ne représente encore que 2,5 % des achats en France. De quoi rendre inquiets et grognons les libraires de France et de Navarre. Comme ont pu l’être sûrement les moines copistes à l’époque de Gutenberg qui écrivit : « Dieu souffre dans des multitudes d’âmes auxquelles sa parole sacrée ne peut pas descendre ; la vérité religieuse est captive dans un petit nombre de livres manuscrits qui garde le trésor commun, au lieu de le répandre. Brisons le sceau qui scelle les choses saintes, donnons des ailes à la vérité, et qu’au moyen de la parole, non plus écrite à grand frais par la main qui se lasse, mais multipliée comme l’air par une machine infatigable, elle aille chercher toute âme venant en ce monde ! »
En 1987, la vente d’une des Bibles imprimées par Gutenberg – il en reste 48 exemplaires conservés dont 5 en France – s’est élevé à 5,39 millions de dollars.
Etienne Dolet n’est pas mort pour rien !
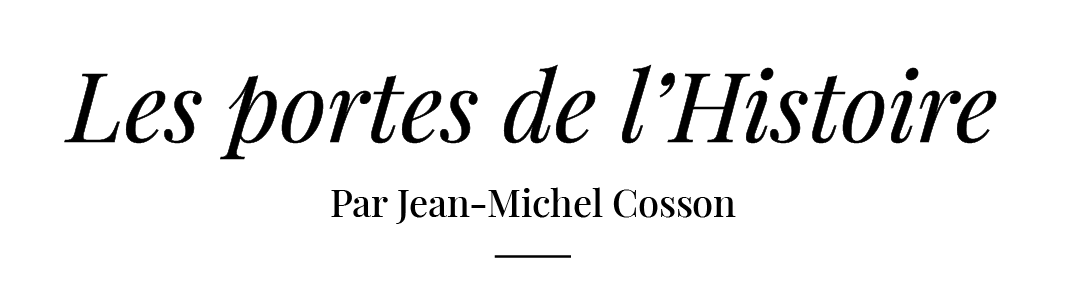
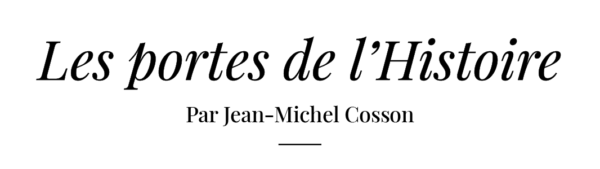
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !