6 avril 1896. Athènes retrouve les Jeux Olympiques
Il ne sait plus, Spyridon Louis, du trophée – une coupe sur pied en argent finement ciselée – qui scelle sa victoire dans le marathon ou du cadeau que vient de lui faire le constructeur du stade panathénaïque, Georges Averof, en l’occurrence la main de sa fille, lequel il doit le plus se réjouir.
Quelques minutes plus tôt, dans un stade surchauffé, bondé de messieurs en haut de forme et de dames protégeant d’ombrelles leurs jolis minois, l’athlète de 23 ans, porteur d’eau de son état, dans un ultime effort, s’est effondré devant la tribune officielle, face au prince héritier Constantin et au prince Georges, qui l’ont accompagné dans le dernier tour de stade. Deux soldats en habit d’apparat, épaulettes flamboyantes et plumeaux sur le képi, ont dû le relever. Le vainqueur du marathon, en 2 heures 58 minutes et 50 secondes vient d’entrer dans la légende, dans la foulée du héros Phéidippides accouru à Athènes pour annoncer, en 490 avant J.-C., la victoire des Grecs sur les Perses. Un succès inattendu mais ô combien primordial pour un peuple grec alors orphelin de tout succès dans les épreuves d’athlétisme de ces premiers Jeux de l’ère moderne.
Quelques jours plus tôt, Spyridon Louis n’a pourtant terminé que cinquième d’une course d’essai préalablement courue, avant d’être repêché par son ancien commandant de régiment. Car l’homme possède une sacrée endurance ainsi qu’une belle pointe de vitesse. Le jour J, après un départ relativement prudent, il a remonté un par un ses adversaires avant de dépasser l’Australien Edwin Flack à quatre kilomètres de la ligne d’arrivée. Cent mille spectateurs l’acclament à son entrée en scandant : « Hellène, Hellène ! » (« Grèce, Grèce !») L’honneur était sauf !
Quinze siècles se sont écoulés depuis que la flamme olympique s’est éteinte. En cette année 393 après J.-C., l’empereur Théodore Ier, converti au christianisme, scelle le sort des Jeux antiques grecs pour cause de rites païens. Mettant fin, de fait, à la 293ème olympiade dont la naissance remontait à l’an 776 avant J.-C., à Olympie, sanctuaire religieux voué au culte de Zeus. Un lieu dans lequel, bien plus tard, des équipes archéologiques successives mettront à jour thermes, temples et un stade dédié aux épreuves sportives.
L’idée d’une renaissance des Jeux n’incombe pas, comme on l’entend souvent, à Pierre de Frédy, baron de Coubertin. En effet, un siècle plus tôt, les révolutionnaires français évoquent à plusieurs reprises le rétablissement des Jeux. Un député de la Convention, en 1792, l’aborde même à la tribune : « Les Jeux publics que vous instituerez, sans doute au jour intercalaire qui la termine, la rapprocheront de l’Olympiade des Grecs ; nous vous proposons de l’appeler l’Olympiade français et la dernière année l’Olympique… » Sous le Directoire, un parisien, membre du Musée de Paris, Esprit-Paul De Lafont-Poulotti, propose « à partir de ses recherches laborieuses sur l’organisation des célèbres Jeux Olympiques, d’en donner la forme, le mode et toute l’ordonnance ». Le 22 septembre 1796, l’Olympiade de la République s’ouvre, mettant en scène « des courses, des exercices pleins de mouvement et de magnificence », écrit Le Moniteur avant de conclure : « On peut dire que cet heureux essai des fêtes de la Grèce promet pour les années qui suivent… » Elles se dérouleront les deux années suivantes. Puis la municipalité parisienne apportera une fin de non-recevoir au rétablissement des Jeux Olympiques.
D’autres tentatives se déroulent en 1834 avec les Jeux scandinaves ; en 1859 et 1870, en Grèce, sous l’égide du mécène Evangelis Zappas. Un double échec tout comme les Jeux de Munch Wenlock en 1869, laissant la porte ouverte au fameux baron et à son sens de l’organisation. Lui-même écrira : « Il est d’ordinaire assez difficile de savoir pourquoi et comment une idée nait, se dégagent des autres idées qui attendent leur réalisation et deviennent un fait. Mais tel n’est pas le cas pour les Jeux Olympiques. L’idée de leur rétablissement n’était pas une fantaisie : c’était l’aboutissement logique d’un grand mouvement. »
A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le développement des pratiques sportives est tout, sauf hasardeux. Il émerge dans un contexte transitoire d’évolution de la société, tant politique, qu’économique et social. Il relève aussi d’une volonté d’universalité au moment même où s’exacerbent les tensions nationalistes en Europe. Les guerres entre cités de la Grèce antique ne s’arrêtaient-elles d’ailleurs pas justement dès l’instant que débutaient les Jeux ! Ce que Coubertin ne cessera de clamer : « Les Jeux olympiques n’appartiennent pas à un pays mais à tous », répondant aux revendications grecques désireuses d’en conserver l’organisation.
Le baron de Coubertin n’est pas un inconnu des milieux sportifs. Cet historien de formation a même arbitré en 1892 la première finale du championnat de France de rugby. Il est alors âgé de trente ans et milite depuis 1888 pour une rénovation des Jeux après s’être investi dans le développement du sport à l’école.
Le 25 novembre 1892, dans une salle de l’université de la Sorbonne, sept hommes se réunissent pour faire part de leur vœu d’une renaissance des Jeux Olympiques. Georges Vigarello écrit dans son livre « Passion sport. Histoire d’une culture » : « Cet investissement se veut concret (Coubertin est un organisateur) et à grande échelle, très loin de se limiter à l’Hexagone. L’Olympisme confirme le moment où le sport peut devenir “mouvement” international animé par la constitution de réseaux. Coubertin a été celui qui a su convaincre et concrétiser. » Quatre ans plus tard, le Comité international olympique voit le jour, accompagné du programme qui régit son action. Les Jeux, désormais, peuvent démarrer !
Mais avant de laisser la place aux sportifs, qui sont l’essence même de cette nouvelle religion, il faut construire un temple digne des dieux du stade. Le temps presse et, surtout, l’argent manque. Convaincu de l’importance des Jeux pour son pays, un grec fortuné, Georges Averof, se charge de financer le stade panathénaïque, construit en dix-huit mois et qui peut accueillir, sur ses deux longueurs de tribune, près de cent mille spectateurs.
292 concurrents provenant de douze nationalités se disputent les neuf sports retenus par le C.I.O. : la lutte, l’escrime, l’athlétisme, les poids et haltères, le cyclisme, le tennis, la natation et la gymnastique. Débutées le 6 avril, les épreuves se terminent le 14. Les medias couvrent l’événement, à l’image de L’Illustration : « Voilà comment, à la date fixée, au pied de l’Acropole, couronnée de ruines majestueuses, les chemins de fer, les paquebots ont déversé, sous l’œil vigilant des agences, des théories de jeunes athlètes venus de France, d’Angleterre, d’Amérique, d’Allemagne, de Suède, etc…, pour se mesurer avec les fils de l’Attique… »
Côté résultats, les Américains trustent les médailles (9) en athlétisme alors que les Grecs restent maîtres dans des disciplines comme l’escrime, la lutte et l’haltérophilie.
Les Français se distinguent en cyclisme avec la triple victoire de Paul Masson et les trois médailles dont une en or de Léon Flameng.
Les femmes, nul besoin de les chercher ! D’emblée, Pierre de Coubertin a refusé leur participation aux Jeux. « Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique est à mes yeux, l’adulte mâle individuel. Les Jeux Olympiques doivent être réservés aux hommes, le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. » C’est compter sans la volonté de la grecque Stamta Révithi. Arrivée la veille à Marathon, cette inconnue court seule le lendemain de la course officielle des hommes. Après cinq heures trente d’une course solitaire, elle arrive en vue du stade panathénaïque. Pour son malheur, elle est arrêtée par des soldats grecs qui l’empêchent de pénétrer dans l’enceinte. Sa course ne sera jamais officialisée et Stamata Revithi sombrera dans l’anonymat.
Ce qui n’est pas le cas de son compatriote Spyridon Louis. Devenu héros national, malgré une vie toute de simplicité, son nom rentre dans le langage grec avec l’expression : « Courir comme un Louis ». En 1936, âgé de soixante-trois ans, il est désigné porte-drapeau de la délégation grecque aux Jeux Olympiques de Berlin. A cette occasion, il remet un rameau d’olivier venant d’Olympie à Hitler. Se souvenant de son exploit quarante ans plus tôt, il rappelle : « Cet instant avait quelque chose d’incroyable et je m’en rappelle encore comme d’un rêve… Des brindilles et des fleurs pleuvaient sur moi. Tous les spectateurs criaient mon nom et jetaient leur chapeau en l’air… »
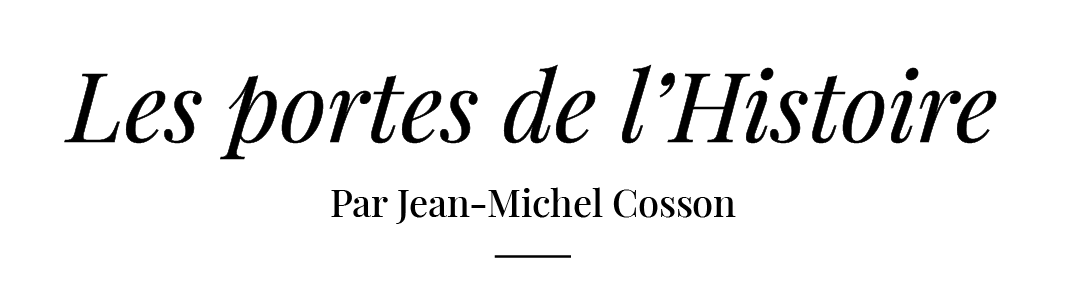
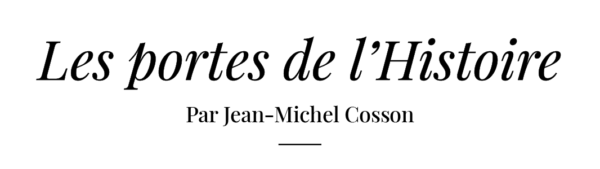
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !