Le prince charmant existe, la bergère de Durenque l’a rencontré…
Ce jour-là -était-ce un dimanche ?- l’auberge de Durenque grouille de monde. En cette fin d’après-midi printanier et pluvieux, les paysans s’accordent un peu de bon temps laissant aux « pastrous » le soin de traire les brebis.
On tape le carton ou on disserte, selon l’humeur, sur les aléas du temps, les pièges des saints de glace ou les caprices de la lune vieille. Le bruit clair des cruchons entrechoqués tranche sur le brouhaha ambiant. Sous les poutres basses, l’herbe à Nicot déploie de rares volutes : ici on chique plus que l’on ne fume. Nous sommes au cœur du XVIIIe siècle.
Soudain, la porte de l’auberge s’ouvre.
On ne distingue d’abord que la haute silhouette d’un gaillard enroulé dans une pèlerine. Le survêtement dégrafé laisse entrevoir un costume de belle étoffe dont les coloris chamarrés détonnent dans la rustique taverne.
L’inconnu ôte son tricorne galonné pour saluer la compagnie. Les conversations se figent aussitôt. Les buveurs, effarés, contemplent l’inconnu chaussé de bottes. Pareillement accoutré, il ne peut s’agir que d’un cavalier égaré.

L’inconnu interpelle le patron :
-Pouvez-vous m’héberger pour un séjour assez long ?
L’aubergiste écarquille les yeux, bredouillant dans le patois local qu’il ne dispose que de misérables « cambuses » sous les toits, indignes d’un gentilhomme. Un silence gêné, voire hostile, s’installe. Egaré aux confins du Ségala et du Lévézou, ce jeune notable ne peut appartenir qu’à la justice ou à la maréchaussée. Méfiance, ici on préfère régler ses comptes sans intermédiaire. L’intrus arbore un sourire rassurant :
-Je suis mandaté par la Cour de Versailles pour compléter le relevé topographique de la région initialement entrepris par mon maître, César-François Cassini.
La Cour de Versailles à présent ! Les paysans en demeurent pantois. Un murmure court dans l’assistance d’où un quidam se détache pour aller vers l’étrange visiteur. Chapeau bas et le regard accueillant. Lui n’a retenu qu’un nom, celui de Cassini.
-Dans le temps, je l’ai logé chez moi. Un grand Monsieur ! Je ferai bien pareillement pour vous.
Sans plus de façons, le quidam invite l’inconnu à le suivre jusque chez lui. Au hameau du Vitarel.
Chemin faisant, l’ingénieur cartographe précise qu’il est né non loin de la capitale, à Dreux exactement, en 1747, voici vingt-deux ans.
Son nom ? Jacques-François Loiseleur des Longchamps. Un patronyme dont le raffinement intimide soudain son guide.
-Je crains que ma proposition vous déçoive quand vous découvrirez l’état de ma demeure.
-Si M. Cassini y a séjourné, je ne doute pas d’apprécier l’endroit !
Discret, le jeune cartographe ne dit rien de l’accueil plutôt froid que M. le curé de la paroisse et le hobereau local réservèrent à sa sollicitation. Ils se souciaient peu d’héberger un inconnu que personne ne leur avait recommandé !
Avant d’inviter son hôte à franchir le seuil de son oustal, le cultivateur précise :
-Voici le bien que j’ai reçu en héritage.
Modestement, il ajoute qu’il s’appelle Boudou, comme s’il regrettait la banalité de ce patronyme répandu en Rouergue.
Un coup d’œil suffit à l’ingénieur pour estimer, à la vue des bâtiments spacieux mais vétustes, que la famille Boudou a connu une certaine aisance dont son hôte n’a visiblement pas hérité. Alentour, les communs et les cultures paraissent tout de même mieux tenus que la plupart des fermes de cette contrée probablement oubliée des dieux !
Le seuil de la maison Boudou semble en harmonie avec la bonhomie du maître des lieux. Quelque chose d’honnête et d’accueillant.
L’intérieur paraît bien sombre au nouveau venu. Mais, à l’appel de son mari, madame Boudou surgit dans la salle commune et, aussitôt, tout paraît s’éclairer. Jacques-François Loiseleur devine que la maîtresse du logis a hérité des bonnes manières d’une famille rurale aisée. Le nouveau venu confiera, bien plus tard, à sa plume ce portrait concis mais qui en dit long :
« Madame Boudou avait un air de civilisation. Elle avait été la nièce chérie de ses oncles prêtres… et elle entendait passablement le français » !
Les premiers mots de l’hôtesse allèrent droit au cœur du jeune homme :
-Mon mari vous offre ma maison. Je me joins à son hospitalité.
Comment résister à pareil accueil ? Allez, topons là !
La chambre, qui est celle qu’occupait M. Cassini, est d’un confort très relatif. « Qu’importe, songe Loiseleur, nous allons vers la belle saison et, d’ailleurs, ma mission ne me retiendra pas éternellement par ici ».
Dès le lendemain de son arrivée, le jeune homme pria M. Boudou de le guider au sommet du Lagast, proche du Vitarel. M. Cassini lui a dit que c’est à partir de ce point remarquable qu’il pourra entreprendre les visées pour établir une cartographie de toute la région comprise, au sud de Rodez, entre les cours du Viaur et ceux du Tarn.
Le Lagast est un site remarquable, au sud de Salmiech, coupé en deux en son faîte par une forêt de hêtres et de résineux sur le versant nord. Et sur le versant méridional, une succession de pâturages et de champs qui plongent vers les raspes du Tarn. Parvenu au sommet, M. Boudou montre à son pensionnaire le « signal » dressé par Cassini. Modeste ouvrage fait de quelques planches assemblées en forme pyramidale. Sur une plaque, le Maître a gravé l’altitude qui culmine à 927 mètres. Jacques-François comprend pourquoi Cassini a choisi ce site d’où l’on découvre, barrant l’horizon au nord, les monts du Cantal et, de l’autre côté, ceux de Lacaune.
Boudou précise :
-En hiver, par ciel clair, on voit la chaîne enneigée des Pyrénées Centrales !
En hiver !… « Où serai-je quand il viendra ? » songe le cartographe qui, d’ici là, compte bien mener sa tâche à bon terme. Pour l’immédiat, il va s’employer à perfectionner le « signal » de Cassini qu’il transforme en mini-observatoire doté de quatre fenêtres de visées orientées vers les points cardinaux. Notre génial bricoleur ne se doute pas que, au même emplacement, sera érigé, en 1910, un nouveau signal… et que soixante ans plus tard, l’O.R.T.F. y dresserait une antenne-relais pour la télévision.
A la fin de l’été 1769, Jacques-François Loiseleur est en retard sur son plan de travail : il a surestimé les capacités des lascars recrutés pour l’aider. Et sous-estimé le temps nécessaire à trimballer ses instruments de mesures dans un secteur aussi accidenté. Notre homme prend son mal en patience. Le soir venu, il fait bon retrouver le havre accueillant du Vitarel où la maîtresse de céans a préparé un repas aux saveurs rustiques. Et ensuite partager la veillée au coin du feu avec ses hôtes. Leur fille Marie-Jeanne, l’aînée des cinq autres enfants, est admise parfois dans l’intimité de ce délicieux rituel qui précède le coucher. L’adolescente, qui en a fini avec l’école de Durenque, est chargée de veiller au bon entretien du linge de Monsieur Loiseleur des Longchamps. Un nom à faire rêver la gamine, éblouie par la prestance du jeune homme qui raconte si bien :
« J’étais un assez bon élève au collège de Dreux. J’ai complété ma scolarité en étudiant la philosophie, deux ans durant au Petit Séminaire de cette ville. Mes parents me voyaient sur le chemin de la prêtrise moi qui ne rêvais que d’étudier les sciences !
« Je parvins à convaincre mon père que ma vocation était là. Sans plus barguiner, il m’accorda assez de ressources pour loger à Paris et m’initier au dessin et à l’architecture et parfaire mes connaissances en mathématiques. Je portais gaiement mes vingt et un ans quand, nanti des mes diplômes, j’eus la chance d’être nommé ingénieur-géographe du Roi ! On me recommanda à César Cassini qui cherchait des collaborateurs pour parfaire l’immense tâche qu’il a entreprise sur l’ordre de notre souverain Louis XV.
« Et voilà comment le hasard m’a conduit dans cette province si lointaine de la mienne jusqu’à votre accueillante demeure ».
Ainsi, soir après soir, la fillette qui va sur ses onze ans boit les paroles du Monsieur de Dreux. A son âge, Marie-Jeanne n’a pas droit à assister à toutes les veillées mais Loiseleur des Longchamps entreverra plus d’une fois l’adolescente qui, du haut de l’escalier menant aux chambres, ne perd rien de la conversation.
Les choses vont leur train durant quelques mois. Jusqu’au jour où maître Cassini rappelle le jeune ingénieur à Paris pour un travail urgent. La mission à Durenque n’est pas achevée, certes, mais on ne discute pas un ordre venu de la Cour !
Jacques-François boucle ses bagages. « Ne sait quand reviendra… ». Avant de franchir le portail du Vitarel, il est surpris : madame Boudou emporte vers sa chambre Marie-Jeanne, défaillante. Mais le paysan qui a accepté de conduire le voyageur jusqu’à la diligence de Rodez est impatient. Durant le long voyage pour rallier la capitale, le cartographe griffonne un mot à l’adresse de ses hôtes, s’excusant de ce départ brusqué et demandant des nouvelles de leur fille aînée. La réponse ne viendra qu’après de longues semaines, rassurante quant à la santé de Marie-Jeanne.
En réalité, l’adolescente -depuis le départ de M. des Longchamps- ne se départit pas de ce que l’on qualifie à l’époque de « mal des langueurs ».
Au XVIIIe siècle, le « mal d’amour » était naturel dès l’âge de Marie-Jeanne et l’Eglise considérait qu’à partir de douze ans, une fille est canoniquement en droit de se marier !

Ce qui atterre ses parents, c’est l’idée que leur fille soit tombée amoureuse d’un « Monsieur » que sa condition sociale lui interdira d’épouser. Le maire et le curé, consultés, abondent dans ce sens. Loin de cette agitation, Jacques-François ne semble plus préoccupé de la santé de Marie-Jeanne. Dans les lettres qu’il adresse au Vitarel pour donner de ses nouvelles, il prie simplement les Boudou de « transmettre son souvenir à sa petite lingère ». Plus tard, de mauvaises langues prétendront que les parents omirent volontairement d’informer leur fille de cette attention. Attitude qui paraît peu compatible avec la réputation de générosité dont bénéficie le couple. D’ailleurs, quand le cartographe est enfin de retour, peu avant la Noël de 1773, les Boudou se rendent à l’évidence : leur fille sort de sa mélancolie comme la Belle au bois dormant réveillée de son sommeil par le Prince charmant. A ceci près : Jacques-François ne s’attendait pas à jouer ce rôle ! Mais il ne résiste pas à ce regard de bonheur qui illumine le visage émacié de l’adolescente. Bouleversé, le jeune homme n’a pas besoin d’autre aveu pour répondre à l’appel de Marie-Jeanne. M. Loiseleur des Longchamps confiera à son journal intime cette touchante interrogation : « Trouverai-je ailleurs un cœur aussi sensible ?.. ».
La date des noces est fixée au premier jour du printemps de 1774. Joli symbole pour unir la pastourelle à son prince cartographe. La mariée, qui a seize ans et son époux qui en a neuf de plus, forment un couple radieux.
On peut se demander pourquoi, les bans prévoyant, selon l’usage, que le mariage serait célébré en la paroisse de la mariée, eût lieu en réalité en l’église Saint-Amans de Rodez. Peu importe. Les parents de Marie-Jeanne, toute sérénité retrouvée, se serrent un peu pour offrir deux ou trois pièces au jeune couple sous le toit du Vitarel. Passée la période euphorique durant laquelle Jacques-François mènera à terme sa mission de cartographie sur place, le conte de fée perdra de son charme.
- Cassini expédie son collaborateur tour à tour dans les Pyrénées, en Andorre et en Provence. De longs déplacements qui contraignent Marie-Jeanne à jouer les Pénélope en attendant les rares apparitions de son Ulysse.
Abandonnant sa fonction de cartographe, Jacques-François déniche un emploi sédentaire dans une mine où l’on extrait du plomb argentifère située en Bretagne. Loin du Rouergue mais au moins pourra-t-il amener Marie-Jeanne avec lui. L’expérience tournera court et un passage des Mémoires de l’ingénieur trahit son désarroi :
« Cinq ans après notre mariage, le gouffre des affaires me revomit (sic) et je dus accepter une place d’ingénieur aux mines de Poulladen. Nous y fîmes un séjour de près de trois années et j’y serais bien resté si ma femme n’y fut atteinte du mal des mines qui se termina d’une fièvre quarte ».
On retrouve trace du couple au Vitarel (où Marie-Jeanne se remet de son mal) à la fin de 1783. S’ensuit une période noire. Jacques-François avoue dans une lettre à ses amis : « Me voici réduit à travailler avec mes bras sur une route en construction… ». Qu’importe ! Loiseleur des Longchamps ne songe pas à abandonner le Rouergue et sa bergère aimée.
Quand gronde le canon et que flambe la Bastille en 1789, Jacques-François est pris dans la tourmente. Pas du côté où l’on s’y attendrait ! Loiseleur des Longchamps jouit d’une telle estime que le peuple de sa commune d’adoption l’envoie siéger au Conseil de District de Sauveterre-de-Rouergue. Epousant les idées réformatrices, « l’ingénieur de la Cour de Versailles » abandonne sa (fausse) particule pour devenir le « citoyen Longchamps ». Lorsqu’en 1792, l’élan de la jeune République est menacé, cet homme pondéré embrasse sans hésiter la cause des révolutionnaires purs et durs. L’année suivante, il est de ceux qui accueillent avec ferveur le célèbre tandem Bô et Chabot dépêché par la Convention à Rodez pour mater l’insurrection qui mine le département de l’Aveyron.
Prompt à repérer les plus zélés membres du Comité de Surveillance, le commissaire Chabot charge le citoyen Longchamps d’une mission exceptionnelle dans la région millavoise. Il s’agit de « recouvrer une taxe frappant tout individu suspect d’inimitié envers la Révolution ». Le « bon Monsieur » de la douce Marie-Jeanne va s’acquitter de sa tâche avec une rigueur inattendue, passant au crible les cantons du Sud-Aveyron. Dans son rapport, il conclut, sec comme une trique : « Pour moi, inflexible comme la Loi, je marche vers mon but ! »
Avec la générosité qui l’a toujours habité, notre homme servira la cause des révolutionnaires… jusqu’au jour où Robespierre, porté au pouvoir, décapita ses frères-ennemis Girondins en expédiant Chabot dans la même charrette que Danton. Jacques-François ne pouvait trouver meilleur refuge qu’au Vitarel où les douceurs du foyer retrouvé atténuèrent sa terrible désillusion.
L’âge aidant et passée la tourmente, Loiseleur, ayant récupéré sa particule, choisit de vivre une vie moins agitée auprès de sa fidèle Marie-Jeanne. Il lui construit une demeure à Puech-Cani (près de Broquiès) entre « un arpent de vigne et 88 perches de bosquet ». Le couple va mettre à profit une longévité étonnante à cette époque, pour vivre une retraite paisible. Certes, les soucis ne l’épargneront pas. Lui ne parviendra jamais à renouer avec sa lointaine famille. Elle, qui n’a jamais pu avoir d’enfant, se débattra dans les tracasseries paperassières pour léguer le domaine du Vitarel dont elle a hérité.
Mais Marie-Jeanne ne jouera plus les Pénélope. Son « prince » savoure, dans les étroites limites de Puech-Cani, les plaisirs de la botanique. L’ingénieur qu’il n’a cessé d’être bricole quelques outils « utiles à la science ». Entre autres, un baromètre dont le succès aidera, brevet à la clé, à faire bouillir la marmite du ménage.
On imagine cette fin de vie paisible comme une toile du peintre intimiste Chardin.
Le 1er août 1843, à quatre-vingt seize ans sonnés, Jacques-François Loiseleur des Longchamps s’éteint doucement dans les bras de Marie-Jeanne qui le rejoindra dans la tombe six semaines plus tard. La partie du cimetière de Saint-Cyrice de Brousse où reposaient leurs dépouilles a malheureusement disparu. Demeure, près de la vieille église, une croix posée sur une stèle où sont gravés les noms des deux héros de cet authentique conte de fées.
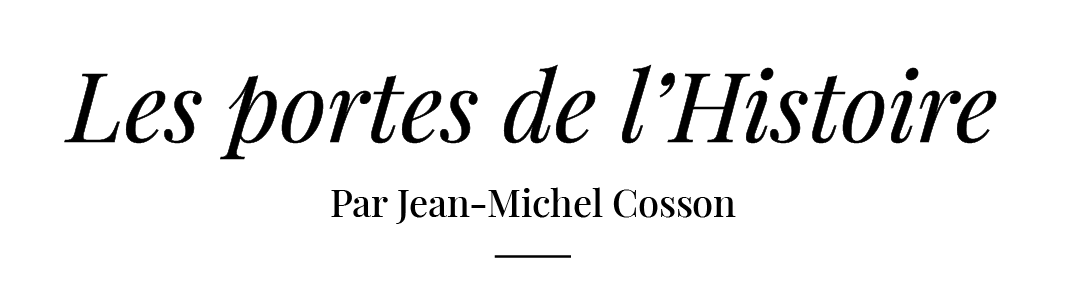
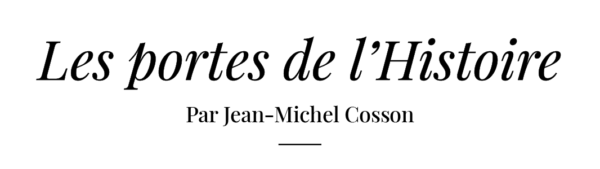
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !