Les intrépides filles de l’air. Elisabeth Tible. Sophie Blanchard. Jeanne Labrosse Garnerin et Elisa Garnerin
L’histoire est assassine avec les femmes qui ont voulu voler de leurs propres ailes et égaler les hommes. Si les noms des Montgolfier et de Pilâtre de Rozier sont universellement connus, ceux d’Elisabeth Tible, de Sophie Blanchard, de Jeanne Labrosse et d’Elisa Garnerin ne franchissent guère que le cercle des initiés de l’aviation. Ce quatuor d’intrépides, au-delà des règles, des convenances et d’un zeste de moqueries masculines, a pourtant marqué l’histoire des premiers vols.
Elisabeth Tible.
Faisons fi de la date du 20 mai 1784 qui voit le marquis de Montalembert inviter pour un vol captif son épouse, une demoiselle de Lagarde et les comtesses de Montalembert et de Podémas. Femmes certes courageuses mais uniquement spectatrices. Une attitude bien différente de celle qui, quelques jours plus tard, monte dans la nacelle de « la Gustave », pour devenir la première femme à voler dans un aérostat. A cet égard, considérant la proximité des deux dates, peut-on se demander si, dans l’esprit de ces dames, n’existe pas la volonté de tenir la corde de la renommée.
C’est ainsi que le 3 juin 1784, Elisabeth Tible s’envole au-dessus de Lyon, en compagnie du peintre Fleuraut, dont les toiles n’ont jamais atteint les sommets. Mais avant de prendre l’air, posons-nous une première interrogation : nous sommes en 1784 et si les Lumières éclairent la France des nobles et des bourgeois de leur philosophie nouvelle, l’absolutisme régit encore le royaume avec ses lois, ses codes et ses privilèges. Dès lors, comment un peintre de second rang doublé d’une marchande de mode ont-ils pu s’élever de concert au-dessus de la capitale des Gaules ? A dire vrai, ce Fleuraut, outre de manier le pinceau, se fend de chimie et d’inventions. Quelques mois plus tôt, n’a-t-il pas créé un mystérieux combustible assorti d’un réchaud produisant une flamme verticale. Mais inventer est une chose, financer un vol en est une autre. Quand les fifrelins ne tombent pas tout seul dans la poche, il faut bien les trouver ailleurs. Pas besoin d’aller bien loin. Le 18 janvier 1784, les frères Montgolfier ont survolé Lyon, invitant leur mécène, le comte de Laurencin, à prendre place à bord de la nacelle. Comment Fleuraut a-t-il réussi à convaincre le comte ? Sans doute en mélangeant une passion commune à une bonne dose de persuasion ! S’y ajoutait une souscription qui ne dût guère rapporter, à en croire Fleuraut : « Un procédé dont la gloire rejaillira sur la nation, ne recevra-t-il point d’encouragement de ceux de nos concitoyens qui peuvent contribuer à de tels projets, et le magnifique enthousiasme qui tournait toutes les têtes au mois de janvier, s’est-il éteint si vite qu’il ne reste plus aujourd’hui que le souvenir de son existence ? » Car il est bien connu que l’on ne prête qu’aux riches ! Ce qui n’a pas échappé à l’artiste quand il déclare, un brin aigri : « Ce serait rendre peu de justice à mes sentiments que de me soupçonner d’avoir eu pour objet une spéculation pécuniaire. L’espoir de concourir en quelque chose à la perfection d’une découverte qui immortalisera ses auteurs, est le vrai, le seul motif qui m’a déterminé. Mais je suis peintre. A voir les rigueurs de la Fortune pour les gens de mon état, on croirait que la déesse veut les punir de son bandeau, je n’ose dire en justifier les attributs. »
Quant à Elisabeth Tible, seule une certaine impertinence et un charme irrésistible ont pu convaincre le comte. Il l’avoue lui-même à Joseph de Montgolfier : « Décidé à ne pas monter la Montgolfière, à qui Monsieur, croyez-vous que j’ai cédé ma place ? A une jeune et jolie femme, à Madame Tible, née à Lyon, épouse, sans l’aveu de son cœur, dès l’âge de douze ans, d’un mari qui n’est pas homme, ignorant jusqu’au lieu où se tient caché le trompeur, enchaînée par des liens qui l’empêchent d’en former de mieux assortis, et qui sans doute a voulu se consoler avec la gloire, des torts perfides de l’hymen. » Bref, en quelques mots, le comte a succombé aux charmes d’une Elisabeth qui ne manque pas d’air ! D’autres lui auraient offert des fleurs. Un vol en aérostat est tellement plus romantique ! Ce dont se défend Elisabeth Tible dans une lettre à une amie. Où il ressort qu’elle voulait être la première à voler : « Tu sais combien je désirais m’élever dans les airs par le moyen d’un aérostat. Tu sais que si ma santé défaillante depuis quatre ans me l’eut permis à l’origine des Montgolfières, j’aurais peut-être donné l’exemple aux hommes qui m’ont tracé la route des cieux. »
Le 3 juin 1784 n’est pas une date anodine. Ce jour-là, le roi de Suède Gustave III est en visite à Lyon. Diverses manifestations sont prévues en ville à son égard. Quoi de mieux pour lui rendre honneur que de baptiser la montgolfière de son nom. Le départ est fixé à 18h30 dans l’enceinte de la maison d’Antonio Spéafico, aux Brotteaux. Le temps est superbe. Devant une foule médusée, Elisabeth Tible arrive habillée en Minerve, « robe blanche de taffetas serrée à la taille d’une ceinture de soie bleue et d’un chapeau oriental à larges bords ». Fleuraut n’est pas en reste dans son costume d’opéra. Quand la modiste entonne des extraits de « La Belle Arsène », Fleuraut lui répond par des extraits de l’opéra « Zémire et Azor ». Le roi de Suède hoche la tête. Décidément, ces Français sont surprenants !
Le ballon gonflé, la nacelle finit par s’élever sous les applaudissements de la foule. L’aérostat franchit le Rhône et la Saône. Non sans quelques frayeurs : « Une des planches de la nacelle se disjoint. Pour se tenir en équilibre, Elisabeth Tible doit s’accrocher au cercle de la galerie, tout en continuant à alimenter le foyer. » Fleuraut, jouant modestement les seconds rôles, dira quelques jours plus tard : « Mlle Tible qui a été la première de son sexe portée sur les Ailes des Airs, a mis une précision, une prudence attentive et réfléchie à alimenter le réchaud placé au-dessous de l’aérostat. Le sang-froid et le courage de sa compagnie ont fait tout le succès de l’expérience. »
Le vol dure près de quarante-cinq minutes. L’aérostat monte à 2700 m d’altitude, parcourant trois kilomètres avant de descendre puis de se poser lourdement dans le haut du clos de la Piemente, propriété de M. Tabareau. « Madame Tible est alors projetée sur le sol avec Fleuraut, se foulant la cheville. »
Les deux aérostiers sont alors portés en triomphe jusqu’à l’évêché à la lueur des torches et des hourras de la foule. Puis direction vers la Comédie perchés sur des fauteuils où les attend tout le gratin de la ville autour du roi de Suède. La petite modiste Elisabeth Tible vient d’entrer dans la légende. Modeste, elle écrira à une amie : « La gloire que j’y ai trouvée est bien peu de choses en comparaison du plaisir ressenti. »
Une gloire qu’elle ne veut pas éphémère. Reçue avec Fleuraut à l’Académie Royale des Sciences de Lyon le 30 juin, Elisabeth Tible part chercher à Paris la reconnaissance nationale et royale. Celle qui est devenue en l’espace de trois quart d’heure « la nymphe aérostatique », débarque dans la capitale début juillet avec la ferme intention de participer au vol de la montgolfière de l’abbé Miolan et du graveur Jean-François Jaminet, prévu le 11 juillet. Mais l’envol est un échec. L’aérostat demeure inerte. Ulcérée, la foule s’en prend à la machine avant de poursuivre les aérostiers. Elisabeth ne jouera pas la fille de l’air au-dessus de Paris.
La suite est beaucoup moins glorieuse. Elisabeth Tible sombre dans l’anonymat de la capitale. Et puis l’argent vient à manquer. En septembre, elle demande « des grâces pour avoir monté dans le ballon du comte de Laurencin ». Puis sa trace se perd. A peine sait-on qu’une dame Tible décède dans un hôtel parisien le 12 février 1785. L’air de la capitale ne lui avait pas réussi !
Sophie Blanchard. L’art et la manière de voler
Marie Madeleine Sophie Armant est âgée de six ans quand les frères Montgolfier font décoller leur aérostat. Aux Trois-Canons, un hameau de la commune d’Yves, proche de La Rochelle, l’événement ne marque pas les esprits, préoccupés que sont les paysans par d’autres questions plus terre à terre. De son enfance et de son adolescence, peu de choses ont filtré. A peine peut-on penser que la gamine n’a déjà pas froid aux yeux et qu’elle en démontre aux garçons quand il s’agit de batailler. En réalité, son histoire débute véritablement en 1804 quand elle épouse Jean-Pierre Blanchard, un as de l’aérostation. L’époque n’est plus aux expérimentations mais bel et bien aux spectacles. Les grandes villes de France et d’Europe s’arrachent les fous-volants pour alimenter leurs festivités. Et le public en redemande. Bref, le vol en aérostat est devenu tendance. Jean-Pierre Blanchard l’a bien compris qui agrémente chaque vol de manifestations que l’on appelle aujourd’hui pyrotechniques. L’aérostat est-elle affaire d’homme ? Que nenni ! Car Sophie Blanchard n’a guère l’intention de jouer les épouses passives. Aussi, afin de marquer les esprits et de s’affranchir de son mari, pratique-t-elle d’abord le parachutisme. Depuis un ballon, elle saute dans le vide, accrochée à un grand tissu en forme de parapluie. Sophie ne veut pas en rester là. En 1805, elle accomplit son premier vol à Toulouse. Puis tout s’enchaîne d’une année sur l’autre. Même l’accident mortel de son mari, en 1809, ne la freine pas. Les souverains européens la désirent. Napoléon Bonaparte succombe à son courage et à son intrépidité. Peut-être, qui sait, à son charme ? C’est elle qui décolle du Champ-de-Mars le 24 juin 1806, dans un ballon à gaz rempli d’hydrogène, lors des fêtes en l’honneur du mariage de l’Empereur avec Marie-Louise. Le Moniteur universel écrit : « Les vainqueurs [de jeux équestres organisés pour la fête] recevaient les prix décernés à leur habileté, lorsqu’un vaste aérostat disposé dans une des contre-allées du Champ-de-Mars, orné d’emblèmes et de peintures allégoriques ingénieuses, et comme protégé par les armes impériales, s’est avancé en face des fenêtres du palais. L’aéronaute qui le montait était une femme, Mme Blanchard, dont de nombreux voyages aériens ont fait connaître le nom. Elle a salué LL.MM. En agitant un drapeau blanc, puis laissant élever au-dessus d’elle-même une étoile figurée qui annonçait la direction qu’elle allait prendre, elle s’est enlevée en jetant des fleurs, avec une rapidité extraordinaire ; un vent assez vif la portait vers Meudon, où elle est en effet descendue sans accident. » C’est elle encore qui s’envole au-dessus de Milan, l’année suivante, pour les fêtes de l’Empereur. Au point que Napoléon la nomme ministre. Elle se produit également à Francfort, Rome, Naples, Turin. La Restauration ne la boude pas. Le 4 mai 1814, elle vole lors de l’entrée de Louis XVIII dans la capitale, ayant décoré la nacelle de verres colorés. Toutefois, ses vols ne vont pas toujours sans incident. A Vincennes, son ballon monte à 3600 mètres. Perdant connaissance, elle n’atterrit que 14h30 plus tard. Hagarde mais bien vivante. En 1817, elle manque de se noyer près de Nantes, n’ayant pas vu que le terrain est inondé.
L’ivresse de la hauteur lui sera fatale. Le 6 juillet 1819, Sophie Blanchard s’envole depuis le jardin du Tivoli, lieu de la fête parisienne. Depuis son ballon, elle veut offrir aux spectateurs un véritable feu d’artifices. Mais rien ne va se passer comme prévu. C’est Le Constitutionnel qui raconte l’accident : « On attribue à deux causes différentes le funeste événement qui a donné la mort. En prenant son essor, le ballon a porté plusieurs fois contre les branches des arbres voisins ; cet accident, fort ordinaire d’ailleurs, a pu déranger l’artifice suspendu à la machine, changer la direction de quelques-unes des pièces, de telle que la chandelle romaine, par exemple, au lieu d’être lancée horizontalement ou obliquement, a pu être dirigée sur le ballon et l’incendier. D’un autre côté, on suppose que l’infortunée avait l’intention de descendre le plus promptement possible, et qu’en conséquence elle n’avait point fermé l’appendice par où le gaz est introduit, et par où il s’échappe. En mettant le feu à l’artifice, Mme Blanchard a pu le mettre aussi au courant de gaz qui s’était formé et embraser ainsi toute la machine qui, en moins de dix secondes, a été consumée…
« Mme Blanchard est tombée sur la maison de la rue de Provence, n°16, dont elle a enfoncé le toit, on assure qu’alors elle respirait encore, et qu’on lui a entendu jeter des cris de douleur et d’effroi. Le contrecoup l’a précipitée sur le pavé, et quand les premiers secours sont arrivés, elle ne respirait plus. On l’a ensuite transportée à Tivoli. La foule immense qui s’y trouvait réunie avait été témoin de l’événement…
Mme Blanchard faisait sa soixante-septième ascension… elle ne laisse ni enfants, ni parents connus. Elle était dans l’aisance sans être riche… »
Jeanne Labrosse Garnerin et Elisa Garnerin. Une affaire familiale
Nous sommes le 22 octobre 1797. Dans la foule qui se presse au parc Monceau, Jeanne Labrosse n’a d’yeux que pour le héros du jour, André-Jacques Garnerin, qui vient quelques minutes plus tôt de sauter pour la première fois en parachute depuis une nacelle. L’homme malgré tout n’est pas un novice. Elève du physicien Jacques Charles, la Révolution l’a nommé « aérostier des fêtes publiques », les montgolfières servant alors de moyen de propagande. Jeanne, dès lors, n’a qu’un souhait : devenir l’élève et un jour égaler voire dépasser le maître.
Mais, en cette fin de XVIIIe siècle, la Révolution est loin d’avoir offert à la femme la liberté que certaines, comme Olympe de Gouges, revendique. Aussi, monter avec un homme sans être mariée dans une nacelle et s’envoler avec lui, voilà qui ne plait guère à ces messieurs de la police parisienne. « Le spectacle de deux personnes de sexe différent, s’élevant publiquement à ballon perdu, est indécent, immoral… » Mais Garnerin a de l’entregent (il a déposé contre Marie-Antoinette au moment de son procès) et du fait de sa position officielle, il finit par obtenir satisfaction pour s’envoler avec l’une de ses élèves comme le révèle « La Chronique universelle » du 15 juin 1798 : «Le citoyen Garnerin annonce que la défense qui lui avait été faite de s’élever dans les airs, avec une personne d’un autre sexe, vient d’être levée par le département de la Seine […]. La lettre de l’administration centrale au citoyen Garnerin est ainsi conçue : « Citoyen, d’après la réclamation que vous avez adressée contre l’arrêté du bureau central, qui vous défend de voyager dans un aérostat avec une jeune citoyenne, nous avons consulté le ministre de l’Intérieur et celui de la police générale, qui tous les deux sont d’un avis conforme au nôtre, et pensent qu’il n’y a pas plus de scandale à voir deux personnes de sexe différent s’élever ensemble dans l’air, qu’à les voir monter dans une même voiture, et que d’ailleurs on ne peut empêcher une femme majeure de faire à cet égard ce que l’on permet aux hommes, et de donner en s’élevant dans les airs une preuve à la fois de confiance dans les procédés et d’intrépidité […]. » »
Le 10 novembre 1798, Jeanne Labrosse et sa compagne Célestine Henry, s’élancent seules dans un ballon. L’expérience est concluante. «Nous ne répéterons point ici, écrit « La Chronique universelle » du 17 novembre 1798, ce que les premiers navigateurs aériens ont décrit des sensations ravissantes que l’on goûte en quittant le sol terrestre, et de l’extase qu’inspirent la beauté et la grandeur du tableau de la nature. Nous dirons que nous en étions pénétrées, que nous nous y livrâmes entièrement, jusqu’à ce qu’un froid très vif nous réveillât de notre distraction. Alors, nous agitâmes l’étendard tricolore, toujours signal de triomphe et de victoire ! La citoyenne Labrosse écrivit un billet contenant ces mots : « Notre sort est agréable, nous sommes sans crainte et sans inquiétude. » Nous l’attachâmes au col d’une tourterelle que nous enfermâmes dans une cage et nous la fîmes descendre avec un parachute que nous avions construit, d’après la méthode du citoyen Garnerin ; notre message est arrivé à bon port. »
Jeanne Labrosse ne se contente pas de ce succès. Elle veut être désormais la première femme à sauter en parachute depuis une nacelle. Mission accomplie l’année suivante quand, le 12 octobre, elle s’élance dans le vide sous les yeux, cette fois admiratifs, de son professeur : « Hier, l’expérience de l’ascension à ballon perdu et de la descente en parachute de la citoyenne Labrosse, a eu un succès complet ; je n’ai jamais rien vu de si imposant. Le courage, l’adresse et la présence d’esprit de cette aimable et intéressante personne, n’ont point d’égal. Je m’honorerai toujours d’avoir formé une élève dont le début dans mon art fera époque dans l’histoire du siècle. Son triomphe l’immortalise, il confond la méchanceté, écrase le serpent qui dicta contre elle le pamphlet abominable dont on vient d’inonder Paris. Jamais le monstre de la calomnie n’exerça sa rage avec autant de fureur et d’audace ; sûrement que les magistrats du peuple croiront de leur dignité d’en faire rechercher et punir les auteurs. »
Les années suivantes, Jeanne suit son mari tout au long des voyages qui les conduisent à se produire à travers l’Europe. En 1802, elle dépose le brevet de parachute inventé par son époux. Ensemble puis avec sa nièce Elisa Garnerin, Jeanne comprend tout le parti financier qu’il y a à tirer de ses représentations en parachute. Et c’est bien une véritable entreprise familiale qui voit le jour comme le révèle en 1912 un article acide de « La Revue politique et littéraire » : « Aéronautes courageux, mais prudents, inventeurs sans génie aucun, mais gens d’affaires de premier ordre, habiles, intrigants, tenaces, pas trop scrupuleux, remarquables impresarii, quelque peu aventuriers, les Garnerin exerçaient leur industrie pendant le premier tiers du XIXe siècle. »
C’est que l’affaire est juteuse si l’on en croit un rapport du préfet de Police de Paris qui estime, pour un vol et un saut le 15 septembre 1816 à Paris, le bénéfice à 8600 francs. Une entreprise qui durera jusqu’en 1836, date du 39e et dernier saut d’Elisa Garnerin.
André-Jacques Garnerin décède malencontreusement le 18 août 1823 à Paris, tué par la chute d’une poutre sur le chantier d’un nouveau ballon. Jeanne lui survit jusqu’en 1844. Entretemps, elle a ouvert une table avec Marie-Thérèse Figueur, plus connue sous le nom de « Madame Sans Gêne ». Elisa Garnerin disparaît en 1853. « La navigation aérienne lui doit-elle quelque progrès ? concluent les auteurs de « La Revue politique et littéraire ». Assurément non. On peut appliquer à Elise Garnerin le jugement que Robertson, leur concurrent, avait porté sur son oncle : “ Il n’a pas plus avancé l’art aérostatique par ses ascensions qu’un Savoyard n’avance l’optique en montrant la lanterne magique.” Ce qu’il y a d’intéressant en elle, c’est la femme d’affaires, son activité, sa ténacité, ses idées pratiques et variées, l’ingéniosité avec laquelle elle sut trouver les procédés d’une publicité toute moderne donne à sa figure son caractère et son relief. »
Pour autant, il ne faut pas oublier la bonne dose de courage qu’il fallait pour s’élancer de ces engins volants. A ce titre, Jeanne Labrosse Garnerin et Elisa Garnerin ont permis aux femmes de pouvoir évoluer à l’égal des hommes dans le domaine du sport parachutiste.
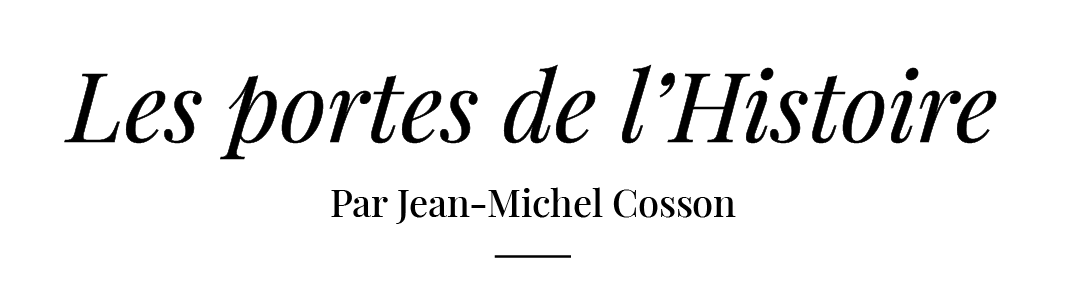
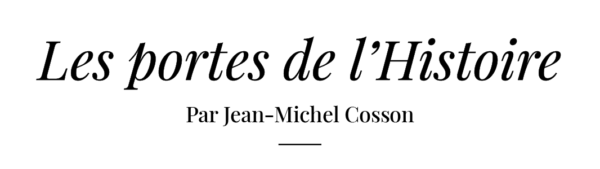
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !