SŒUR SAINT-FLEURET, LA POSSEDEE DE GREZES 1902
A quelques encablures de Laissac, la commune de Sévérac-l’Eglise confond depuis plus d’un siècle son histoire avec celle de l’orphelinat de Grèzes, dont les vastes bâtiments servent de porte d’entrée au village.
C’est dans ce lieu, en effet, qu’une jeune fille opiniâtre, Césarine Galtier, décida de consacrer sa vie aux orphelins en les accueillant, dès 1880, dans sa propriété familiale. Après bien des difficultés (son projet ne recevait qu’un faible écho de la part de l’Eglise), elle fonda une congrégation et prit le nom de sœur Sainte-Croix. L’arrivée en 1888 du frère de la fondatrice, l’abbé Honoré Galtier, favorisa l’expansion de l’établissement, en préparant les jeunes orphelins aux travaux agricoles.
La vie, à Grèzes, suivait tranquillement son cours quand, vers la fin de 1892, une épidémie de typhoïde frappa de plein fouet le couvent. Devant la gravité du mal, le préfet de l’Aveyron et l’évêque visitèrent les sœurs pour tenter d’enrayer la maladie. En vain ! Quatre d’entre elles décédèrent rapidement. Parmi les nonnes éprouvées, la sœur Saint-Fleuret paraissait la plus gravement atteinte. Du 10 novembre 1892 au mois de juin 1893, elle s’alita. Le docteur qui l’ausculta, jugeant qu’elle était tuberculeuse, estima qu’il ne lui restait que quelques jours à vivre.
Pourtant, sœur Saint-Fleuret survécut. Mais le mal qu’endurait désormais tout son corps allait se révéler autrement plus terrible qu’une épidémie de typhoïde. Très vite, ses compagnes constatèrent que sœur Saint-Fleuret endurait des crises intérieures qui n’avaient plus rien à voir avec les symptômes antérieurs. Elle, d’ordinaire si tendre et si respectueuse, proférait en de brusques colères des imprécations sordides et menaçait physiquement l’entourage qui s’apitoyait sur son triste sort. La mère Supérieure, émue de cette situation, en référa à l’autorité ecclésiastique. Mgr Bourret, évêque en charge du diocèse de Rodez, n’y attacha guère d’importance mais diligenta quand même sur place le médecin major Géraud, névropathe bien connu. Son rapport n’étonna guère le prélat. Le médecin diagnostiquait une hystérie dont l’explication se trouvait tout entière dans la suggestion et l’autosuggestion. Le médecin n’oublia pas cependant de mentionner que « nulle part, ni à la Salpêtrière, ni ailleurs, il n’avait vu une malade plus incroyablement curieuse à étudier ». Ce qui laissait, bien entendu, de la marge à toutes sortes d’interprétation.
Puisque sœur Saint-Fleuret relevait de la médecine et de la psychiatrie, on s’interrogea sur sa personnalité, pour le moins équivoque. Marie Raynal, pour l’état civil, avait vu le jour en 1872 dans une famille de parents pauvres, agriculteurs à Espeyrac, petit village du canton d’Entraygues. Comme la plupart des filles de sa condition, ses parents l’avaient élevée dans le catholicisme le plus rigide, conditionnant son esprit dans la plus stricte observance des préceptes religieux. Que Marie Raynal manifestât le désir de rentrer dans les ordres n’étonna donc personne ! C’est ainsi que la petite fille d’Espeyrac, encore adolescente, franchit le 8 décembre 1887 la porte du couvent Notre-Dame du Calvaire, à Grèzes.
Le milieu dans lequel baignaient les jeunes novices n’incitait guère à déroger aux règles de la maison. Les religieuses y professaient jusqu’à l’obsession la peur de la tentation et la crainte de l’Enfer. Convaincue toutefois d’avoir suivi le bon chemin, Marie Raynal choisit de revêtir l’habit religieux avant de prononcer sa profession de foi, le 10 juin 1890, sous le nom de sœur Saint-Fleuret.
De 1893 à 1902 donc, l’attitude de la religieuse inspira les plus vives inquiétudes à son entourage. Aux longues périodes de calme et de recueillement succédaient de brèves mais violentes colères où la bonne sœur, comme si elle avait le diable au corps, proférait des menaces, insultait tout ce qui possédait un rapport avec la religion et griffait ceux qui tentaient de la calmer. Lors de ses crises, elle poussait des hurlements si retentissants que les paysans les entendaient à une grande distance du couvent. Inutile de dire que les ragots allaient bon train dans la région et que les nouvelles qui sortaient au compte-gouttes du couvent suscitaient le plus grand étonnement. Chacun y allait de son couplet. Le corps de sœur Saint-Fleuret conservait les traces des brûlures et des morsures du Diable. Elle s’envolait dans les airs et, comble de blasphème, crachait sur les saintes hosties qui lui étaient présentées.
L’attitude « démoniaque » de sœur Saint-Fleuret relevait d’une telle complexité que la mère Supérieure sollicita de nouveau Mgr Bourret pour qu’il mandate un exorciste, seul capable de délivrer l’une de ses filles de la puissance occulte habitant son corps. Car, pour mère Sainte-Croix, il ne faisait aucun doute que sœur Saint-Fleuret, et par la même toute la communauté, était possédée par le Malin qui empruntait sa voix et dirigeait sa pensée.
Le rapport qu’il avait reçu du médecin n’incita guère le prélat à accepter cette requête. D’autre part, l’évêque ne désirait pas donner du grain à moudre à la presse anticléricale qui ne manquerait pas de se gausser de ces croyances moyenâgeuses. Déjà, à la fondation du couvent, il avait dû freiner « les prétentions » d’une jeune servante, émule de Bernadette Soubirous, qui soutenait être en contact avec la Vierge Marie et détenir d’elle des secrets inconnus des grands savants. Un « Lourdes bis » aurait pu paraître louche. Point trop n’en faut, même quand il s’agit de la Vierge. La servante se fit donc vertement tancer par un évêque qui n’avait pas pour habitude de garder la langue dans sa poche. Enfin, Mgr Bourret, fin connaisseur des mentalités rurales, ne doutait pas un seul instant que de telles révélations susciteraient au sein du peuple la résurgence de vieilles croyances, encore bien ancrées dans les campagnes.
L’Aveyron, mais ce n’était pas un cas exceptionnel, n’avait pas échappé tout au long de son histoire aux superstitions qui entouraient les relations très complexes entre un Dieu, symbole de bien et d’autorité et son « clone » malfaisant, adepte du Mal et être immonde, prêt à s’emparer des corps les plus sains pour leur infliger le plus cruel des châtiments. Si sœur Saint-Fleuret avait vécu au Moyen Age, nul doute que l’Eglise l’eut déférée devant un tribunal et brûlée comme sorcière. Néanmoins, dès le XVIe siècle, l’Eglise retourna ces croyances à son profit. Si le Diable existait, c’était par la grâce de Dieu. Dès lors, les terribles tourments qu’il infligeait à certains de ses sujets pouvaient être perçus comme le fruit d’un châtiment ou, pour les âmes les plus saintes, comme une mise à l’épreuve de leur foi. A travers le Diable, c’était donc Dieu qui apparaissait. Lui seul pouvait mettre un terme à ce désordre, en déléguant à ses représentants le pouvoir de chasser les démons par des prières spéciales du rituel.
Curieusement, une étrange histoire avait autrefois occasionné un trouble certain parmi les habitants de Sévérac-l’Eglise. En 1676, la requête de plusieurs paroissiens au procureur général du Roy était venue semer le trouble au sein de la communauté. Cette requête dénonçait les crimes, impostures et abus commis par le curé du lieu dans les prétendus exorcismes exercés à l’égard de l’une de ses paroissiennes, Catherine Dalmayrac, considérée haut et fort par les gens du cru comme sa femme, qu’il détenait et gardait dans sa maison malgré les ordonnances d’interdit prononcées par le vicaire général. Mieux encore, le curé profitait de cette situation pour vendre comme reliques des morceaux de linge de la possédée. Questionné, le zélé curé soutint qu’il n’avait point épousé Catherine Dalmayrac mais la gardait enfermée pour la débarrasser du Diable. La plainte, à vrai dire, fleurait bon la vengeance, et la pratique ecclésiastique, l’escroquerie.
Concernant sa « brebis malade », Mgr Bourret ne transigea pas et refusa tout net l’exorcisme. Sœur Saint-Fleuret continua donc de vivre avec ses souffrances, constamment surveillée par ses compagnes. Il était déjà assez difficile d’en supporter les manifestations à l’intérieur du couvent sans attirer encore les regards de l’extérieur.
La démoniaque de Grèzes aurait sans doute enduré dans le plus grand secret du couvent sa terrible maladie quand, on ne sait trop comment, l’agence Paris-Nouvelle rapporta, le 14 juin 1902, quelques notes à son sujet. Dans cette France minée par les tensions religieuses, le sort de la sœur Saint-Fleuret ne risquait pas de laisser indifférent ni les tenants de la religion, ni les anticléricaux déclarés que de récentes mesures gouvernementales encourageaient à se manifester. Possédée, sœur Saint-Fleuret le fut mais pas de la façon que l’on pourrait croire ; et c’est bien à son corps défendant qu’elle fut l’innocente vedette des journaux locaux et nationaux.
L’Eclair, le Gaulois, le Français jusqu’au Radical de Charleroi, sans oublier l’Union Catholique, La Dépêche ou L’Aveyron Républicain, tous trois journaux aveyronnais, dépêchèrent sur place leurs envoyés spéciaux chargés d’enquêter sur la sœur Saint-Fleuret, son mal et ses secrets. En véritables « paparazzi », ils traquèrent autour d’eux l’information, questionnant des paysans à la fois soupçonneux et surpris d’un tel remue-ménage. Comme il est de coutume, quelques langues se délièrent, offrant aux as de la plume le ciment plus ou moins grossier de leurs futurs articles. Pour la presse, cette histoire n’était que pain béni ! Et on en raconta des fichues histoires sur le compte de la sœur Saint-Fleuret ! Qu’elle grimpait aux murs, s’envoyait en l’air en ignorant les lois de la gravitation, essayant d’arracher les yeux des prêtres qui tentaient, en vain, de l’approcher. Et de repasser encore les plats ! La sœur détestait la présence d’objets religieux. Le voisinage d’un Christ, la présentation d’un livre de dévotion ou d’une image pieuse la plongeaient immédiatement dans un accès de rage. Ceux qui essayaient de les cacher à sa vue en étaient pour leurs dépens. Sœur Saint-Fleuret les sentait, les devinait puis se précipitait comme une furie pour les détruire. Même l’évêque qui l’avait fait introduire dans ses appartements eut à subir ses diableries. Car l’Eglise, face à tout ce « tintouin » orchestré, dixit par la presse anticléricale, pourtant souvent taxée de suppôts du Diable, prenait désormais fait et cause pour la persécution démoniaque. Mgr Livinhac, membre de la congrégation des Pères Blancs d’Afrique, qui la visita à cette période, fut surpris que la sœur, après lui avoir craché par la figure, lui répondit en langue caraïbe, une langue forcément inconnue d’elle.
C’est alors que Mgr Germain, successeur de Mgr Bourret, après avoir rencontré sœur Saint-Fleuret, décida de pratiquer un exorcisme. Pour bien faire, il chargea un missionnaire en Chine, le père Vic, de procéder à la cérémonie. Le brave homme ne réussit qu’à exaspérer la colère de la sœur qui se mit à lui parler, le visage défiguré, dans le plus parfait chinois. Consternation dans les milieux cléricaux ! Hilarité générale chez leurs adversaires ! Après de telles affirmations vint le temps des interrogations. Sœur Saint-Fleuret, à l’évidence, souffrait. Mais quelle était la cause de son mal ? Pour le médecin attitré du couvent, et donc bien placé pour donner un avis pertinent, les symptômes de sœur Saint-Fleuret appartenaient au domaine de l’hystérie. L’éducation rigoureuse qu’elle avait subie depuis sa tendre enfance, fondée sur l’idée de récompenses et des peines dans l’autre monde, avait provoqué une pathologie bien connue sous le nom de démonomanie, sorte d’aliénation mentale, souvent passagère, qui fait que la personne qui en est atteinte se croit possédée du démon. « La sœur a fini par rêver du diable, écrivit le docteur Séguret, par le voir à ses côtés, par vivre en lui ; elle s’est hallucinée jusqu’à le sentir en elle. » Le médecin avoua toutefois que tous les traitements tentés avaient échoué. Histoire d’enfoncer le clou, les feuilles anticléricales soupçonnèrent le clergé de vouloir susciter parmi les populations un regain religieux. « C’est une bonne fortune pour le couvent qui la recèle, écrivit la Dépêche du 26 juin 1902. A dix lieues à la ronde, la proximité du démon éveille chez les gens superstitieux un sentiment de respectueuse terreur qui se manifeste par d’abondantes aumônes. »
Après quelques semaines « surmédiatisées », l’intérêt qu’avait suscité le cas de sœur Saint-Fleuret disparut aussi vite qu’il était venu, laissant les lecteurs circonspects et un fait divers, sans réponse. Il n’en fut pas de même de la pauvre sœur Saint-Fleuret, qui vécut plus ou moins recluse dans son couvent jusqu’à sa mort, en 1945, à l’âge de 74 ans, oubliée de tous et sans doute aussi du Diable !
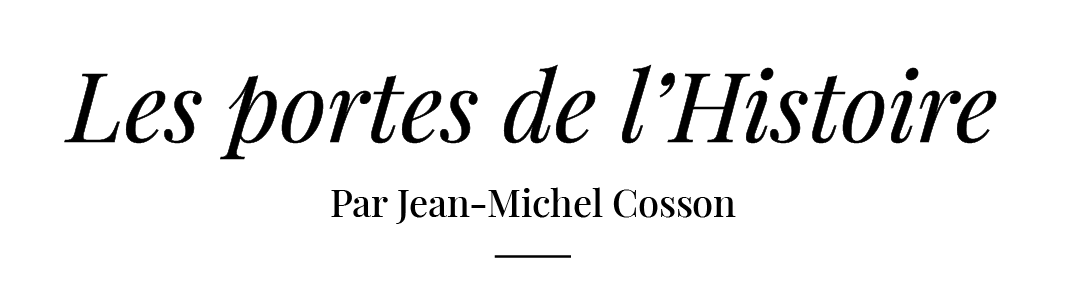
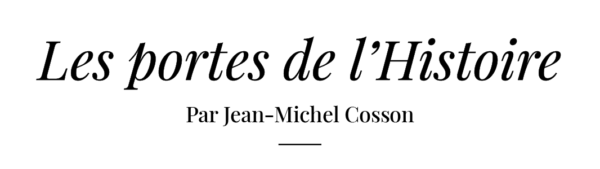
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !