Jacques Dropy. Le caricaturiste des « aborigènes de la cité »
Visage poupin de l’enfant qui a oublié de grandir. Grands yeux transpirant de malice. Deux mèches éternellement rebelles comme marque de son indépendance et de sa liberté. Et surtout, un coup de crayon à nul autre pareil qui impressionnera à l’adolescence son ami, l’écrivain aveyronnais René Couderc : « Tu m’avais laissé à plusieurs reprises quelques dessins capables d’entretenir en moi ton souvenir. Il y avait déjà ce trait parfaitement assuré, sans reprise, à la Cocteau – dont nous aimions les fantaisies – mis au service d’une vision d’êtres souvent désabusés. Une linéarité absolument maîtrisée fixant, là, quelque aigre bigote, ailleurs, la mégère superbe ou la froide vieille fille et bien d’autres sous-espèces des « aborigènes de la cité ».
Quelques années plus tôt, en 1961, Jacques Sternberg dans la revue « Problèmes » lui consacre quelques lignes au milieu d’autres caricaturistes des « Trente Glorieuses » : « Les dessins de Dropy avaient non seulement leur charme, mais leur cachet personnel. Ils disaient des choses, ils exprimaient une vision, pas une vision épique du génie, mais une “certaine vision”. Une petite musique, comme on dit… Les idées mises à part, Dropy avait également un style assez personnel, tout en angles et en lignes dépouillées à l’extrême, style qui pourrait bien avoir inspiré des dessinateurs comme Ru et Escaro. Tous se sont ralliés au clan des anguleux alors que la plupart des caricaturistes de la nouvelle école dessinent délié en souplesse. »
Un brin nostalgique, il regrettait toutefois « de ne voir plus guère de dessins de Dropy et c’est fort regrettable ».
Un constat similaire de nos jours comme si Dropy, en franchissant « le portail de la nuit », avait laissé s’effacer toute trace de son passage artistique. Nulle biographie dans les ouvrages régionaux. Quelques rares articles patiemment extraits de revues. Surtout des dessins, des affiches et quelques photos laissés en héritage.

« L’enfant-Dropy » nait à Rodez le 28 décembre 1928, de parents bijoutiers, place de l’Olmet, à l’angle de la petite rue Saint-Amans et de la rue du Bal. Tout petit, avant de savoir lire et écrire, il dessine sur ses cahiers d’écolier. Des études ensuite à l’institution Sainte-Marie puis au lycée Foch mais déjà dans sa tête, l’envie de monter à Paris mettre son talent à l’épreuve. Dans « 40 portraits d’humoristes », il écrit, cynique : « J’adore les bonnes blagues.
J’en fais moi-même d’excellentes, quand je suis fatigué de perdre mon temps.
C’est ainsi qu’un jour j’ai fui le paternel logis, en y laissant une épître fort bien tournée qui plongea ma famille dans la consternation.
J’y avouais, entre autres broutilles, un ferme désir de me donner la mort.
Ma grand-mère me maudit, ce dont je me foutais.
Mais elle me déshérita, baillant ses fifrelins à un jeune minus habens de son entourage, qui prépare Polytechnique.
Pour remédier à cet état de choses, j’étais presque à me jeter aux pieds de mon aïeule une excuse la plus platissime, quand cette excellente femme eut l’idée non moins excellente de crever dans son lit, à l’improviste.

Ce joyeux événement me consola de la perte d’un patrimoine dont mon inconduite civique et l’amas de gaffes majestueuses qui constituent la base de ma réputation m’auraient d’ailleurs interdit la jouissance. »
Jacques Dropy donc, à peine âgé de dix-huit ans, débarque dans la capitale juste après la guerre, avec l’espoir de rencontrer Jean Effel et surtout de se faire un nom dans la presse nationale. Le journal France-Dimanche l’embauche, qui titre un jour : « Mme Dropy sa mère, a eu peur en voyant les dessins de son fils. »
Pour le néo-parisien, c’est aussi le temps de la bohème, à Saint-Germain-des-Prés où il côtoie Boris Vian, Juliette Gréco et ses amis caricaturistes Gus et Barberousse. Et c’est bien Jacques Dropy, ce presque gamin, au bras droit appuyé sur le pare-brise de la 6 CV Renault décapotable à damiers qu’immortalise Robert Doisneau devant le bar « Le Tabou », rue Dauphine, en compagnie du peintre Corbassière, créateur de cette voiture-échiquier, de la comédienne Catherine Pié, du videur de boîte Tarzan, de Michel de Ré et de sa compagne l’américaine Deddy Einstein.
Quelques frasques au service militaire plus tard, Dropy retourne à Paris. Les années 50-60 sont les plus belles de sa carrière. Des dessins pour diverses revues comme Le Rire, Paris-Match ou Pilote dans lequel apparaissent ses fameux « animaux croisés » mais également 76 affiches de music-hall, des cartons pour la télévision et surtout des publicités où sa signature s’appose sur différentes marques. Une affiche le fait véritablement connaître : celle de la British Petroleum sur laquelle apparaît, en fond, la cathédrale de Rodez.
Vedette d’une exposition consacrée aux caricatures sur le suicide, Dropy singe un futur suicide sur une photo, tenant un revolver plaqué sur sa tempe.
Mais « l’enfant-Dropy », qui n’a rien perdu de son regard d’enfant, se noie aussi dans les dérives de la vie parisienne. Les temps changent. Les commandes se font plus rares. Une nouvelle vague de dessinateurs arrive : Wolinski, Reiser… Jacques Dropy, usé par les excès, retourne dans sa ville natale, dans la maison familiale, où il décède en 1991.
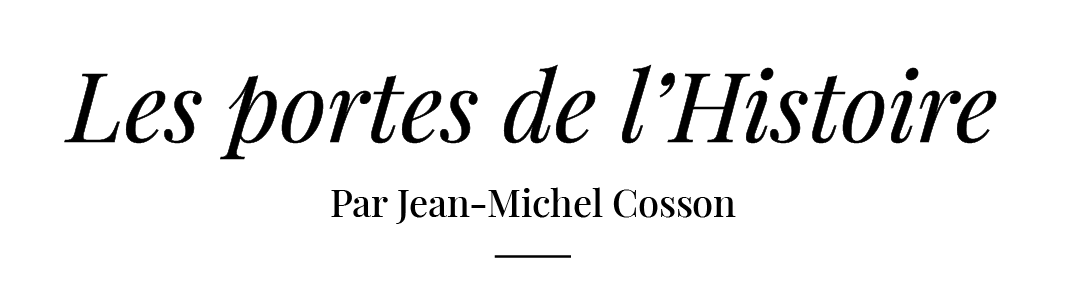
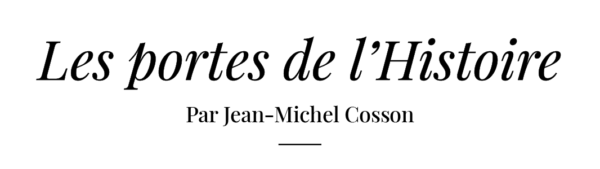
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !