L’Histoire secrète de la plus grande catastrophe ferroviaire en France. Saint-Michel-de-Maurienne. 12 décembre 1917
« Je suis responsable de ce convoi… je ne partirai qu’avec une motrice derrière moi. Ce sont des wagons italiens. Déjà l’autre mécano m’a signalé que les freins sont bricolés. Je connais la ligne, je ne pars pas !
– Girard c’est un ordre ! Vous démarrez tout de suite ou c’est la forteresse ! Compris ?
– C’est de la folie, de la folie… Neuf cent tonnes dans le cul, quelle connerie la guerre ! »
Ce court dialogue en gare de Modane entre l’adjudant Girard, le mécanicien responsable du train Modane-Paris et le capitaine Fayolle, commandant du trafic, provoque les quolibets des poilus qui depuis l’aube sont partis de Bassano en Italie pour quinze jours de permission au pays :
« Pour sûr qu’on est arrivé en France ! Ça discute déjà les ordres !
– Des balivernes, cette histoire de frein. Tous des planqués aux chemins de fer, il faut qu’ils se fassent mousser ! »
La permission de Noël
Deux mois déjà que les soldats se battent sur le front italien quand la bonne nouvelle est tombée : quinze jours de perm. à Noël ! Retrouver la famille, des semaines qu’ils en rêvent ces jeunes troufions mis à rude épreuve aux pieds des Dolomites. Tous ont une fiancée rêvée ou réelle ; tous ont une mère, certains des enfants qui les attendent. Le 12 décembre au matin, ils s’entassent dans les wagons de bois dans la petite gare de Bassano en chantant pour conjurer le grand froid, accompagnés par quelques gratteurs de mandoline. Ils traversent la plaine de Lombardie, s’arrêtant à chaque petite gare où les nouveaux bidasses sont accueillis avec de cris de joie, en se poussant encore un peu pour faire de la place. Au passage de la frontière, c’est l’allégresse ! Chacun aperçoit le clocher de son village, fut-il à des centaines de kilomètres, sûr que les montagnes sont déjà plus belles. L’air est tellement meilleur qu’on ouvre les fenêtres coulissantes pour en boire de bonnes lampées malgré le froid glacial. Un arrêt imprévu dans le tunnel du Mont-Cenis déclenche l’hilarité :
« Pour sûr qu’on a écrasé un boche !
– Ça s’arrose !
– Putain ! Nos femmes vont nous engueuler si on arrive en retard ! »
Les plaisanteries triviales succèdent aux éclats de rire.
« Descendez pas les gars, un raccord vient de péter, ce sera vite fait ! » Et les gars attendent en braillant de plus belle le nouveau départ qui doit les conduire en gare de Modane. Ils y seront à 21 h 30.
L’express civil Modane-Paris est en cours de formation. Plus d’une heure d’attente dans cette gare froide et inhospitalière ne décourage pas les poilus qui en ont vu d’autres. Et, malgré les sages conseils des gendarmes qui les exhortent à ne pas s’éloigner, ils sont des centaines à s’éparpiller dans la nature, à la recherche d’un estaminet ou d’une gentille savoyarde en manque d’affection.
23 heures. Le départ s’annonce, les esprits sont échauffés, les visages rouges, certains s’inquiètent de l’absence d’un copain. Manque à l’appel une dizaine que l’alcool a rendu amnésiques et qui vont rater le train ! « Quels couillons ! » mais le convoi ne les attendra pas. L’altercation entre le cheminot et le colonel les a amusés un moment mais maintenant ils sont pressés de partir et surtout d’arriver !
Le train de la mort
Sur dix-sept kilomètres, entre Modane et Saint-Michel de Maurienne, la pente accuse une dénivellation de trente pour cent. Le règlement est formel : il faut impérativement deux motrices pour pousser et retenir les convois et la vitesse est limitée à quarante km/h. Deux rames supplémentaires ont été rajoutées pour transporter les neuf cent quatre-vingt-deux poilus en perm. Au dernier moment Girard, le responsable du train, est averti des avaries des freins décelées dans le tunnel du Mont-Cenis. De plus, on lui annonce qu’une seule motrice est disponible, l’autre étant réquisitionnée pour un train de minutions. « C’est de la folie, de la folie… » murmure-t-il au coup de sifflet du chef de gare.
Dès le départ, la vitesse surprend les poilus les moins éméchés qui rejettent une certaine inquiétude en gueulant : « Bravo les mécanos, on y sera vite à cette allure ! Vive la France ! »
Aucun ne veut s’inquiéter des gémissements des essieux, des tampons qui se heurtent, de la vitesse qui augmente. Cent, cent-cinquante ? Les paris sont lancés.
Dans sa cabine, Girard sait qu’il est seul à se battre contre la mort, que le combat est inégal. Il serre à fond les freins qui ne répondent plus ; il renverse la vapeur. Les soupapes éclatent et le train poursuit sa descente infernale.
Dans un fracas effrayant, six premiers wagons déraillent et s’enflamment. Des grenades cachées par les permissionnaires explosent, provoquant des gerbes d’étincelles. Les soldats sortent de leur torpeur et hurlent d’épouvante. Au pont de la Saussaz, Girard comprend que la partie est finie. La première voiture déraille, l’attelage casse et à un kilomètre de la gare de Saint-Michel-de-Maurienne, toutes les autres voitures s’encastrent les unes dans les autres et s’enchevêtrent dans un bruit de ferraille assourdissant. Aussitôt, les wagons en bois s’embrasent. Une odeur de chair carbonisée inonde la nuit. C’en est fini des plaisanteries de troupiers. La mort est partout qui déchiquète, arrache, brûle, mutile, emportant toutes les espérances de Noël de ces jeunes braves qui rêvaient de dinde farcie et de draps propres.
Un rescapé de cet enfer libère sa mémoire de l’insoutenable tragédie :
« Je ne me souviens de rien… les cris de la descente, les hurlements présents… j’ai perdu connaissance. Combien de temps ? Quelques secondes sans doute. Etait-ce un cauchemar ? Mais non, tout cela est bien réel. Où suis-je ? Il fait noir, il fait froid, je me sens serré, prisonnier. C’est une main, une jambe que je ne puis dégager. Partout autour de moi, il y a ces cris affreux.
« Lentement, je comprends, je ne suis pas bloqué sous les débris du wagon, je me rends compte que j’ai la tête en bas et que je suis suspendu par les jambes. Non sans efforts, j’arrive à me rétablir et je peux me dégager, puis dans un état de demi-conscience, je franchis des obstacles, des poutres, des débris de banquette. Je marche sur des corps dans le noir, je ne sais plus. Je n’ai qu’une idée, fuir, échapper…
« Autour des décombres errent quelques rescapés égarés, abrutis. Ils regardent sans réaction. Je donne une bougie au plus valide et nous cherchons à nous porter aux endroits où les cris sont les plus distincts. Mais déjà vers la gauche, vers ce qui était la tête du train, de grandes flammes s’élèvent. Remontant la pente, le feu gagne les carcasses en quelques secondes, c’est l’enfer.
« Un mur gigantesque, une muraille dantesque, sert de fond à cette tragédie. Les wagons écrasés, empilés, forment des cages monstrueuses. La clarté des flammes révèle des corps suspendus, mutilés. Au sol, il y a des morts partout sous une couche d’éclats de bois, de ferrailles tordues, de roues fumantes. Ceux que la flamme n’a pas encore atteints regardent avec effroi brûler leurs camarades.
« “Sauvez-moi ! Sauvez-nous !” Nous tentons de dégager des corps, mais presque tous sont coincés et déjà mutilés. Quelques hommes, voyant arriver le feu, s’amputent un pied, une main avec leur couteau de tranchée, et se traînent, sanglants, sur le ballast. Mais la voie entre deux murs est un piège, les blessés ne peuvent sortir sans aide sur trois cents mètres. Le kilomètre 121 n’est qu’une gigantesque tombe.
« “Salauds ! Vous nous laissez crever !”. Des hommes, des femmes, des sapeurs-pompiers, quelques soldats sortent de la nuit, ils arrivent en courant de Saint-Michel. À la lueur du brasier, chacun tente de traîner des corps. Les actes d’héroïsme se multiplient, les amputations sauvages continuent. À la hache, pour dégager les blessés. Des cris inhumains montent dans la fumée, au milieu d’une affreuse odeur de chair brûlée. »
Secret militaire
Toute la nuit, hommes et femmes essayent de sauver quelques improbables survivants. Le plus souvent, ils sortent des amas de ferraille des cadavres mutilés qui sont déposés dans la grande salle des machines de l’usine de pâtes Bozon-Verduraz, toute proche de la gare. Cent, deux cents, puis trois cent morts s’entassent dans cette chapelle ardente improvisée. Beaucoup de blessés meurent dans le transport en ambulances vers les hôpitaux de la région, trop brûlés, trop amochés. D’autres meurent de froid, coincés dans l’amas inextricable de ferraille ; d’autres encore, qui avaient survécu aux champs de bataille, sont emportés par l’explosion d’une grenade…
Le jour se lève sur une vision apocalyptique. La carcasse du train fume toujours, des chasseurs alpins aidés par des anonymes au courage exemplaire continuent d’extirper les soldats de l’enchevêtrement des poutres.
423 seront ainsi retirés ; 135 non identifiables sont enterrés dans une fosse commune. Plus de 250 mourront dans les quinze jours qui suivirent leur admission à l’hôpital. Si aucun chiffre officiel n’a été donné, on peut évaluer à 675 soldats morts à cause de l’arrogance d’un officier trop zélé.
Le jour se lève sur Modane où une poignée de bidasses, la bouche pâteuse, émerge de leur beuverie nocturne, démoralisés d’avoir raté le train de la perm… « Quelle bande de couillons ! »
Cette catastrophe, qui aujourd’hui encore reste le plus grave accident ferroviaire de France, a été entourée de la plus grande discrétion. Les journaux ont « été priés » par les autorités militaires de garder le silence total sur ce drame. Seul Le Figaro a consacré quelques jours plus tard une vingtaine de lignes à la catastrophe de Saint-Michel-de-Maurienne.
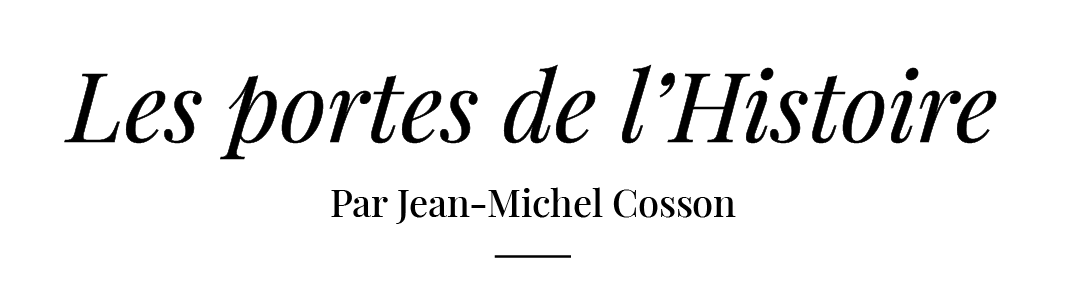
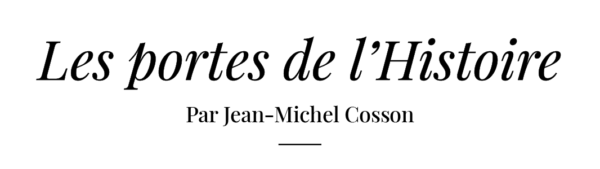
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !