Rodez. Le Roman d’une ville (3)
Rue Paraire et asile d’aliénés
La rue Paraire est une rue neuve en ce sens que son corps d’immeubles et de maisons ne date que des années 60-70, s’allongeant depuis l‘avenue Amans-Rodat naissante jusqu’à la gare éponyme. En réalité une simple halte de voyageurs après le franchissement du pont de la Gascarie. Un ouvrage d’art massif, surplombant l’Aveyron, vers lequel désormais nos regards contemporains jettent à peine un œil, trop attirés qu’ils sont par des ouvrages modernes aux lignes plus épurées.
De cette halte, un maire de Rodez, Eugène Raynaldy en l’occurrence, rêva un jour d’en faire la gare centrale reliée au centre-ville par un escalier monumental, prolongement de l’avenue Victor-Hugo. Un plan, qui gît dans les archives municipales, sera bien réalisé par l’architecte André Boyer. Un « Rodez imaginé » qui resta lettre morte !
L’intérêt de la rue Paraire est pourtant ailleurs. Dans la part de visibilité de ce qui reste et de reconstitution de ce qui ne reste plus ou presque. Le crépi orangé d’une chapelle bâtie sur un petit promontoire ouvre la voie à l’imagination de ce qui fut autrefois l’asile d’aliénés de Rodez. Petite page d’histoire.
La première pierre posée en 1838 par l’architecte Boissonnade, vingt-trois ans sont encore nécessaires pour achever tous les travaux. Maxime Porchappe, dans « Principes à suivre dans la fondation et la construction des asiles d’aliénés », écrit : « Le plan de l’asile de Rodez, commencé en 1838, par M. Boissonnade, ouvert en 1852 et non encore achevé, reproduit avec une exactitude presque parfaite l’asile du Mans dans ses éléments et dans son ordonnance. »
Quelques différences méritent pourtant d’être signalées. Chacun des cinq quartiers de classement de chacune des deux grandes divisions contient une petite salle de bains. Les pavillons du centre, qui se relient avec le bâtiment d’administration par la galerie transversale, diffèrent des autres pavillons par leurs dimensions plus petites, par leur direction parallèle à l’axe de l’asile, et contiennent au rez-de-chaussée un dortoir pour les malpropres, au premier étage l’infirmerie. Les quatre bâtiments qui sont disposés en avant et en arrière de ces deux pavillons, sur deux lignes transversales et parallèles, et qui sont destinés à loger les aliénés tranquilles, se composent chacun d’un corps principal qui contient au rez-de-chaussée deux réfectoires séparés par un office, au premier étage deux dortoirs, séparés par une chambre d’infirmiers, pour les aliénés indigents, et de deux petits pavillons terminaux qui contiennent au rez-de-chaussée une salle de bains et cinq cellules, au premier étage huit chambres pour les aliénés pensionnaires.
En 1858, l’asile compte seulement trois divisions : pensionnaires, malades tranquilles et infirmeries. Un ouvrage du docteur Renault du Motey met l’accent sur le manque d’argent, l’absence de quartiers spécifiques pour les convalescents, les agités furieux, les épileptiques et le mélange des malades. Les travaux s’achèvent en 1861.
Désormais, le vent d’ouest faisait s’envoler les cris des aliénés jusqu’au centre-ville de Rodez que les Ruthénois appelèrent « le vent des fous ».
De cette grande enceinte qui remplissait l’espace de la rue Vieussens à la rue Paraire ne subsistent que cette chapelle et quelques murs réhabilités en bureaux du Conseil départemental. Je me rappelle qu’à la fin des années 60 encore, élève au lycée Foch, nous fréquentions aux heures de détente l’immense verger de l’ancien asile, fermé pourtant depuis la fin des années 40 avec l’achèvement de l’hôpital Sainte-Marie à Cayssiols.
Dans ce système concentrationnaire de la folie, l’homme perdait sa liberté qui est toute sa raison d’être. A l’intérieur de ces hauts murs, de ces salles blanchies et dénudées, imaginons ces êtres aux visages émaciés, aux regards perdus vers des mondes inconnus, aux démarches lentes d’une vie de claustration, aux cris perçant les cloisons. Imaginons le soldat de 14-18 dit Anthelme Mangin, l’amnésique de Rodez qui défraya la chronique de l’entre-deux-guerres et dont Jean Anouilh tira une pièce de théâtre « Le voyageur sans bagages ». Imaginons encore Antonin Artaud, réfugié de la folie en pleine occupation nazie, écrivant ses « Lettres de Rodez ». L’association « Rodez-Antonin Artaud » en réhabilite chaque année le souvenir par des expositions.
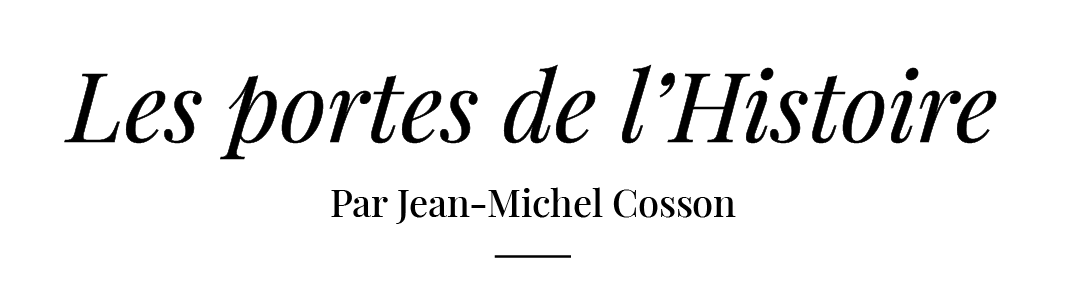
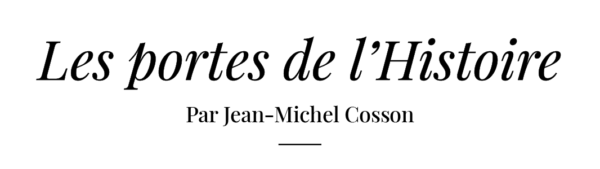
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !