Rodez. Le roman d’une ville (4)
Etrange rue Combarel (1ère partie)
Parallèle aux deux avenues (Victor-Hugo et Louis-Lacombe) parmi les plus passagères de la ville, elle s’inscrit dans le paysage urbain comme une artère de déviation que l’on emprunte uniquement par obligation, si ce n’est par résignation.
Etriquée, elle ressemble à une oasis de claustration… à une rue sans éclat architectural… cadenassée par des lieux d’enfermement : hôpital, prison et carmel qui fertilisent l’ombre, l’obscurité, le noir.
Pour autant, cette drôle d’alchimie urbaine n’a jamais privé la rue Combarel d’être un lieu d’histoires et donc de mémoires. Certes, bien loin de l’activité qui pouvait régner sur les places de la ville ou dans le quartier populaire de Saint-Cyrice mais suffisamment pour faire de cette rue un petit village en cœur de ville, selon les divers témoignages recueillis.
La période de l’entre-deux-guerres représente l’âge d’or de la rue Combarel avant de connaître un lent déclin de ses activités puis de renaître de ses cendres minérales à l’occasion de la réhabilitation urbaine que la rue connaîtra dans la seconde décennie du XXIe siècle.

Un village dans la ville
En ravivant le feu de la mémoire s’illustre une géographie de la rue Combarel bien éloignée de la trame actuelle. En remontant le temps et l’espace rejaillissent alors bruits et anecdotes qui offrent à cette artère une atmosphère particulière.
A droite, depuis l’avenue Victor-Hugo, s’élevait d’abord la gendarmerie[1], prélude pour ceux qui avaient quelque chose à se reprocher d’aller tâter, juste en face, de la prison sise dans l’ancien couvent des Capucins. « Aller aux Capucins » était alors réservé à ceux qui prenaient la fâcheuse habitude de s’y rendre, contraints et forcés.
L’hôpital Combarel occupait dans son prolongement toute la longueur droite de la rue, la privant de soleil. Dans ces bâtiments froids et austères se jouait le jeu de la mort et du hasard de la vie en un raccourci saisissant : le pavillon de la maternité – baptisé du nom du maire de Rodez Georges Subervie – laissait percer les premiers cris des nouveaux-nés… celui de l’hospice, à l’autre bout, le râle des indigents venus finir leurs vies de misère. Entre les deux, des hommes et des femmes tentaient avec patience et application d’en prolonger le cours sous l’œil bienveillant de Denis Combarel, bienfaiteur de cet hôpital qui n’est plus aujourd’hui qu’une petite cité fantôme.


Lui faisant face, comme une compassion à toutes ces résignations du cœur et de l’esprit, se dresse le carmel où des religieuses cloîtrées tentent par la prière de sauver les âmes perdues. À propos des carmélites – que Dieu pardonne ma gourmandise – je garde le souvenir délicieux des hosties pas encore consacrés qui fondaient sous ma langue et laissaient dans ma bouche ce goût de pâte farineuse si particulier. Ma grand-mère puis ma mère allaient s’y ravitailler une fois par quinzaine, n’oubliant jamais de donner des messes en guise de remerciements. Elles les ramenaient dans une poche, en vrac, dans laquelle je n’avais plus qu’à puiser.
Des souvenirs d’enfance gustatifs dont se souviennent aussi Roger Rey et Robert Aussibal. « Pour avoir du pain d’ange, se rappelle le premier, on payait un sou. C’était des pièces rondes avec un trou au milieu. C’était ouvert tous les jours. On rentrait sous le porche, sur la gauche. On montait quelques marches et il y avait un petit guichet avec une sœur-tourière. Elle remplissait de pain d’ange un morceau de journal qu’elle mettait en cône. » Même constat pour le second, impressionné par « la grille très importante du parloir qui séparait les religieuses du public ». « Moi, je mangeais le pain d’ange dans une pochette. J’en étais très friand. »
Tandis que la rive droite de la rue Combarel était entièrement colonisée par la gendarmerie, la prison et l’hôpital et que le carmel occupait une grande partie de la rive gauche, commerçants et artisans tenaient essentiellement le haut de la rue.
[1] Les deux pavillons qui jouxtent l’actuelle Mission départementale de la Culture ont été conservés.
Echoppes et enseignes
Les souvenirs fixent alors les devantures et les enseignes des échoppes qui s’égrenaient du boulevard Gally au petit carrefour marqué par l’arrivée de la rue Abbé-Bessou.
« En partant du boulevard Pierre-Benoit, sur la gauche, se rappelle Roger Rey, il y avait, avant la guerre, ce qu’on appelait le Plateau central, un organisme agricole. En revenant à droite se trouvait Cabaniols, un quincaillier. Il vendait du mobilier, des cuisinières. Un peu plus loin, le forgeron Fabre ; un tailleur, Salvagnac, et juste en dessous, la maison Soulages où se vendaient mouches artificielles, lignes et fusils de chasse. Dans la continuité, un garagiste, Oustry et Meyran, qui devait plus tard émigrer un peu plus loin. Robert Aussibal parle plutôt du garage Mathis, confirmé par le témoignage de Pierre Soulages. Leur succédait la boutique du cordonnier Aussibal. « Mon père faisait les chaussures sur mesure, se rappelle son fils. Autrement dit, il prenait la paire, c’est le cas de le dire, au pied de la chaussure. Il avait une forme en bois pour la plupart de ses clients. Des formes en bois réalisées identiquement au pied de chacun. Ces formes en bois étaient alignées avec des numéros et des noms sur la semelle. C’est lui qui avait l’honneur de chausser l’évêque de rodez. Il lui faisait les souliers de cérémonie, des souliers en satin avec une grosse boucle d’argent. La semelle était composée d’une alternance de cuir, de feutre et de cuir de manière à ce que la chaussure ne crisse pas lors de la marche. »
Puis un horloger devenu relieur, M. Séguret. Au fond de la rue Abbé-Bessou se tenait un bourrelier, M. Veyrac, et une espèce de cour… Pour Robert Aussibal, le relieur Séguret avait plutôt succédé au bourrelier Veyrac. Un relieur, selon lui, extraordinaire qui faisait de la marqueterie de cuir.
L’hôtel Moderne, tenu par M. Savy, était un lieu prisé par les gros propriétaires au moment des foires et par les artisans qui avaient pour habitude, vers 16 heures, de descendre par petits groupes une bouteille de Marcillac accompagnée d’échaudés qu’ils laissaient tremper avant de les manger.
Venait ensuite Nicolas, un marchand de vin. « Il vendait le vin en petites barriques en bois, se souvient Robert Aussibal. Il le goûtait, le faisait goûter à mon père et le lui vendait si ça lui convenait. Les barriques, il les nettoyait avec l’eau de la fontaine, avec des chaînes glissées à l’intérieur. En remuant la barrique, elles nettoyaient l’intérieur du bois. Il les rinçait puis les mettait à sécher sur les tréteaux. »
Au-dessous du marchand de vin, le café de Mme Pouget dit La Pougette. Ce café était très connu, surtout des malades de l’hôpital qui venaient de temps en temps boire un petit coup de vin. Il y avait même des aides-soignants qui partaient avec des litres de vin cachés sous le blouson pour ravitailler les malades.
« Dans la continuité, se trouvait un dépôt puis un ébéniste, M. Froment, auquel succéda plus tard un coiffeur, M. Espié. Un porche donnait sur l’imprimerie Colomb… »
C’est là où je suis né, une nuit de janvier 1957, dans un petit appartement situé juste au-dessus.
« Une échoppe de cordonnier tenue par M. Castanier, une mercerie transformée en magasin de musique tenu par Mlle Jambas et un autre ébéniste, M. Mazars permettait d’arriver à hauteur du carmel. Au fond de la rue prenaient place une épicerie puis un café qui faisait la jonction avec l’avenue. »
De ces années d’entre-deux-guerres, que reste-t-il de toutes ces boutiques d’artisans et de commerçants ? Bien peu ! Je me rappelle, de mon adolescence, les deux épiceries, aujourd’hui disparues, de M. et Mme Lacaze, face à la prison et celle de M. et Mme Canac, face à l’hôpital. C’est ici que plus tard je goûtai, quelques centimes en poche, mes premiers roudoudous et mes premiers cocos… ceux à bout rouge si possible car ils étaient gratuits, délaissant, pauvre pêcheur, les hosties du carmel.
La mercerie, tenue par Mme Bouquié, à la sortie de la rue Abbé-Bessou, a toujours pignon sur rue, dans un formidable bric-à-brac de boutons, d’aiguilles, de fils à coudre et de canevas. Une chatte n’y retrouverait pas ses petits… Mme Bouquié y règne toujours en maître, connaissant toutes les ficelles des arts du fil, prête à vous dénicher un point de croix, une aiguille à tricoter ou une broderie.
D’autres magasins prennent aujourd’hui le relais ou s’installent en prévision de la rénovation de ce quartier qui a déjà entamé sa mue.
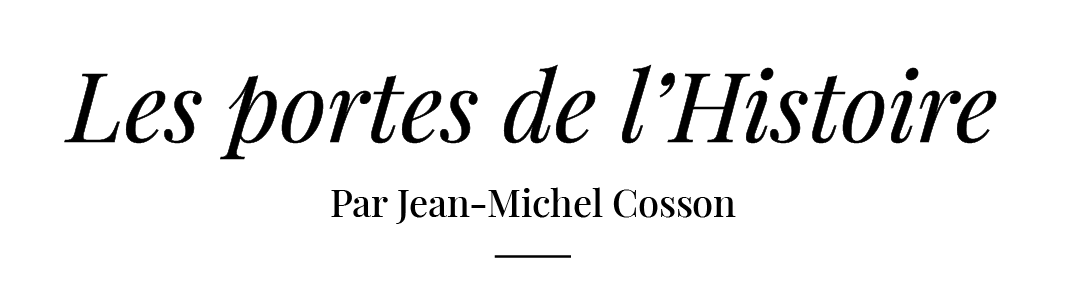
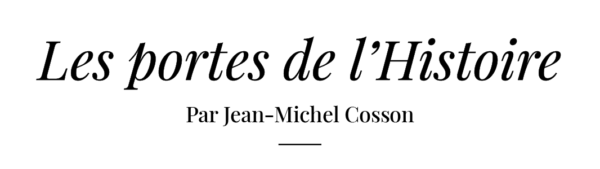
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !