Victor, le Sauvage de l’Aveyron
En ce 4 pluviose de l’an VIII, retranché dans son cabinet d’histoire naturelle de l’Ecole centrale de Rodez, au milieu des animaux empaillés et d’un fatras de collections en tout genre, l’abbé Bonnaterre était loin de se douter de l’extraordinaire découverte qui venait de se produire sur le canton de Saint-Sernin-sur-Rance, dans le sud Aveyron.
L’éminent professeur mettait la dernière main à son rapport sur la flore aveyronnaise quand, faisant irruption dans la pièce, le Journal des Débats entre les mains, l’un de ses collègues l’interpella :
-Monsieur l’abbé, un sauvage nu, se nourrissant de glands et sautant d’arbre en arbre, a été surpris à Pousthomy.
L’abbé Bonnaterre saisit le journal brandi par son ami. Deux articles y faisaient référence. L’un émanait du commissaire du gouvernement du canton de Saint-Affrique, l’autre de l’administrateur de l’hospice civil de la même ville. L’abbé les parcourut d’un trait. La nouvelle était sensationnelle. Jetant son manteau sur ses épaules, l’abbé se rendit sur-le-champ auprès du commissaire central Randon afin d’obtenir des précisions supplémentaires.
-Monsieur l’abbé, lui répondit Randon, je viens de découvrir comme vous cette histoire dans le Journal des Débats. L’administration centrale que je représente n’est pas encore informée de ce cas exceptionnel ce qui, je l’avoue, m’est particulièrement désagréable. J’écris ce jour au commissaire de Saint-Sernin. Si les faits se confirmaient, je demanderai le transfert, comment dire… de ce sauvage, à Rodez.
-Je serai ravi d’en être averti aussitôt que vous obtiendrez une réponse, répondit l’abbé. Je me tiens prêt à partir pour Saint-Sernin si vous me l’autorisez.
Trois jours plus tard, une missive parvenait à Rodez. Randon en prit connaissance. L’information se révélait bien exacte. Le commissaire s’empressa d’en communiquer le contenu au professeur.
« Citoyen commissaire, désireux de savoir à quoi vous en tenir au sujet de cet événement, voici les conditions dans lesquelles deux bûcherons capturèrent l’enfant dont on s’émeut tant depuis lors… »

Voici trois ans, le 13 thermidor an V, dans les bois proches de Lacaune, deux bûcherons aussi sains d’esprit que leurs haches étaient tranchantes, aperçurent à quelques mètres de leur coupe, un individu de petite taille, entièrement nu, qui disparut aussitôt quand il se sentit observé.
-Macarel, s’écria le premier, je ne rêve pas. Un gamin tout nu.
-Pour sûr que je l’ai vu. Aussi leste qu’un animal !
Leur ouvrage terminé, les deux hommes regagnèrent le village. A l’auberge, ils ne se firent pas prier pour rapporter leur étonnante rencontre.
-C’est comme je vous le dis. On coupait des arbres quand il a surgi dans la clairière. Au premier mouvement, il s’est enfui.
-T’aurais pas trop tiré, des fois, sur la bouteille ? brocarda l’aubergiste.
-Un vrai gamin, vous dis-je, avec les cheveux longs, et tout ce qu’il y a de plus nu.
Du reste, les deux bûcherons n’étaient pas les premiers à avoir été les témoins de cette apparition insolite. Depuis 1794, le bruit courait en effet dans la région, notamment dans les fermes situées près du col de la Bassine, qu’un être mystérieux vivait dans les bois. Des témoins affirmaient l’avoir aperçu, déterrant les pommes de terre dans les champs ou mangeant des châtaignes. Personne, cependant, n’avait jamais pu l’approcher. A l’exception des bûcherons, rares étaient ceux qui, en effet, s’aventuraient au fin fond des bois. Une mauvaise rencontre était toujours possible. Hormis les loups, qui pullulaient dans la région, les paysans craignaient les farfadets et autres êtres de la brume et de la nuit, sur le compte desquels d’étranges histoires circulaient dans le pays.
L’imaginaire se transforma en réalité quant, au printemps 1798, d’autres bûcherons découvrirent à quelques mètres d’eux un gamin tout nu qui les épiait. Abandonnant leurs haches, ils se précipitèrent sur lui. A leur grande surprise, l’enfant se laissa approcher. Mais quand ils voulurent le saisir, il les griffa et les mordit jusqu’au sang, poussant de petits cris gutturaux. Robustes, nos deux gaillards réussirent à le maîtriser. Quelques minutes plus tard, l’enfant était ficelé comme un saucisson.

Les deux bûcherons n’avaient jamais rien vu de pareil. L’être qui se tenait devant eux ressemblait bien à un humain mais tout, dans son comportement et dans son aspect physique, le faisait passer pour un animal. Ses cheveux longs et hirsutes cachaient un visage rond et agréable, laissant apparaître deux yeux noirs qui reflétaient la peur. Sa peau blanche était recouverte de crasse et tailladée de cicatrices. Les bûcherons remarquèrent aussi qu’il portait une balafre au niveau de la gorge. Ses ongles longs ressemblaient à des griffes. Enfin, malgré un genou déformé, il était agile comme un chat.
Bien que leur ouvrage fut loin d’être achevé, les deux hommes décidèrent, séance tenante, de l’emmener à Lacaune. Nul besoin de dire que le petit cortège fit une entrée remarquée dans ce gros village du sud tarnais, connu pour ses sources thermales, autour duquel tournait toute l’activité économique de la région. L’ensemble des habitants accourut sur leur passage. Virevoltant autour du sauvage, les gosses se moquaient de sa nudité. Les vieilles femmes se signaient et faisaient fuir les gamines du village. L’enfant sauvage tentait de mordre et de griffer tous ceux qui s’approchaient de trop près. Le maire de la commune, averti de cette découverte, arriva sur les lieux au moment où la foule se pressait pour apercevoir le sauvage. Il décida qu’il resterait exposé sur la place principale. Les agents municipaux se chargeraient de sa garde.
Au bout de quelques jours, la curiosité céda le pas à l’indifférence. Depuis des lustres, ces gens-là avaient l’habitude de côtoyer mendiants, vagabonds ou idiots du village, tous compagnons de misère. Il n’existait guère de place dans leurs esprits pour « le merveilleux » ou le sensationnel. La surveillance se relâchant, l’enfant sauvage profita bientôt d’un instant d’inattention de ses gardiens pour rejoindre son abri naturel.
Quinze mois s’écoulèrent avant que l’enfant ne soit à nouveau surpris par des chasseurs qui s’en emparèrent non sans mal, le diable étant agile comme un écureuil et enragé comme un chien. Emmené à Lacaune, l’enfant sauvage fut cette fois confié à une veuve, à charge pour elle de lui apprendre les règles élémentaires de la vie en société. Au bout de trois jours, elle parvint à le recouvrir d’une jupe loqueteuse dont la seule fonction était de cacher sa nudité. Pour le reste, la pauvre femme y perdit son latin et plus encore sa patience. Le gamin refusait de boire dans un verre, lapant l’eau dans un seau comme un chien. Il souillait le sol de ses besoins naturels et tournait comme une bête fauve dans la pièce, cherchant le moyen de sortir.
Après huit jours, où seul le plaisir de manger chaud des pommes de terre le retint auprès de sa gardienne, l’enfant parvint à lui fausser compagnie. Six mois durant, il erra sur les hauts plateaux des Monts de Lacaune. L’hiver 1799-1800 fut terrible. La faim et le froid le chassèrent des lieux les plus reculés. Il descendit alors vers la vallée, fréquentant les abords des fermes isolées, vers Roquecezière ou Pousthomy. Parfois, il lui arrivait de rentrer dans les maisons. Il s’asseyait alors près de l’âtre, saisissait à pleines mains les pommes de terre dans la braise puis repartait vers des endroits plus sauvages où, repus, il s’endormait. Quand le vent du midi soufflait, les paysans l’entendaient crier et rire.
Peu à peu, les habitants de la région s’habituèrent à sa présence. Lui-même ne craignait plus de fréquenter les hommes. Une nouvelle fois, des fermiers de Pousthomy le capturèrent. Une fois de plus, il réussit à s’enfuir. Ses jours d’homme libre lui étaient pourtant comptés.
Le 19 nivôse an VIII (9 janvier 1800), le citoyen Vidal, tanneur à l’entrée de Pousthomy, qui regagnait son atelier en compagnie de sa femme, surprit l’enfant assis devant l’âtre. Ayant entendu parler de lui, ces braves gens lui offrirent en guise de repas quelques pommes de terre cuites dans la braise que le malheureux avala goulûment, sans paraître craindre la chaleur.

Le voisinage averti de sa présence, on vint en foule chez les Vidal pour voir le Sauvage. C’est ainsi que le commissaire de Saint-Sernin, Constans Saint-Estève, arriva à son tour sur les lieux pour juger du degré de croyance que méritait la rumeur populaire. A sa vue, il n’hésita pas un seul instant :
-Je prends cet enfant sous ma responsabilité.
Docilement, l’enfant le suivit. Parvenu chez lui, il tenta à diverses reprises de s’échapper. En vain cette fois ! Jamais plus, il ne reverrait les bois de Lacaune !
Le lendemain, 20 nivose, le commissaire, compte tenu de l’état physique et mental de son protégé, le fit transférer à l’hospice de Saint-Affrique. Il y demeura plus de trois semaines. Entre-temps, la nouvelle de sa capture était parvenue jusqu’au chef-lieu. Le cas de l’enfant sauvage devenait désormais une affaire administrative et scientifique. C’est donc accompagné de l’abbé Bonnaterre que le Sauvage de l’Aveyron parvint à Rodez le 15 pluviose an VIII, à 3 heures du soir. Des centaines de curieux l’attendaient, massés devant l’Ecole centrale. Avec grande peine, l’enfant fut conduit dans l’enceinte de l’établissement scolaire. Exténué par le voyage et affolé par tout ce monde, l’enfant donnait à droite et à gauche des coups de dent furieux. La porte enfin franchie, il fallut la verrouiller pour empêcher que l’Ecole ne soit envahie.
Au cours de son séjour, l’abbé Bonnaterre ne cessa d’étudier son comportement. Il en conclut que le gamin n’était pas dépourvu d’intelligence. Son caractère s’adoucissait même pour peu que l’on s’occupât de lui.
-Regardez ! fit un jour observer l’abbé Bonnaterre au citoyen Rodat d’Olemps, ancien député aux Etats Généraux du Rouergue. Si on le contrarie, il agite bras, jambes et tête. Il porte les poings sur les yeux et pousse des cris qui annoncent un grand dépit.
Tout au long de sa captivité à l’Ecole centrale, l’administration départementale s’activa pour rechercher son identité et les raisons de son abandon. Car, au-delà de sa découverte, se posaient les mystères antérieurs de son enfantement, de son abandon et de sa survie dans un milieu particulièrement hostile.
Les enquêtes de proximité n’apportèrent guère de renseignements. Seules des hypothèses furent émises, plus ou moins colportées par des bruits sans fondement et par la rumeur publique. On évoqua la présence d’une tribu sauvage inconnue, dans les bois de Lacaune. D’autres prétendirent que si l’Enfant Sauvage avait survécu dans ce milieu infesté par les loups, c’est qu’il avait été adopté par une meute et nourri par une louve. Certains suggérèrent que le Sauvage pourrait bien être le second fils de Louis XVI, héritier du trône, laissé pour mort dans les bois par les révolutionnaires. Plus sérieusement, Constans Saint-Estève, qui s’intéressa de près au cas de l’Enfant Sauvage, estima qu’il ne pouvait s’agir que d’un cas banal d’abandon, soit par des parents poussés par la misère, soit parce que l’enfant était le fruit coupable d’un amour impossible, soit parce qu’anormal, des parents indignes avaient désiré s’en débarrasser à tout prix. Un indice venait étayer cette dernière hypothèse. L’enfant portait une cicatrice profonde à la gorge. Sans doute avait-il été égorgé avant d’être laissé pour mort. Des feuilles mortes auraient agi comme pansement.
Une question demeurait cependant sans réponse ! Comment diable un petit bout d’homme, handicapé mental et physique de surcroît, sans doute âgé de six ans au moment de son abandon, avait-il pu résister au froid, à la faim et aux loups ? Il est des questions que la raison ne peut expliquer !
Malgré les soins qui lui furent donnés, malgré les actes de tendresse que l’abbé Bonnaterre lui prodigua, un besoin irrésistible poussait l’Enfant Sauvage à s’enfuir. A diverses reprises, les gendarmes le récupérèrent assez loin de Rodez, cherchant un repère dans un milieu inconnu de ses sens.
La nouvelle de la capture d’un enfant sauvage était très tôt parvenue dans les salons bourgeois de la capitale, nourris à la pensée rousseauiste. Paris, à son tour, désirait le connaître et voir de quel bois il était constitué. Le jour arriva donc où l’abbé Bonnaterre fut convoqué chez le commissaire Randon.
-A la demande du ministre de l’Intérieur, l’enfant doit être transféré à Paris. Vous serez chargé de sa protection.
-Il fallait bien que ce jour arrive depuis que la nouvelle a provoqué de toutes parts un intérêt croissant.
-Vous partirez le 12 juillet.
Le voyage fut long et difficile. L’abbé, entouré de quelques soldats, dut à chaque halte soustraire son protégé à la curiosité publique. Les routes n’étaient pas sûres et mal carrossées. Quand il ne tentait pas de s’échapper, l’enfant fixait avec envie les forêts traversées par la berline.
A Paris, l’abbé et son protégé furent accueillis à l’Institut des Sourds et Muets par l’abbé Sicard. Savants et curieux se succédèrent pour l’examiner ou le découvrir. Exposé en divers points de la capitale, le Sauvage (baptisé Victor) devint en quelques jours la coqueluche du Tout Paris. Il fut même le héros de trois pièces de théâtre.

Quand il n’était pas exhibé dans les salons mondains, l’Enfant Sauvage était soumis à diverses séquences expérimentales pour étudier son comportement et tenter de le faire progresser. Dès le départ, l’abbé Sicard le considéra comme un idiot irrécupérable. Le docteur Itard, auquel il fut confié, entreprit d’éduquer cet enfant qui ne s’exprimait qu’en fonction de ses besoins immédiats. Il obtint au départ quelques résultats mais, après cinq années d’efforts et de patience, il renonça et le confia à sa servante, Mme Guérin qui, avec beaucoup d’humanité, s’en occupa jusqu’à sa mort. Les Parisiens, eux, s’en étaient lassés depuis bien longtemps. Ce sauvage de l’Aveyron les avait déçus. Il leur ressemblait trop. Il les dépassait même en beauté naturelle. Eh quoi ! On leur avait promis un sauvage. On ne leur offrait qu’un être humain, seulement privé de la parole et d’intelligence. Le cas était loin d’être unique.
L’Enfant Sauvage fut donc oublié dans un Institut aux murs si hauts qu’ils lui cachaient l’horizon : celui qui rejoignait les bois de Lacaune qu’il rêvait de retrouver.
Victor de l’Aveyron mourut en 1828, à l’âge de quarante ans, dans l’appartement de Mme Guérin, 4, impasse des Feuillantines. Il n’intéressait plus personne.
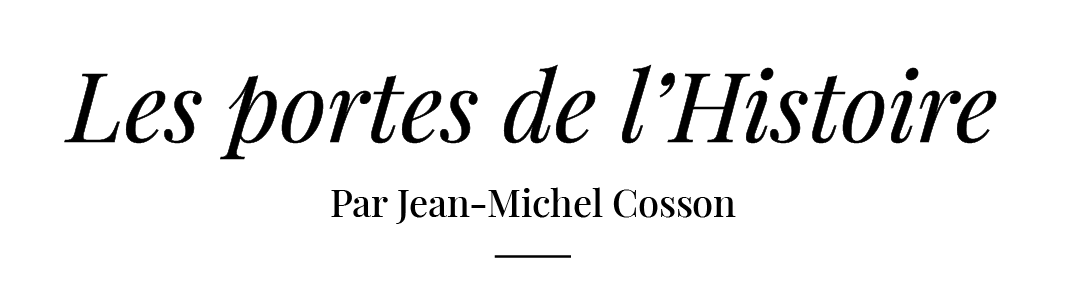
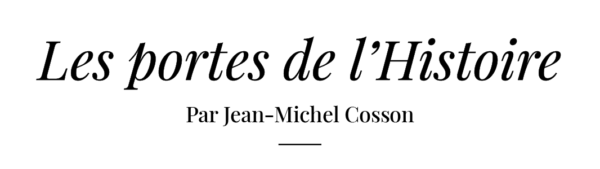
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !