Salsou. Un Saint-Affricain tente d’assassiner le chah de Perse
« Imaginez-vous que vous êtes venu au monde malheureux, que vous êtes devenu chef d’une famille de miséreux, et que, tout à coup, on vienne vous promettre d’être l’égal de votre patron qui vous fait travailler, que vous allez avoir votre part égale de soleil et de liberté, n’auriez-vous pas redressé la tête et accueilli avec gratitude de semblables promesses ? Et quand vous auriez vu que ces promesses n’étaient que trompeuses, votre exaspération n’aurait plus connu de bornes… »
Si, ce 26 avril 1892, dans une salle d’audience bondée jusqu’à la gueule, la plaidoirie de Me Lagasse résonna comme un avertissement aux oreilles des juges et des jurés, elle parvint surtout à sauver la tête de Ravachol. Du moins provisoirement, puisque deux mois plus tard, la Cour d’assises de la Loire, moins généreuse, confiait à Anatole Deibler, l’exécuteur en chef, le soin de le faire passer de vie à trépas.
Cinq années plus tôt, un autre anarchiste, Clément Duval, aurait pu connaître un sort similaire si « le père Gratias », en l’occurrence le président de la République, Jules Grévy, ne l’avait justement gracié, conscient que pour un simple vol de bijoux, la note était un peu salée et ne méritait pas que la guillotine sorte de sa demeure.
En fait, personne n’avait compris que la méthode employée par Ravachol, pour aveugle et minoritaire qu’elle fût, n’était que le signe d’une profonde fracture poussant au désespoir ceux qui refusaient d’être laissés sur le bord du chemin de la prospérité au profit de ceux qui recevaient les dividendes de la croissance, dont la richesse et les ambitions se mesuraient à hauteur du sommet de la Tour Eiffel, symbole de la réussite industrielle française. Et tant pis si le scandale de Panama vint jeter l’opprobre sur la classe des nantis à laquelle appartenait la plupart des parlementaires. Le peuple faisait contre mauvaise fortune bon cœur en renouvelant leur confiance électorale à ceux qui les spoliaient.
Devant tant d’injustices et de naïveté populaire, les illuminés de la nitroglycérine décidèrent de faire parler la poudre. De 1892 à 1894, Paris vira au feu d’artifice et au rouge sang. L’anarchie honorait ses martyrs par d’autres martyrs. Successivement, Meunier, Vaillant et Emile Henry expédièrent sans remords leurs machines infernales dans les devantures de cafés et de restaurants parisiens, vengeant les pertes et profits des gouvernants par la mort de quarante et une personnes.
Cette série d’attentats culmina en 1894 avec l’assassinat, par Casério, du président de la République, Sadi Carnot. Les anarchistes faisaient la une des quotidiens nationaux, donnant du fil à retordre aux fins limiers de la police de sûreté -dont le célèbre Jean-Michel Goron,- avant de remplir les prétoires des Cours d’assises, qu’ils érigeaient en tribune de propagande.
Touché dans sa chair, le pouvoir régla la question de la fracture sociale en invitant juges et jurés à faire tâter du couperet de la Veuve aux poseurs de bombes. Anatole Deibler n’avait pas fini de démonter la compagne de ses tristes œuvres que, déjà, les bourgeoises parisiennes trempaient leurs mouchoirs dans le sang des suppliciés, en guise de porte-bonheur.
Toutes ces têtes coupées eurent pour effet de calmer les esprits. Conscients d’avoir fait fausse route en s’aliénant une population hostile aux attentats aveugles et désespérés, les anarchistes se réfugièrent dans une pratique qui, dans l’Histoire, avait depuis longtemps fait ses preuves. Marchant sur les traces de Mandrin, Cartouche et autres seigneurs du brigandage humanitaire, les anarchistes désirèrent à leur tour se payer la tête de l’Etat en imprimant fausses monnaies et faux papiers. Une recette propice à se mettre dans la poche tous ceux qui considéraient que l’Etat, grand argentier de la Nation, était avant tout le plus grand des voleurs.
Au sein de cette confrérie, Emile Pouget faisait, plus que les autres, apprécier la couleur de son vocabulaire, dans les pages de son journal, le Père Peinard, qu’il avait lancé en 1889 après avoir purgé une condamnation à huit ans de prison. Né à Pont-de-Salars en 1860 mais monté à Paris à l’âge de seize ans pour travailler et vivre d’aventures, Emile Pouget annonçait en exergue du Père Peinard : « Sous ce titre, chaque semaine, le gniaff-journaleux publie ses réflecs où il ne mâche pas leurs vérités aux jean-foutre de gouvernements et de patrons. Le numéro contient seize pages de tartines et coûte deux ronds ».
Exilé en Angleterre en 1893, après les lois scélérates visant les anarchistes, Emile Pouget se constitua, pour subsister, un petit pécule, ramassé en grugeant un collectionneur. C’est du moins ce qu’indique un rapport sur l’anarchisme, rédigé par le commissaire parisien Moreau : « Pilotell, dessinateur connu et collectionneur monomane, acheta de très bonne foi à Pouget et à ses associés des dents qu’on lui prétendait comme ayant appartenu à Ravachol et qui avaient été tout simplement extraites d’une tête de mort achetée chez un brocanteur de Dean Street. Ces molaires furent payées très cher par le collectionneur. On ne s’arrêta pas là. On fabrique pour la circonstance des autographes de Marat, Danton, de Robespierre, etc… Pouget gagna pour sa part à ces petites opérations L80 (soit 2000 F) et se hâta d’en consacrer une partie à la création d’on ne sait quelle feuille de chou ».
Revenu en France l’année suivante, Emile Pouget s’investira dans l’anarcho-syndicalisme prenant, en 1900, la direction de la Voix du Peuple, organe de la C.G.T.
Si les attentats cessèrent en France, par la faute ou par la grâce d’une guillotine bien plus persuasive que les bombes, ce n’était pas le cas hors des frontières hexagonales où les rivalités politico-religieuses se terminaient souvent dans un bain de sang.
En Perse, au milieu du XIXe siècle, le courant religieux babiste appelait de ses vœux un islam plus libre et plus égalitaire, parlait de paix et de justice universelle, préconisait l’unité de toutes les religions dans l’amour de Dieu, se prononçait en faveur de l’égalité des sexes et de la dignité des femmes, révélant une interprétation du Coran diamétralement opposée à celle du clergé officiel. Un programme qui eut le don d’exaspérer le chah, Nasir ed-Din. En 1847, il s’offrit sa petite Saint-Barthélemy en ordonnant le massacre de tous ces empêcheurs de tourner en rond dans le Coran. Pour se faire plaisir, il fit ensuite juger leur chef, Mirza Ali Mohamed, dit le Bâb, avant de le faire fusiller, ce qui le rendit encore plus joyeux.
Mais les babistes sont gens rancuniers. Et patient, avec ça ! Ils attendirent 1896 pour lui rendre la monnaie de sa pièce, en l’occurrence un coup de poignard qui le laissa raide mort sur le pavé de Téhéran. Les babistes retrouvèrent le sourire tandis que leurs adversaires pleuraient leur souverain, en se demandant bien à quelle sauce ils allaient à leur tour pouvoir les manger. La vengeance est un repas sans fin qui, dit-on, se mange froid !
Les rapports franco-persans n’étaient pas seulement du domaine de l’attentat. Depuis une décennie, les fils de bonne famille s’initiaient à Paris à la culture française, avec pour mission de ramener au pays le meilleur et de nous laisser le pire, ce qui n’était pas la manière la plus polie pour nous remercier de les avoir accueillis.
Le nouveau chah, Mouzaffar ed-Din, se piquait lui-même de curiosités occidentales au point d’entreprendre, en 1900, un voyage en Europe, de Saint-Petersbourg à la Tour Eiffel. Avant d’être reçu en grandes pompes dans la capitale parisienne, le chah et sa suite s’arrêtèrent à Contrexeville pour prendre les eaux. Incognito ! Si tant est que l’on puisse passer inaperçu à parader dans des costumes étincelants de diamants, d’émeraudes, de rubis et de perles répandus à profusion. Pour la circonstance, l’habit faisait bien le moine ! Pas étonnant que Paris désirât lui dérouler le tapis rouge pour l’accueillir. Il en allait de l’influence française dans une région où les Anglais possédaient depuis longtemps la main-mise et comptaient bien la garder.
Avec sa moustache avantageuse, l’air affable et accueillant pour ses amis, Mouzaffar ed-Din appréciait d’être ainsi courtisé dans des réceptions où se pressait tout ce que Paris comptait de banquiers, d’industriels, d’anciens et de nouveaux riches.
Mais les Français sont décidément d’incorrigibles farceurs. Alors que le chah visitait Paris dans sa voiture particulière, le Kadjar accroché au ceinturon, un inconnu grimpa sur le marchepied et braqua son arme de la main droite, à bout portant, sur la poitrine du souverain. Par chance pour le chah, le revolver s’enraya. L’inconnu fut maîtrisé. La veille, les services du chah avaient été avisés qu’un attentat était prémédité contre le souverain. La lettre, datée de Naples du 30 juillet, avait été mise à la poste à Paris. On y déclarait qu’un complot était tramé contre le chah, et qu’il devait périr sous le fer d’un farouche anarchiste, ami de l’assassin du roi d’Italie qui venait de mourir dans un attentat. Cette missive était signée Angelo Bartolozzi, 9, rue d’Orvieto, à Naples. Bien sûr, personne de ce nom n’habitait à l’adresse mentionnée.
Qui était donc cet inconnu qui faisait injure aux règles de l’hospitalité française et se permettait de mettre en péril les efforts de la diplomatie française ?
Interrogé dans les locaux de la police, il reconnut s’appeler Salson et être né à Saint-Affrique, dans l’Aveyron. Renseignements pris auprès de l’état civil, son véritable nom s’avéra être Salsou, ce qui valut une réplique pleine d’humour de l’anarchiste à l’adresse du juge :
« Jusqu’à présent, on m’avait appelé Salson ; vous me dites que je me nomme en réalité Salsou. Eh bien ! j’aime mieux ça : Salsou, ça veut presque dire Sans-le-Sou et ça a toujours été à peu près mon cas.
Rien ne prédisposait Salsou à devenir régicide. Fils d’une famille modeste, le jeune Saint-Affricain suit les cours de l’école communale de la ville, de 1881 à 1888, avant de rejoindre les bancs des Frères des écoles chrétiennes où il obtient, en 1889, le certificat d’études. A quatorze ans, ses maîtres le reconnaissent comme l’élève le plus laborieux, le plus intelligent, le plus instruit et le plus sage de l’établissement, quoique certains aient perçu chez lui un certain art de la dissimulation. Salsou était-il une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde, docile en façade mais rempli de colère intérieure ?
Recommandé par l’établissement confessionnel, Salsou entre, l’année suivante, au conservatoire des hypothèques de Saint-Affrique. Tout ira bien jusqu’au jour où son patron le surprend à lire des ouvrages de Proudhon, l’un des théoriciens de l’anarchisme.
-Pas d’ça chez moi, lui fit comprendre son employeur.
Proudhon et Salsou se retrouvèrent à la rue. Le Saint-Affricain qui, dit-il, « aimait son indépendance », se rend ensuite à Montpellier puis à Alger où il travaille deux années, ses employeurs n’ayant qu’à se louer de ses services. Ses idées anarchistes, qu’il cultive intérieurement, l’ont suivi au-delà de la Méditerranée. C’est avec joie qu’il apprend la vague d’attentats du début des années 1890 et l’assassinat du président Sadi Carnot.
Le 15 juillet 1894, il s’embarque pour la France, file à Lyon où il est arrêté pendant dix jours, avant de gagner la capitale. Ses opinions ne passent pas inaperçues aux oreilles des habituels mouchards. Mis à l’ombre pour quelques mois en vertu des lois répressives sur l’anarchisme, Salsou se livre dans la prison de Fontainebleau à une active propagande. Dénoncé par son compagnon de cellule, un mouchard nommé Lapierre, il écope de quelques mois supplémentaires.
Etrange revirement de situation, l’année suivante (1895), quand Salsou s’engage dans l’armée. Il en ressortira quatre ans plus tard avec un certificat de bonne conduite.
-Vous sembliez donc, lui demandera le Président de la Cour, avoir renoncé à vos idées ?
-A ce moment, répondra Salsou, j’étais le défenseur de la France ; maintenant, je suis soldat de la Révolution et je combats les oppresseurs des peuples.
Condamné une seconde fois pour propos anarchistes dès sa démobilisation, Salsou ressort au mois d’octobre 1899 et vient habiter Paris, rue Debelleyme, au 17. Le voisinage n’a pas à se plaindre de cet ouvrier sobre, qui ne sort jamais et ne fréquente personne. Son seul loisir est de lire les journaux anarchistes dont il se gave après le travail. C’est dans leurs pages qu’il épanche sa soif de colère et trouve la confirmation de ses idées anarchistes. Pourtant, Salsou est un loup solitaire, qui ne fréquente pas les milieux anarchistes et n’appartient à aucun groupe. Sa sœur, qui lui écrit régulièrement, s’inquiète d’ailleurs de ce feu qui le ronge de l’intérieur : « Je lis tous les jours les journaux pour voir si tu ne t’es pas fait assassiner ou si tu n’es pas devenu assassin toi-même ».
L’assassinat du roi d’Italie provoque chez Salsou une immense joie.
-Je ne pouvais pas être désolé de la mort d’un ennemi de l’anarchie, déclarera-t-il plus tard, au cours de son procès.
Mieux encore, Salsou est désormais convaincu qu’il est temps, pour lui, de passer à l’acte et de frapper un grand coup. Au lendemain de l’attentat manqué, un journaliste de l’Illustration dira de Salsou « qu’il est le type achevé du maniaque dont une violente commotion aggrave subitement la fêlure cérébrale. Ici, la commotion a été produite par la nouvelle de l’assassinat du roi d’Italie. Alors, sous le choc, la manie de l’imitation et la gloriole aidant (les tristes lauriers de Bresci empêchant Salsou de dormir), l’idée fixe qui courait s’est faite jour complètement : tuer un souverain. Et le chah étant le seul souverain qui se trouvât à sa portée, l’homme a résolu de tuer le chah ».
En réalité, Salsou a projeté, au départ, d’assassiner Casimir Perrier, le pourfendeur de l’anarchisme.
-Casimir Perrier, affirmera Salsou, avait fait beaucoup de mal aux anarchistes ; il était président du conseil quand les lois dirigées contre eux ont été votées.
Les deux semaines suivantes, Salsou échafaude son plan, n’en parle à personne et observe les allées et venues de sa future victime. Enfin, le 16 juillet, il se décide. Armé de son revolver et de plusieurs cartouches, Salsou se rend à Pont-sur-Seine, se fait indiquer le château de Casimir Perrier et s’embusque derrière une haie. L’attente durera quatre heures. En vain ! Casimir Perrier ne se montrera pas une seule fois. Dépité par cet échec, Salsou rentre à Paris. Dans sa chambre, il cherche un autre moyen « d’attirer l’attention sur l’idée anarchiste ». Chose inhabituelle : Salsou se met à sortir le soir. Pourquoi ? L’anarchiste refusera toujours de le dire. Sans doute se renseigne-t-il sur les habitudes de ce chah de Perse dont parle toute la presse parisienne. Car Salsou a bel et bien décidé de tuer le chah !
Le 2 août, il passe à l’acte, avec, à la clé, l’échec cuisant que l’on connaît.
Son procès s’ouvre devant la Cour d’assises de la Seine, le 10 novembre 1900. Vêtu comme un ouvrier, Salsou ne présente pas, dans son box, l’aspect d’un révolutionnaire farouche. Sa figure osseuse et maigre, les pommettes saillantes de ses joues offrent au public et aux jurés la dureté de sa vie. A la place de la Défense s’est assis Me Lagasse, celui-là même qui avait sauvé une première fois la tête de Ravachol.
De l’acte d’accusation, il résulte que Salsou était hanté depuis longtemps par l’idée de tuer quelqu’un ; « d’abord, il songea à M. de Rothschild, puis ce fut M. Casimir Perrier, enfin le chah de Perse. Toute la journée du 31 juillet, l’accusé fit le guet devant la porte de l’hôtel des souverains. Il y a donc bien eu préméditation ».
Tout au long de son interrogatoire, Salsou ne cherchera pas de faux-fuyants pour tenter d’atténuer son acte. Avec calme, d’une voix basse et souvent embarrassée, il reconnaît la matérialité des faits qui lui incombent.
-Votre préméditation est indiscutable, questionne le Président.
-Je ne le nie pas.
-Pourquoi avez-vous commis cet attentat ?
-Parce qu’à mes yeux, répond Salsou, il était la plus haute personnification de la richesse, c’est-à-dire de la tyrannie sociale. J’ai dit que je ne regrettais pas ce que j’avais fait. Je suis heureux que mon attentat se soit produit sans effusion de sang. Je voulais seulement impressionner l’opinion publique. L’effet moral a été produit.
Le Président évoque ensuite l’attentat proprement dit et la manière dont Salsou a braqué le chah avec son arme.
-Un agent assure que le revolver était appuyé contre les vêtements du chah quand vous avez tiré ?
-Ce n’est pas vrai, s’exclame Salsou.
-A quelle distance était-il ?
-A 12 ou 15 cm !
-Quoi qu’il en soit, c’était à bout portant. Vous avez dit alors au ministre de la Cour : « Dites bien à votre maître de démissionner, car nous l’aurons ». Qui nous ?
-Les adeptes de l’anarchie.
-Pourquoi n’avez-vous pas tiré un second coup de revolver ?
-J’ai été désarmé immédiatement.
Le Président en vient aux défectuosités du revolver. Le chien, d’après les experts, aurait été limé. Salsou déclare qu’il n’en savait rien. A la demande de Me Lagasse de mener une contre-expertise en utilisant les cartouches restantes, le Président estime qu’il est trop tard à cet instant du procès.
A 15 heures, l’audience est suspendue. Treize témoins défilent ensuite à la barre. Le général Parent raconte la scène de l’attentat. Les médecins aliénistes Garnier et Wallon déclarent que la responsabilité de Salsou est entière, ce qui a tendance à réjouir l’accusé, qui a refusé, durant tout le procès, les allégations le présentant comme atteint de dérangements cérébraux.
Salsou ne réagira qu’aux affirmations d’un agent.
-Le revolver de Salsou touchait les vêtements du chah, M. le Président.
-J’affirme, s’insurge Salsou, que mon arme n’a pas touché la victime.
Le réquisitoire de l’avocat général, Me Lambersat, sera sans concession.
-Salsou est responsable. C’est au jury à remplir sa tâche et à peser sa décision en raison de la multiplicité des attentats et de la nécessité d’y opposer une défense énergique.
Haussant le ton, il se tourne vers les jurés.
-Vous pèserez toutes les conditions de ce procès et vous réfléchirez que si pendant quelques années on a joui de la tranquillité anarchiste, c’est aux différents jurys qu’on le doit.
Me Lagasse est un des ténors du barreau parisien. Il rappelle que Salsou a dit qu’il avait hésité à tuer le chah parce qu’il était l’hôte de la France mais qu’il s’y était décidé parce qu’il y a vu dans les journaux le récit de l’aventure d’Orientaux que la police avait empêché d’entrer à Paris. L’avocat terminera sa plaidoirie en priant le jury d’acquitter ce malheureux qui a déjà tant souffert.
Un quart d’heure suffira aux jurés pour répondre par l’affirmative à toutes les questions relevant de la culpabilité de Salsou, tout en lui accordant les circonstances atténuantes. L’anarchiste ne bronche pas à la lecture du greffier et à l’application de la peine.
-Je n’ai rien à réclamer, murmure-t-il.
Après cinq minutes de délibération, le Président et la Cour condamnent Salsou aux travaux forcés à perpétuité.
Reconduit après le prononcé du jugement dans sa cellule de la Conciergerie, Salsou ne fera entendre aucune plainte, aucune protestation contre l’arrêt terrible qui le frappait. Avec un sang-froid remarquable, Salsou affichera une déconcertante sérénité.
Son pourvoi en cassation et l’intervention de Me Lagasse auprès du président de la République ne changeront rien à la sentence. Salsou s’en ira tâter des fers au bagne, ce qui n’empêchera pas les anarchistes, la bande à Bonnot notamment, de reprendre, quelques années plus tard, le flambeau.
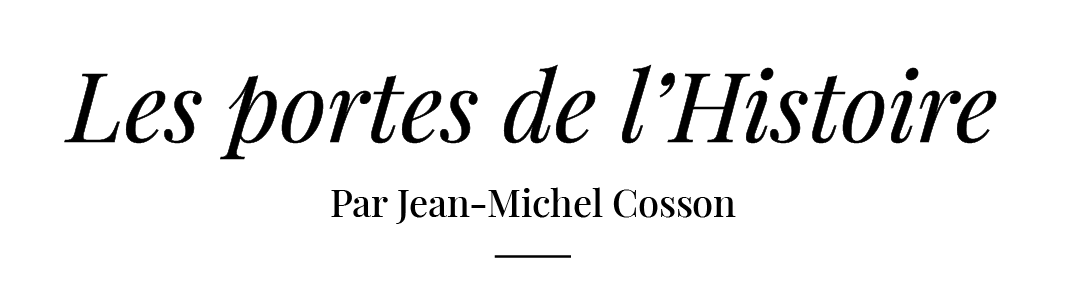
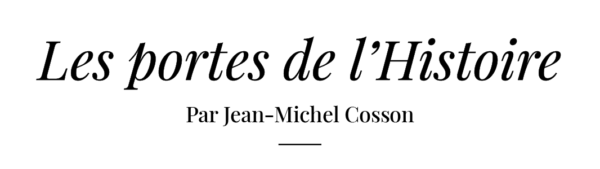
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !