Dans l’univers sanglant du fait divers (Petite histoire du crime en Aveyron)
Parmi les faits divers, « ces fourre-tout des inclassables de l’information » selon Roland Barthes, les crimes ont toujours suscité un vif intérêt au sein de nos sociétés, toujours enclines à célébrer ses passions morbides sur des hommes et des femmes ayant, pour des causes diverses, emprunté un jour les chemins de l’inadmissible sans calculer les conséquences de leurs actes.
Ordalie et cruentation
Au Moyen Age, la justice criminelle était répartie entre l’autorité royale, seigneuriale (laïcs et ecclésiastiques) et municipales pour les villes qui avaient obtenues des franchises. Les organes judiciaires étaient alors fort divers, comme le précise le professeur Carbasse dans une étude sur la justice criminelle en Rouergue :
« Il y avait d’abord les juges du roi. A partir de la fin du XIIIe siècle, ils constituent en Rouergue une hiérarchie, placée sous l’autorité du sénéchal (lui-même dépendant du Parlement). Le sénéchal du Rouergue siégeait normalement à Villefranche, mais il se déplaçait périodiquement dans les principaux lieux de sa circonscription pour tenir des “ assises ”. Au-dessous du sénéchal siégeaient dans toutes les villes royales des juges royaux inférieurs appelés “ bailes” (plus tard baillis) et chargés du premier degré de la justice. Le plus souvent ces bailes ne jugeaient pas seuls mais ils étaient assistés, selon des modalités diverses, par des habitants du lieu. C’étaient parfois de simples “ prud’hommes”, comme à Saint-Affrique ou Espalion. Dans d’autres cas, c’étaient des représentants de la municipalité : ainsi, à Najac, Villefranche, Saint-Antonin, les consuls avaient la qualité de “ juges criminels” ; ils rendaient la justice au nom du roi sous la présidence du “baile”.
Que dire aussi de la procédure pénale si ce n’est qu’elle évolua d’un système accusatoire (plainte doit être déposée par la victime contre l’accusé pour être retenue) à un système inquisitorial au XIIIe siècle (point n’est besoin de preuve pour enquêter sur une personne).
Pour prouver la culpabilité d’un accusé, les juges utilisaient une panoplie de procédés dont l’absurdité le disputait à l’irrationnel. Ainsi, l’ordalie consistait à plonger un accusé dans de l’eau froide bénite. S’il surnageait, c’est donc qu’il était coupable. Encore plus incertaine était la pratique de la cruentation, pratique encore en vigueur au XVIIe siècle en Rouergue. Il s’agissait de présenter les suspects devant la victime et de les faire tourner l’un après l’autre autour du cadavre. Si le corps se mettait à saigner, le malheureux se trouvait tout désigné. C’est le triste sort que subit un pauvre bougre du village de Saint-Jean-des-Balmes, accusé en 1640 de l’assassinat du curé, retrouvé mort au fond d’un aven.
Une vraie loterie que cette justice médiévale qui n’était pas non plus avare de pratiques corporelles inhumaines. Ainsi de la « question », exercée sur les suspects pour qu’ils avouent leurs forfaits. Le silence pouvait aussi avoir force d’aveu. Pensons à cette pauvre millavoise, accusée de sorcellerie en 1445, qui fut soumise à la question des « pieds au feu » avant de mourir dix jours plus tard sans avoir craché le morceau.
Les peines encourues n’avaient rien à envier à ces pratiques. Les mutilations (main, pied ou oreille) étaient courantes pour les voleurs alors facilement reconnaissables. Les peines infamantes du pilori et de la course à travers la ville, sous les quolibets de la foule, correspondaient à la volonté du pouvoir de faire des exemples. Il en allait de même des exécutions publiques, soit par noyade, soit sous la forme d’un bûcher purificateur, notamment pour les affaires de sorcellerie, soit par pendaison aux fourches patibulaires.
Du XIIIe siècle et ce jusqu’au XVIIIe siècle, la répression s’accentua donc en même temps que la justice se faisait de plus en plus arbitraire.
Rouergue meurtrier et crimes impunis
L’impuissance du pouvoir central à imposer son autorité, ajoutée au manque d’efficacité des agents du Roi ont longtemps autorisé les plus nobles sujets de sa majesté à se faire justice eux-mêmes, les armes à la main et la vengeance rivée au cœur. La qualité de leur rang leur permettait de régler par le fil de l’épée les questions d’honneur et les vengeances sans trop se soucier de la justice, comme le démontrent les exemples suivants, relevés dans les archives par l’historien Combes de Patris.
En 1580, le lieutenant du cardinal d’Armagnac, Guillaume de Patris, trouva une mort affreuse à Bédarrides entre les mains des sbires à la solde du pape Grégoire XIII, ainsi que le rapporte avec force détails l’un des amis de la victime, Nostradamus en personne qui, en l’occurrence, aurait pu se fendre d’une de ses prévisions dont il a, soi-disant, le secret.
« Ce pauvre infortuné prélat qui ne s’attendait à rien moins qu’à recevoir un tel et si perfide accueil de celui qu’il estimait son singulier et particulier amy, se trouva tellement descoupé qu’on trouva sur sa personne, après l’avoir despouillé, deux grands coups de coutelaz sur le visage si outrageusement deschargés que les cervelles lui sortoyent hors de la teste, l’un traversant du front et des tempes jusques au dessus de l’œil droit ; l’autre à travers de l’oreille gauche et de la joue, pénétrant dans les mouëlles. Il avait un coup de poignard sur le téton gauche et deux à la mamelle droicte, qui le perçoient tous trois à jour, avec une quatrième playe bien enfoncée dans le creux de l’estomach. Le bras droit presque mis en deux, le sénestre ouvert de deux pistoletades, et en somme tout son corps gasté, honny, brisé et meurtry de la fouleure des chevaux, si bien que l’empreinte des fers se voyaient en plusieurs lieues. »
Quelques années plus tard, le 2 février 1597, Jean de Morlhon, baron de Sanvensa, connut un sort similaire, deux mois seulement après son entrée solennelle à Villefranche comme sénéchal. Sous le prétexte que Jean de Morlhon s’était emparé des clefs de la ville et avait destitué les anciens consuls pour en nommer de nouveaux, une troupe furieuse, braillant toute sa haine envers l’ancien chef de la Ligue en Rouergue, se précipita à son hôtel pour le massacrer. « Ayant forcé les portes, la foule entra et le trouvant tout seul, en parlementant il feust blessé au cou d’ung pistolet et à l’estomach d’ung coup de pertusane. Et estant ainsi blessé, il gaigne un pied le long d’une allée au bout de laquelle treuva une fenestre, sauta dans le jardin et print la fuite vers la ville, étant toujours poursuyvi. Et quand il feust arrivé au devant de la maison de monsieur Vitrac, treuva un grand fumier et s’appuyant sur iceluy, rendit l’âme à Dieu. »
La foule avait agi sous les ordres du lieutenant principal d’Ambès. Ce dernier ne devait pas l’emporter au paradis ou, du moins, en empruntant une voie détournée. Quatre mois plus tard, il succombait sous les coups de pistolet de la mère de Jean de Morlhon.
Les relations adultères déclenchaient aussi des vagues de vengeance criminelle terribles dont les femmes étaient les principales victimes. Ce fut le cas de madame de la Tour de Reniez, née de Panat, surprise en flagrant délit et égorgée dans le lit du vicomte de Paulin. Tenue pour morte alors qu’elle n’était qu’en léthargie, elle fut réveillée par ses serviteurs venus la dépouiller dans son tombeau. Bien leur en prit ! La dame était enceinte et accoucha quelques temps après d’un garçon.
Les justices locales impuissantes à juguler la violence et à condamner les coupables, le pouvoir royal mit en place des assises extraordinaires, les Grands Jours, au sein desquelles les commissaires étaient armés d’une autorité redoutable. En pure perte toutefois, les coupables, le plus souvent jugés par contumace, ne subissant que rarement les sentences prononcées. On en veut pour preuve la vengeance de Monsieur de Gaujal envers les frasques extra-conjugales de son épouse. Prétextant un voyage qui devait le tenir assez longtemps éloigné, il rebroussa chemin à quelques lieues de son logis et s’embusqua non loin de Saint-Sernin d’où il apercevait sa demeure. Dans l’obscurité de la nuit, une lumière indiscrète éclairait la chambre de sa femme. Impatient de se convaincre d’être trompé, de Gaujal se dirigea vers sa demeure. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre que sa femme était en « conversation criminelle », pour ne pas dire galante, avec un jeune homme du pays, Soulié de Lavergne qui, oubliant les règles de la plus élémentaire courtoisie, abandonna sa dulcinée au fil de l’épée de son mari, enfin soulagé. La peine « d’être rompu vif et son corps mis sur une roue pour y vivre tant qu’il plaira à Dieu, en peine et repentance de ses crimes et méfaits sur un échafaud dressé sur la place de Saint-Sernin en Rouergue » ne fut jamais mise à exécution.
Enclins à se pardonner leurs propres méfaits, les seigneurs du Rouergue ne faisaient preuve à l’égard des roturiers d’aucune clémence vis-à-vis de leurs crimes comme le prouve cette exécution qui eut pour théâtre la ville d’Espalion.
Ce 26 février 1664, une foule inaccoutumée se presse, dès l’aube, aux portes de la cité où le Lot roule une eau glauque et rougeâtre comme un fleuve de sang. Un froid vif pique les visages des hommes et des femmes qui se protègent en relevant leurs châles de laine jusqu’aux oreilles. Leurs sabots, bourrés de paille, cognent sur la chaussée empierrée.
Depuis une semaine, la rumeur s’est propagée dans toute la vallée avant de remonter vers les coins les plus reculés de la montagne, colportée par des marchands.
La veille, trois ombres se sont discrètement faufilées à l’intérieur des remparts. Mais le chaland ne s’y est pas trompé. Reconnaissables à leurs pourpoints bleus et à leurs hauts de chausse de même couleur, le bourreau et ses aides ont été accompagné à travers les ruelles de la ville par un long fleuve de murmures allant crescendo.
Dans son cachot obscur suintant d’humidité, le condamné comprend que sa vie ne tient plus qu’à un fil quand le taulier, en lui remettant son écuelle de soupe froide et aigre ajoutée à un quignon de pain rassis, lui révèle l’imminence de son exécution. N’a-t-il pas vu dans l’après-midi les deux maîtres-charpentiers dresser l’échafaud et hisser la croix de Saint-André, sous l’œil attentif et averti du bourreau et de ses acolytes.
Dans sa cellule, le condamné tremble maintenant de froid et de peur. La tête entre les mains, il revoit en accéléré le corps ensanglanté de sa sœur qu’il a, à coups de sabot ferré, réduit à l’état de cadavre ; les juges d’Espalion, dans leurs vêtements d’apparat, qui l’ont condamné à mort ; enfin, la foule vociférant sur le chemin de la prison. Le temps n’est plus aux regrets ! Désormais, il doit expier sa faute devant les hommes puis devant Dieu. Lui seul, peut-être, lui pardonnera sa faute !
Au bruit de la porte grinçant sur ses gonds, le condamné, assis sur sa paillasse rongée de vermines, tressaute. A quelques mètres de lui, l’œil attentif et circulaire, le bourreau l’observe d’un regard torve, prêt à le saisir de ses gros bras noueux s’il lui prend l’envie de se débattre. Mais il n’en sera rien et c’est les pieds nus, en simple chemise sur son corps transi de froid, que le supplicié est tiré sans ménagement de sa cellule.
Dehors, la clarté du jour lui fait cligner les yeux. Une foule énorme, près de 6 000 personnes, s’agglutine sur son parcours. Poussé par ses bourreaux, entouré d’hommes en armes, des juges et des consuls de la ville qui paradent à cheval et en robe, le criminel, un flambeau à la main, sent ses jambes se dérober. A peine reconnaît-il la demeure de sa victime. A peine sent-il les mains solides qui le retiennent par les épaules et le forcent à s’agenouiller. En quelques paroles inaudibles, il fait amende honorable, affirme sa culpabilité et exprime ses regrets. Trois fois, il accomplira le tour de ville ! Trois fois, il expiera son crime !
L’échafaud, cette pyramide de la souffrance et de la cruauté humaine légalisée, se dresse maintenant devant lui. A sa vue, ses jambes se dérobent. Dans un dernier instant de lucidité, il aperçoit sa femme qui l’incite, au milieu des quolibets et des hurlements, à se repentir encore une fois. Mais il n’a d’yeux que pour le bourreau qui, prêt de la croix, tâte déjà la solidité de la barre de fer quarrée qui, tout à l’heure, brisera un par un ses membres. Les aides, toujours prévenant, ont anticipé son mouvement de recul. Ils connaissent la peur qui imprègne soudain les condamnés devant ce monument funeste. Par les bras et par les jambes, ils l’étendent sur les solives, la tête contre terre, comme si déjà il n’appartenait plus à ce monde. Le condamné ferme les yeux. Les cordelettes lui entaillent les membres. Ses oreilles bourdonnent. Le temps est venu de mourir. D’un hochement de tête discret, le premier consul de la ville ordonne au bourreau de s’exécuter. Un premier coup s’abat sur la jambe gauche suivi d’un cri horrible qui apaise la foule. Le peuple sait se taire devant la souffrance. Les coups, parfaitement portés à intervalles réguliers, s’impriment un à un sur ses membres, faisant jaillir des hurlements puis des murmures de douleur. Il faudra quatorze coups sur son corps disloqué pour qu’il rende l’âme. Justice est faite ! Tandis que la foule rassasiée s’écoule lentement par les ruelles adjacentes, son corps est hissé au sommet de la tour du Vieux Pont où il se décomposera avant d’être jeté dans une fosse.
Le syndrome de l’affaire Fualdès
Au XIXe siècle, dans le sillage de la fameuse affaire Fualdès où trois innocents laissèrent leurs têtes au couperet, l’Aveyron se tailla une sinistre réputation de contrée sauvage et peu généreuse, peuplée de paysans rustres et mystérieux, plus enclins à vous faire un mauvais sort qu’à épouser les principes de la modernisation.
Ainsi, n’était-il pas rare, à la veille de la Grande Guerre, de voir les jeunes conscrits aveyronnais être encore accueillis dans les casernes par un cinglant : « Tu viens du pays où l’on saigne les gens comme des cochons », allusion ironique au sort réservé au procureur Fualdès, découvert égorgé dans l’Aveyron, en contrebas de Rodez.
Une législation pénale très sévère
Les Révolutionnaires de 1789 supprimèrent les peines les plus cruelles de l’Ancien Régime sans toutefois abolir la peine de mort. Si la question et son cortège de tortures horribles disparurent par le décret du 9 octobre 1789, il en restait néanmoins assez pour occuper les bourreaux, domestiques de la mort, « grands maîtres dans l’art de tourmenter et au besoin de déchiqueter son semblable ».
En dehors de la peine capitale, désormais exécutée par décapitation à la guillotine, le carcan, la flétrissure et l’exposition publique étaient maintenus.
« Le condamné au carcan, raconte Camille Gros au début du siècle dernier, était conduit à pied au lieu où se faisait l’exposition publique, les deux mains attachées derrière la charrette de l’exécuteur.
Quand on était arrivé au poteau, on faisait entrer le cou du patient dans le collier qui y était fixé par une longue chaîne de fer ; on fermait ce collier avec un cadenas et on plaçait au-dessus de la tête du condamné un écriteau portant en gros caractères ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de son châtiment.
Le condamné à la flétrissure était conduit au même endroit, et là, au milieu de la foule, qui ne manquait jamais d’accourir à ces tristes spectacles, le bourreau le marquait au bras par le fer rouge, de la lettre T ou des deux lettres T.P. (travaux publics) ou de la lettre F. (faussaire) ou même des trois lettres T.P.F.
Enfin le condamné à l’exposition simple était juste attaché au pilori pendant le laps de temps spécifié par le jugement.
Les condamnés en général faisaient lamentable figure sur le pilori, surtout ceux brûlés à trois reprises.
Il y en avait qui tombaient en syncope.
Ceux-là, on les descendait de la plate-forme ; on leur administrait un cordial, et, aussitôt remis, on leur faisait remonter l’escalier et on recommençait à les « tourmenter ».
D’autres pleuraient, criaient, gémissaient, se tordaient.
D’autres enfin résistaient et, quoique fortement liés et réduits à l’impuissance, menaçaient le bourreau. »
C’est ainsi que l’exécution des parricides s’entourait d’une mise en scène particulière. En 1825, Pierre Barrié, de Cocural, condamné à mort pour l’assassinat de sa mère, fut transporté de la prison à la place du Bourg sur une charrette ; il allait pieds nus, en chemise et avait la tête couverte d’un voile noir.
Si, par malheur, l’exécuteur en chef n’exerçait pas son travail dans les règles de l’art, la foule et la justice pouvaient se retourner contre lui.
En 1828, Laur, un soldat insoumis, avait tué un gendarme dans la région de Flavin. Arrêté un mois plus tard, il fut condamné aux travaux forcés, à l’exposition et à la flétrissure. L’exécution de cette partie de l’arrêt, sur la place du Bourg à Rodez, fut marquée par un pénible incident. Quand Laur parut, entouré de la force armée et enchaîné, les nombreuses personnes qui étaient présentes constatèrent que ses chairs étaient profondément entamées par les liens qui le retenaient. De plus, le bourreau, chargé d’appliquer avec un fer brûlant les lettres T.F. sur l’épaule du condamné, procéda avec une brutalité telle que les témoins de cette scène en furent tout à fait révoltés. Plainte fut portée à la justice, et peu de temps après, le tribunal correctionnel de Rodez infligea au bourreau un an de prison et 2000 F d’amende.
La flétrissure et le carcan furent enfin abolis en 1832, l’exposition seulement par décret du 12 avril 1838. Face aux coupables se dressaient désormais les juges de la Cour d’assises, la gueule ouverte de la guillotine prête à trancher dans le vif du sujet et l’irremplaçable bourreau.
Une législation pénale qui évolue
Au début du XIXe siècle, dans la continuité d’une justice d’Ancien Régime peu encline à s’épancher sur le sort des criminels, les Cours d’assises continuèrent à faire preuve d’une extrême sévérité. Celle de l’Aveyron ne fut pas en reste, bien au contraire. De la mise en vigueur du Code pénal, le 1er janvier 1811, au début du XXe siècle, elle prononça pas moins de 155 condamnations à mort, dont 89 contradictoirement et 66 par contumace. Ces condamnations se divisaient en sept groupes, selon la nature des crimes. 78 condamnations concernaient des assassinats, 23 des infanticides, 16 des empoisonnements auxquelles il faut ajouter 14 condamnations pour incendie, 12 pour fausse-monnaie, 6 parricides et 6 vols qualifiés.
De 1811 à 1832, il y eut ainsi à Rodez 106 condamnations capitales dont 63 contradictoires et 43 par contumace. Durant cette période, la législation pénale était d’une sévérité implacable. Quand on songe que la simple émission de fausses pièces d’argent exposait son auteur à porter sa tête sur l’échafaud, on comprend le chiffre considérable des sentences de mort rendues au cours de ces vingt années.
C’est la terrible mésaventure qui arriva, le 20 mai 1817, au nommé Périé, originaire des Mazucs, département du Lot. Accusé et convaincu d’avoir distribué de fausses pièces de 1 F 50, il fut condamné à mort par arrêt de la Cour prévôtale de l’Aveyron. Avant de subir sa peine, Périé fit l’aveu de son crime dans un testament de mort. Ce même jour fut conduit au supplice Etienne Ségur, de Palmas, condamné pour la même peine, le 18 avril 1817.
C’étaient pour les avocats des temps difficiles et l’éloquence de Grandet elle-même ne parvenait pas souvent à toucher les cœurs de bronze des jurés de la Restauration. La peine de mort était alors une monnaie si courante, qu’on laissait aux plus jeunes magistrats le soin de la requérir. M. Frayssinous, substitut, obtint à lui seul une quinzaine de têtes sous le gouvernement de Louis XVIII. M. Adrien de Séguret, substitut en 1823 et 1824, fit condamner et exécuter six assassins dans ces deux années. Enfin, M. Urbain de Maignier, simple attaché au parquet, obtint trois condamnations à mort de 1825 à 1827.
Mais la rigueur du code de 1810 était véritablement excessive. Il n’était pas normal, en effet, que dans une seule année, il y eut vingt condamnations à mort à Rodez.
Sous peine de rester injuste, notre législation pénale devait forcément s’adoucir et c’est ce qui se produisit en 1832.
La loi du 28 avril supprima le crime de fausse-monnaie et celui de vols qualifiés du nombre des crimes capitaux, tout comme la loi du 21 novembre 1901 fit pour celui d’infanticide. Cette même loi de 1832 donna au jury la faculté de tempérer l’effet de son verdict par l’admission de circonstances atténuantes, et dès lors les condamnations à mort furent un peu moins fréquentes. Depuis cette réforme jusqu’en 1910, il n’y eut que 29 accusés contre lesquels le châtiment suprême fut prononcé après les débats contradictoires.
Les lieux d’exécution
Au Moyen Age, on tranchait la tête aux nobles et on pendait les vilains. A Rodez, il y avait pour ces derniers les fourches patibulaires du Bourg et celles de la Cité. Celles de la Cité étaient situées sur le monticule qui portait le nom de « puech de la justice ». A toutes fins utiles, les Anciens, qui ne répugnaient pas aux histoires macabres, racontaient que les récoltes y étaient plus abondantes à cause de l’engraissement du sol par les cadavres des suppliciés. Sous la Terreur, la guillotine fonctionnait sur la place du Bourg. Le ruisseau de sang qui s’en écoulait, ajouté aux manifestations populaires et aux odeurs, provoquèrent les protestations des habitants du quartier sans que l’administration veuille bien en tenir compte.
C’est sur cette même place et devant la vieille halle, depuis longtemps disparue, qu’eurent lieu, plus tard, l’exhibition et le carcan de ceux qui, avant de mourir, étaient condamnés à ce supplice. Après la suppression de ces coutumes barbares, la guillotine fut dressée purement et simplement en face du Palais de Justice, sur l’ancien emplacement du kiosque du tramway. En 1910, pour l’exécution de Terry, l’érection de l’échafaud se fit sur le terre-plein du Palais. Enfin, lors de la dernière exécution, en 1936, l’administration choisit l’impasse des Capucins, plus à l’abri des regards d’une foule toujours avide de ce genre de spectacle morbide.
Rares, au cours du XIXe siècle, furent les exécutions capitales hors du chef-lieu. Marie Frisquette, de Laguiole, s’était débarrassée de son mari pour mieux jouir de son amant. Mal lui en prit ! Confondue d’empoisonnement, rattrapée par les gendarmes, elle fut condamnée, en décembre 1840, à la peine capitale. Incroyable ! Près de 20 000 personnes assistèrent à son exécution sur le foiral de Laguiole.
Ce fut aussi le cas pour les assassins Prunier et Bouat, raccourcis sur la place de l’Esplanade de Saint-Jean-du-Bruel, le 21 octobre 1819 à 5 heures 20 du soir ou de Rouquarié, guillotiné le 28 avril 1829 à 3 heures 30 du soir, sur la place de Montézic.
L’exécution capitale : un spectacle public
Tout au long du XIXe siècle, les exécutions capitales furent entourées de la plus grande publicité, et c’est en plein jour que les condamnés allaient au supplice.
Raffier, le premier des accusés exécutés en vertu du Code pénal de 1810, eut la tête tranchée sur la place du Bourg, à 11 heures du matin, le 22 février 1812. Marie Bénézeth fut exécutée le 27 août 1817, à 4 heures du soir. Les trois incendiaires Delrieu furent livrés au bourreau, le 22 avril 1820, à 5 heures et demi du soir. Trébosc, un ex-gendarme devenu assassin, monta à l’échafaud le 23 juillet 1825, à midi moins un quart. Joseph, dit Roudez, fut guillotiné, place du Palais, le 14 novembre 1857, à 9 heures 27 du matin. Enfin, Bondal, le dernier de la funeste série des exécutés du XIXe siècle, fut décapité le 11 février 1860, à 9 heures du matin.
C’est en passant sur la place du Palais de Justice que le poète François Fabié, alors âgé de quatorze ans, assista aux préparatifs de l’exécution de Bondal.
« Au lieu de les escamoter, à l’aube, écrit-il, comme aujourd’hui, on les faisait alors, à neuf heures du matin ; et c’était logique, puisqu’on croyait à l’efficacité de l’exemple. N’ayant pas osé manquer l’école, je ne vis pas l’exécution même. Mais j’avais vu monter l’échafaud, à sept heures, et, en ce temps-là, il s’agissait bien d’un véritable échafaud ; on y accédait par un escalier de cinq ou six marches ; et de partout on apercevait la plate-forme, au-dessus de laquelle s’érigeaient les deux bras -qui me rappelaient les montants de notre scierie- avec le couperet luisant en travers. Escalier, plate-forme et montants étaient peints en rouge : c’était fort impressionnant… ».
« Quand je retournai sur les lieux, concluait le poète de Roupeyrac, on procédait au démontage de l’échafaud… Il y avait beaucoup de curieux à travers lesquels je me faufilai ; et je vis une flaque rouge sur le sol et un valet du bourreau raclant les traces de sang sur une planche au moyen d’un petit couteau de poche presque pareil à celui que, comme tous les rustiques, j’avais dans la mienne. Je crachai de dégoût et je retournai à l’Institution. »
En général, le condamné était accompagné d’un prêtre qui l’exhortait. Ce pénible ministère fut rempli pendant de longues années par l’abbé Truel, aumônier de l’hospice. L’abbé Truel fut ensuite remplacé par l’abbé Loubière, aumônier des prisons, qui assista dans leurs derniers moments les condamnés Ratié, Roudez et Bondal.
Parricides et infanticides
Au sein des Cours d’assises, les infanticides et les parricides étaient sévèrement sanctionnés et ne recevaient de la part des juges aucune mansuétude.
Albert Valette avait étranglé son père, de complicité avec sa maîtresse, Geneviève Franc, en 1840. Tous deux furent condamnés à mort, la peine de Geneviève Franc étant toutefois commuée en travaux forcés à perpétuité. Quant au fils assassin, transporté au lieu de supplice, il fallut le porter à l’échafaud.
Il faut dire que l’exécution des parricides s’entourait d’une mise en scène particulière.
Alexis Caumes, cultivateur à Saint-Rome-de-Tarn, avait été condamné à la peine de mort, le 18 mars 1845, pour l’assassinat de son père. Le jour fixé, il fut conduit par les exécuteurs sur la place du Palais de justice de Rodez, en chemise, nu-pieds et la tête couverte d’un voile noir, accompagné de l’aumônier de la ville, l’abbé Truel. Arrivé sur l’échafaud, Caumes y demeura exposé le temps que l’huissier fit au peuple lecture de l’arrêt de condamnation, puis il fut immédiatement exécuté, la tête tranchée, à 4 heures de l’après-midi.
L’article 13 qui s’y rapportait fut définitivement abrogé par le décret-loi de 1939, qui supprimait aussi la publicité faite aux exécutions. Mais, depuis longtemps, les crimes de parricide et d’infanticide ne donnaient plus acte aux exécutions capitales.
Le crime d’empoisonnement : une spécialité féminine !
Parmi les affaires criminelles qui remplissaient les sessions trimestrielles de la Cour d’assises de l’Aveyron au XIXe siècle, le public manifesta toujours une attirance particulière pour les adeptes féminins « du bouillon de onze heures » : par la personnalité des accusées d’abord, femmes de caractères en général ; par l’incertitude scientifique qui présida longtemps aux résultats des analyses ; par l’habitude enfin que les toxicologues avaient d’y produire les restes, analysés et putrescents, des victimes. On imagine l’effet qu’un spectacle aussi sordide pouvait produire sur les jurés. Le public, lui, était ravi.
On comprend dès lors que la justice désira faire preuve d’une exemplaire sévérité à l’égard de ces sorcières des temps modernes. A leurs pratiques sournoises, les Cours d’assises répondirent par la peine capitale. Entre 1817 et 1842, pas moins de sept empoisonneuses aveyronnaises furent ainsi invitées par les jurys à rejoindre leurs chères victimes, maris pour la plupart.
Jeanne Cougoule fut la première empoisonneuse exécutée au XIXe siècle, le 18 novembre 1816. Cultivatrice à Saint-Igest et considérée comme une femme de mauvaise vie, elle fut accusée d’avoir empoisonné son mari, Pierre Vernet. L’estomac de la victime examiné par les hommes de l’art était pavoisé d’une substance blanchâtre. Exposé sur un charbon ardent, une forte odeur alliacée s’en dégageait. Il ne faisait plus aucun doute que la mort résultait d’une absorption arsenicale.
La peine capitale ne freinait guère celles qui avaient décidé une bonne fois pour toutes de se débarrasser d’un conjoint devenu trop gênant. Six mois plus tard, le 9 juin 1817, Marie Bénézech, âgée de 22 ans, rejoignait Jeanne Cougoule, bientôt suivie par Christine Monot, exécutée le 19 mai 1820, Carrière, Marie, décapitée le 18 mai 1821 et Besset, Marie-Anne, exécutée elle-aussi le 4 décembre 1823.
En 1841, Marie Frisquette décida à son tour d’envoyer au diable son mari. Une bonne dose de poison dans la soupe ferait son affaire. Le pauvre bougre ne se douta de rien. Au milieu de la nuit, il se leva en hurlant. Une terrible brûlure lui fouillait le ventre. Dans un effort surhumain, il tenta de se lever, trébucha sur le plancher avant de s’écrouler en hurlant contre la porte. Quand les gendarmes le découvrirent, Pierre Boureille gisait sur le sol, les yeux hors des orbites et la bouche décrivant un horrible rictus.
La dernière empoisonneuse qui monta à l’échafaud, qui fut aussi la dernière femme exécutée en Aveyron, triste privilège, rendit l’âme le 15 juin 1842. Julie Phalipou, femme de caractère s’il en fut, avait trucidé son mari pour mieux profiter de son amant. C’était le temps du procès de la célèbre Marie Lafarge. Les premiers examens du corps du mari de Julie Phalipou ne donnèrent rien. Il fallut l’opiniâtreté du procureur de Villefranche-de-Rouergue, faisant déterrer le corps, pour que la faculté de médecine de Montpellier conclue, après de nouveaux examens, au crime d’empoisonnement.
Pour Julie Phalippou, l’épilogue fut dramatique. Bouleversé par l’émotion d’exécuter une femme qui n’était plus qu’un pantin chancelant dans ses bras, le bourreau perdit son sang-froid. La tête ayant été mal enclenchée dans la lunette, le couteau tomba non pas sur le cou, mais entre la bouche et le menton de la suppliciée. Cette erreur « technique » souleva l’horreur au sein de la population, qui exigea des sanctions envers l’exécuteur des hautes œuvres. Le Parquet, dit-on, fit déterrer le corps de Julie Phalippou pour l’examiner. On ne sait si le bourreau fut poursuivi !
Bourreau, Frères, flic et barreau
La triste fin du dernier bourreau de Rodez
Le bourreau de Rodez qui se met en grève pour exiger une augmentation de salaire ! Un de ses successeurs qui termine sa vie alité, rongé par le spectre des cent cinquante suppliciés qui lui apparaissaient en songe ! Des sanctions qui le ramenaient à l’importance de sa tâche ! Décidément, le métier d’exécuteur des arrêts criminels en Aveyron n’était pas de tout repos.
Tantôt surnommé brise-garrot, tantôt Jean-Cadavre ou carnifex, quelle vie menait cet étrange personnage, mi-homme, mi-démon, redouté et honni de tous ?
Sous l’Ancien Régime, trois exécuteurs exerçaient à Millau, Rodez et Villefranche-de-Rouergue. Rare privilège car certaines juridictions n’en possédaient pas. Rodez conserva son bourreau particulier jusqu’en 1853. Entretenu par le Bourg et la Cité, ce fonctionnaire logeait dans la tour d’angle proche de la rue de la Bullière, avec la jouissance d’un jardin. En public, il portait par ordonnance une livrée aux armes du Roi et de la ville, renouvelée tous les trois ans par celle-ci. Au XIXe siècle, comme le mentionnent les procès-verbaux d’exécution de Canillac (3 novembre 1823) et de Marguerite Espagnol (18 décembre 1823), il revêtait une chemise rouge.
L’exécuteur de Rodez touchait, au moment de la Révolution, un salaire de 276 livres, famélique en comparaison d’autres bourreaux tels ceux de Laon (1655 livres) ou de Soissons (2948 livres), bien mieux rémunérés. Outre son salaire, il percevait un curieux privilège, le droit de havage, qui lui accordait de puiser à la main, plus tard avec une mesure, dans les marchandises qui entraient en ville les jours de marché. Ce droit de havage fut supprimé le 23 avril 1775 et remplacé par une rétribution accordée par le Domaine, bien en dessous de ce qu’il pouvait percevoir auparavant. Pour arrondir ses fins de mois, le bourreau de Rodez avait aussi en charge de surveiller la propreté des rues et d’empêcher la divagation des chiens, amendes à l’appui.
Personnage officiel mais rejeté par toutes les classes sociales, le bourreau vivait comme un reclus. L’inviter à sa table, c’était attirer le malheur sur la maison ; travailler pour lui, c’était perdre une grande partie de sa clientèle. La Gazette des Tribunaux du 16 juin 1833 rapporte dans ses colonnes l’aventure qui arriva à l’exécuteur de Rodez. « Le huit du même mois, on devait exécuter à Albi les deux auteurs d’une affaire criminelle qui avait passionné toute la région, Marie-Anne Bosc et Pierre Hébrard. Mais les charpentiers de la ville ayant appris le 7 au matin l’arrivée de l’exécuteur de Rodez venu aider son collègue, fuirent tous la ville afin d’échapper à la réquisition. Pendant que les huissiers couraient la ville à la recherche d’un charpentier, les pièces de la guillotine, les bois de l’échafaud et les deux cercueils avaient été déposés sur la place prévue pour l’exécution. Le 8 juin était un samedi, jour de marché, une foule de curieux défila toute la journée pour examiner de près tous ces sinistres objets. Toute la population applaudissait les charpentiers qui demeurèrent introuvables jusqu’au soir. On n’exécute pas le dimanche. Les charpentiers consentirent enfin à monter l’échafaud, à condition de travailler la nuit et sans être vus. On dut placer des piquets de garde et faire circuler des patrouilles pour éloigner les curieux. L’exécution eut lieu le lundi matin 10 juin, avec deux jours de retard, et devant une foule considérable. »
Une tradition, autrefois parfaitement respectée, consistait aussi à ne jamais présenter sur la table une tourte de pain à l’envers. C’était en effet la manière pour les boulangers de réserver la part du bourreau. L’imiter pouvait porter malheur.
Au milieu du XIXe siècle, les habitants de Rodez croisaient souvent un petit homme trapu et musclé, la démarche obstinément rapide, qui se promenait le regard en permanence rivé au sol.
Il ne parlait à personne et personne n’aurait osé lui adresser la parole. Selon un rite quasi immuable, il pénétrait chaque jour dans une boulangerie du centre-ville. Puis, poursuivant son chemin, il revenait vers son logement, à l’angle de rue de la Bullière. Parfois, il croisait sa femme Céleste qui brocantait quelques morceaux de viande aux bouchers tenant commerce dans cette rue. Econome, Céleste savait discuter les prix et faire le meilleur choix. Lui-même accomplissait sa tâche avec rigueur.
Quelquefois, il pénétrait dans un petit local de la tour d’angle de son domicile, s’y attardait une paire d’heures puis ressortait, en ayant bien soin de verrouiller la porte.
Les habitants du quartier l’avaient affublé du nom de carnifex. Pour les enfants, qui le craignaient malgré son air débonnaire, Pierre-Victor Rives était tout simplement… le bourreau de Rodez.
Descendant d’une famille ariégeoise qui exerça son « art » dans le département limitrophe de l’Aude, Pierre-Victor avait succédé en 1828 à un bourreau de sinistre réputation, Lamoalie, révoqué pour avoir tourmenté avec sadisme un malheureux, condamné à la flétrissure.
Si la profession d’exécuteur en chef des arrêts criminels souffrait du rejet permanent de la société civile, elle offrait à son époque des émoluments loin d’être négligeables. 4000 F de traitement payable 1000 F par trimestre, 40 F d’indemnité annuelle pour frais d’entretien du matériel plus toute une série de subsides divers faisaient du bourreau de Rodez un des fonctionnaires les mieux rétribués de la ville. Rien à voir avec la période révolutionnaire. Les bourreaux avaient su revaloriser leur métier.
Personnage public mais vivant comme un reclus, l’exécuteur de Rodez était bien sûr l’objet d’une attention particulière de la part de ses congénères. Le bruit courait notamment en ville qu’à chaque exécution, l’émotion le saisissait, il perdait son sang-froid et rentrait chez lui, le teint livide et le corps tremblant de fièvre.
En 1853 justement, après une vie professionnelle bien remplie, Pierre-Victor Rives reçut l’ordre d’exécuter un dénommé Ratié, artilleur de son état dans la commune de Golinhac, près d’Espalion. La vue du sang jaillissant du tronc décapité de sa nouvelle victime provoqua chez lui une crise terrible « d’hémophobie ». Laissant son aide s’occuper du nettoyage et du démontage de la guillotine, il regagna son domicile et s’alita. Toute la nuit, dans un songe effrayant, il vit le spectre des cent cinquante suppliciés qu’il avait guillotinés exécuter une ronde effrénée autour de sa chambre. Il mourut le lendemain, 8 mai 1853, le corps secoué de frissons et de sursauts horribles. Il ne fut jamais remplacé.
Les Frères des prisons
Le frère Ildefonse, dont François Fabié chanta les louanges du temps où il essuyait le fond de ses culottes sur les bancs du Pensionnat Saint-Joseph, nous a laissé un témoignage unique sur l’action des Frères des écoles chrétiennes à soulager les prisonniers. Nous sommes en 1857, après la condamnation du terrible Roudez.
« Mon vénérable supérieur me menait aussi à la prison où les frères faisaient l’école aux détenus. Dans la cour se tenaient les prisonniers dans un désœuvrement qui ne pouvait que contribuer à leur dépravation : tout leur temps se passait à maudire leurs juges.
J’étais jeune et sans aucune expérience de la vie, néanmoins je sentais, je comprenais que la société devait faire davantage pour moraliser ces pauvres malheureux.
Parmi les prisonniers qui venaient aux leçons des Frères, il y en avait un avec lequel on me mit en rapport et qui me laissait une immense pitié. C’était un pauvre jeune homme de 22 à 23 ans, à la haute taille, aux formes athlétiques, un vrai colosse. Coupable d’homicide, il avait été condamné à la peine de mort. Il nous raconta son histoire, qui nous faisait dresser les cheveux sur la tête. Les mauvais compagnons l’avaient perdu. Un jour ou plutôt une lugubre nuit, ayant besoin d’argent, il voulut dérober un de ses compagnons de voyage ; avec un instrument contendant et surtout avec le secours de sa force herculéenne, il l’avait assommé, brisé le crâne, dérobé son argent et s’était enfui. Mais la justice de Dieu l’atteignit, en permettant que la justice des hommes s’appesantit sur lui.
Après un débat célèbre en Cour d’assises, il fut condamné à la majorité sinon à l’unanimité des voix : l’échafaud pouvait seul expier son forfait.
Entre sa condamnation et son exécution, il se passa un assez long temps ; on le berçait de l’espoir de voir sa peine commuée grâce à la charité de l’Impératrice Eugénie.
En attendant, les Frères de la prison, mus par un sentiment de pitié, l’attirèrent à l’école ; une évasion n’était pas à redouter : le pauvre malheureux traînait deux gros boulets attachés par de lourdes chaînes.
Je dus m’occuper un peu de lui et j’eus la consolation de lui apprendre l’Oraison Dominicale. Je me souviens qu’impressionné par les bruits du dehors qui assuraient que la grâce ne serait pas accordée, je ne pouvais, sans frissonner, considérer sa tête reposant sur de larges épaules, sans songer avec terreur au sanglant couperet qui allait la détacher de son tronc.
Obligé pour aller dans les Ecoles de passer devant l’échafaud autour duquel s’était fait un grand vide grâce aux troupes qui étaient sur pied bien avant le jour et qui écartaient la foule, je frémis encore en songeant à l’impression que me produisit la guillotine, couleur rouge de sang.
Les Frères, arrivés en classe, mirent en prière les élèves clairsemés que la curiosité n’avait pas entraînés dans la foule afin d’implorer tous ensemble la piété et la miséricorde de Dieu sur ce pauvre criminel qui allait se trouver face à face avec lui. »
Du barreau à la vie politique
Conçue pour les audiences publiques, la Cour d’assises devint bien vite un théâtre tragique, violeuse de vie privée, ouverte en grande pompe quatre séances par an, où se côtoyaient, l’espace de quelques heures, coupables timides, arrogants ou angoissés ; juges aux faciès sévères engoncés dans leurs tenues d’apparat ; jurés prenant au sérieux toute l’importance de leur charge au milieu d’un public virevoltant ses émotions au gré des témoignages, des dépositions et des plaidoiries. Rien normalement n’aurait dû rapprocher ces hommes et ces femmes de rangs si divers si ce n’est le crime que les uns et les autres avaient soit à juger soit à payer à la société. L’avocat, par exemple, se sentait parfois tellement lié à son client qu’il pouvait enregistrer des charges émotionnelles « a priori » contradictoires. Ce fut le cas lors du procès d’H. B. en 1935. L’annonce de sa condamnation à la peine de mort provoqua une scène à la fois émouvante et grotesque : l’avocat se mit à pleurer à chaudes larmes tandis que derrière lui, l’accusé le regardait avec un certain étonnement, de ses yeux fixes et secs.
Hommes de loi, les avocats du barreau aveyronnais jouaient aussi un rôle important dans la vie de la cité.
Avant 1789, le Rouergue dépendait du ressort du Parlement de Toulouse. Le grand avocat Laviguerie, dont une rue de Toulouse porte le nom, était rouergat. Il survécut à la destruction du Parlement et plaida devant les nouvelles juridictions.
En Rouergue, la plupart des avocats au Parlement se mirent à la tête du mouvement de 1789. Les uns, comme Person-Lasfargues, Rous, Monseignat… furent envoyés aux Assemblées parlementaires. D’autres, comme Arsaud, restèrent au pays et administrèrent la cité. Sous l’Empire, les plus célèbres étaient incontestablement Monseignat, Flaugergues et Merlin, de Sauveterre. Sous la Restauration, leur rôle resta strictement professionnel bien que libéral et voltairien.
Sous la Monarchie de Juillet, le barreau reprit un rôle politique. A Rodez, les avocats étaient des hommes de haute valeur. Ils s’appelaient Louis Foulquier qui devint conseiller de Préfecture ; Edouard Maisonabe ; Henri Rodat ; Vesin, qui devint Procureur du Roi ; Louis Bouloumié, fervent défenseur des Républicains, qui créa sous le Second Empire les thermes de Vittel ; enfin le philosophe Joseph-Marie Grandet qui quitta le Palais pour se consacrer aux plus hautes méditations. A Espalion, Denayrouse ; à Villefranche, Dubruel. Tous ces maîtres avaient acquis une si légitime popularité qu’ils furent portés par le suffrage universel dans les assemblées politiques de la 2e République.
Après le coup d’état du 2 décembre, la plupart rejoignit le barreau. Ces maîtres plaidaient bien mais ils saisissaient toutes les occasions de manifester leurs sentiments libéraux. Ainsi organisèrent-ils une fête en l’honneur de M. Ernest Picard, venu à Rodez pour défendre le docteur Lala contre le docteur Rozier ; ainsi essayèrent-ils, comme M. Rodat en mai 1869, de combattre les candidats officiels. Dans l’Aveyron comme ailleurs, ils représentaient l’opposition.
Après le 4 septembre 1870, ce fut un avocat du barreau de Rodez, Louis Oustry, qui devint préfet de l’Aveyron. Un autre avocat ruthénois, Eugène Lacombe, occupa au Sénat, de 1885 à 1894, une place considérable. Auguste Azémar, qui fut successivement adjoint au maire de Rodez, conseiller général de l’Aveyron, conseiller de Préfecture et député de Rodez de 1876 à 1881, fut par excellence le type de l’avocat ruthénois. Doué d’une mémoire prodigieuse, d’un sens très juridique et d’une pénétration d’esprit extraordinaire, il occupa incontestablement le premier rang du barreau de Rodez. Dans son cabinet de la place du Bourg, affluaient les clients, non seulement de tout l’Aveyron mais aussi des départements voisins.
Les avocats aveyronnais ont aussi essaimé hors du département, plus particulièrement dans la capitale. Notons les noms de Jules Clausel de Coussergues ; du sénateur Delsol ; de Louis Puech, frère du sculpteur et sénateur à Paris ; MM. Aliès, Pélissier, Destruels, André Puech, Asselineau, Hild et au barreau de Montpellier, Me Joly de Cabanous, originaire de Saint-Affrique.
Un flic aveyronnais à la Belle Epoque !
A la fin du XIXe siècle, parmi les plus fins limiers de la police chargés de traquer le crime, ressortaient les noms du commissaire Jean-Michel Goron et de l’un de ses adjoints, Martial Calchas.
Ce dernier était né à Villefranche-de-Rouergue, le 19 mai 1870, ville dans laquelle son père exerçait la fonction de chef de gare. Martial, engagé volontaire au 101e R.I., quitta ensuite l’armée avec le grade de sergent, pour entrer au service de la Sûreté parisienne.
Ses facultés d’observation, la promptitude de son jugement, la logique de ses déductions, sa ténacité enfin, firent bien vite de ce débutant particulièrement doué, l’un des plus subtils collaborateurs de Goron.
Rien ne passionnait davantage Martial Calchas qu’un mystère, un « beau mystère » qu’il fallait débrouiller, laver de ses ombres, transposer des ténèbres opaques dans la pleine crudité de la lumière. Une telle mission n’allait pas sans difficultés ; mais Calchas la remplaçait toujours avec belle humeur, avec entrain, avec une confiance réfléchie, qui n’était pas de la présomption, mais une manière de stimulant.
Calchas, au demeurant, possédait une physionomie fort pittoresque. Il n’avait pas l’air inquiet, sombre et méditatif que prennent volontiers les Sherlock Holmes de roman-feuilleton. Non ! Calchas était gai, jovial, bon vivant, d’accueil courtois et de mine engageante.
Son physique lui-même le servait. Il était petit, replet, et la carrure de ses épaules soutenait une tête rabelaisienne, puissante, colorée, où s’insinuaient la malice et la gaieté. On était bien vite en confiance et d’avoir la figure si sympathique lui fut plus d’une fois d’une grande utilité.
Passé maître dans l’art du camouflage, Calchas, pour se grimer, n’avait pas son pareil. Il se transformait avec un sens si exact et s’adaptait si merveilleusement au milieu où le hasard du métier l’avait jeté, que les plus avisés des malfaiteurs ne pouvaient éventer un policier aux écoutes dans le joyeux compagnon qui jouait au milieu d’eux le rôle d’indifférence ou de complicité qu’il s’était assigné.
Calchas fut bien sûr mêlé à de retentissantes affaires. Il allait du bouge au grand cabaret, du faubourg au boulevard, avec une aisance parfaite. Marchand de bestiaux à la Villette, courtier ici, gentleman là, il circulait dans tous les mondes, à la poursuite de la vérité fugitive. Mais il évoluait surtout au milieu des grands voleurs internationaux.
Parlant très correctement l’anglais, il se mêlait à ces bandes redoutables, si fortement organisées, pour surprendre les secrets de quelques-unes. C’est ainsi qu’il élucida l’affaire des faux timbres, qui se termina par de nombreuses arrestations.
Les voleurs de titre ne le pleurèrent pas. Il était pour eux un ennemi redoutable qui savait, dans les grands établissements, découvrir ces hommes, se lier avec eux et conduire enfin, avec une habileté faite de finesse, de temporisation opportune ou de rapidité, ce genre d’enquêtes difficiles.
C’est ainsi que Calchas s’occupa des affaires Syveton, Steinhell et Gallay ; il fut encore présent dans l’affaire de l’espion Decrion et dans divers incidents d’espionnage malaisés à tirer au clair. Calchas s’occupa enfin, avec une assiduité que rien ne lassa, des rats d’église et de leur chef, le trop fameux Thomas, qui déroba la chasse d’Ambazac. Utilisant avec à propos son physique, il se costuma cette fois en ecclésiastique et, lancé sur la piste des cambrioleurs, l’astucieux détective parcourut sous la soutane, des semaines durant, le centre de la France. Ses recherches finirent par aboutir et il parvint à retrouver la colombe eucharistique… dans le lit de la Seine, sous le pont des Arts.
Calchas avait des idées curieuses, des initiatives intéressantes, des connaissances profondes sur son métier. Pendant l’affaire des bandits tragiques et les exploits des « bijoutiers », il sut ainsi prévoir et les tueries nouvelles et les vols nouveaux et il préconisa une réforme de la police parisienne qui en avait bien besoin.
Pourtant, le 5 août 1910, le brigadier Martial Calchas prit sa retraite proportionnelle et se retira pour fonder, avec son collègue Debisschop, une agence de police privée.
Trois ans plus tard, une affection cardiaque l’emportait, à 43 ans.
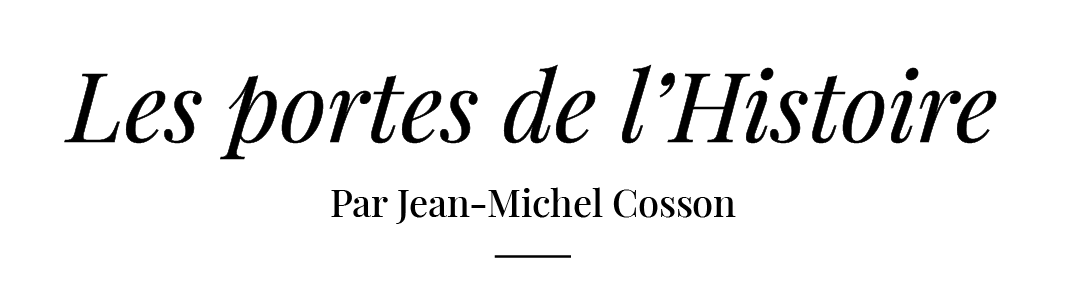
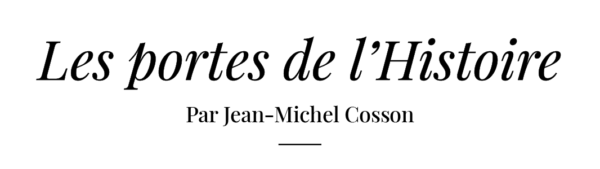
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !