Des champions au champ d’honneur
(De Roland Garros à Jean Bouin)
2 août 1914. La France se fige dans la guerre. Ouvriers, paysans, employés ou fonctionnaires, suivant leur feuille de route, rejoignent leur régiment respectif. Les sportifs n’échappent pas à cet ordre de mobilisation générale. Si la plupart sont incorporés dès le début du conflit, d’autres comme Roland Garros, Octave Lapize ou Lucien Petit-Breton s’engagent par pur patriotisme. Et que dire de l’Auvergnate Marie Marvingt, la « fiancée du danger », qui se déguise en homme pour se battre au côté des chasseurs alpins avant d’être reconnue au bout de quarante-sept jours.
Pour les uns et pour les autres, l’héroïsme de l’exploit sportif s’efface dès lors devant l’héroïsme à défendre la patrie. Les conquêtes se déroulent désormais sur d’autres fronts et les résultats se déclinent en terme de terrain gagné ou perdu et de pertes humaines. Si le bilan des 424 champions français, patiemment répertoriés par Michel Merckel dans son excellent ouvrage « 14-18. Le sport sort des tranchées », fournit une idée du désastre sportif humain, il n’est qu’une goutte de sang par rapport aux milliers d’hommes qui, à un titre ou à un autre, ont tâté du sport dans les clubs et les associations avant de laisser leurs vies dans la boue des tranchées.
Relégué au second rang dès le début des combats – comment pourrait-il en être autrement quand gronde le canon et que les troupes ennemies menacent Paris – le sport retrouve tout son sens originel de divertissement et de jeu dès lors que le front se stabilise. Il apparaît spontanément, dans les périodes de répit, à l’arrière du front ou à proximité des boyaux des tranchées. Les instituteurs formés à la gymnastique et les sportifs confirmés deviennent alors d’excellents propagateurs auprès de leurs nouveaux camarades, fiers à leur tour de côtoyer des champions connus seulement à travers leurs exploits racontés par la presse. Si le sport n’est plus une fin en soi, sa pratique provoque une prise de conscience chez les Poilus, notamment issus du monde rural, comme le rappelle le joueur de rugby du Stade Français Paul Andrillon dans une lettre adressée à ses parents, le 20 février 1915 : « J’ai plusieurs copains de la campagne qui ignoraient tout de ce noble sport et sont en train de devenir fanatiques du ballon ovale… »
Cette forme de continuité sportive dans la guerre se retrouve dans les journaux des tranchées et dans les carnets de route des Poilus : « […] c’est un vrai délassement, écrit le même Paul Andrillon, que de jouer au football de temps à autre, bien loin de fatiguer les poilus, ça redonne de l’énergie en faisant jouer les articulations qui ont plutôt besoin de ça ; et puis c’est si bon de plaquer les copains. Dans la tranchée, en face de ma cabane se trouve une assez grande place des Alliés (elle a 20 m de long sur 5 de large), on y fait de l’entraînement à 5 ou 6 types… »
Un journal, Le Sporting, se consacre entièrement au sport et donne des nouvelles des sportifs-soldats. En mai 1915, l’armée crée un étrange camp de détente pour pious-pious, le « Poilu’s Park », à Commercy où se mêlent activités sportives, spectacles musicaux et cinéma. Convaincus par la nécessité de pratiquer des exercices physiques, les officiers encouragent les régiments à jouer au football et au rugby, autorisant même la mise en place de mini-championnat et d’exhibitions au cœur même des zones de combat. Une volonté que le général Pétain traduit à sa manière à l’issue de la bataille de Verdun : « Ce qu’il me faut maintenant comme officiers d’état-major, ce sont des coureurs cyclistes, des champions de course à pied et des joueurs de football. »
Pareil discours est véhiculé par la revue « Lectures pour tous ». Dès 1917, elle émet le vœu que l’armée devienne pour toute la jeunesse, une école Normale de développement physique et d’éducation militaire. « Tout ce qui pourra encourager au sport – subventions, prêts et aménagements de terrains, espaces libres réservés au sport – devra trouver un écho positif, tant au sein de l’Etat qu’auprès des conseils généraux, municipaux ou parmi les mécènes privés. »
Le rugby et la boxe, par leurs valeurs de force et de combat, ont la faveur des officiers tandis que le football est préféré par les Poilus, qui le jugent moins violent et moins fatigant.
Dès 1917, des rencontres « internationales » sont mises sur pied entre régiments français, anglais, australiens et néo-zélandais. L’influence anglaise dans le football et celle des Néo-Zélandais dans le rugby apportent aux joueurs français de nouvelles méthodes de jeu qu’ils utiliseront, la paix enfin revenue.
Ainsi donc, aussi surprenant que cela puisse paraître, la guerre participe à l’évolution des pratiques sportives. Dès l’armistice, dans la continuité de ces rencontres officieuses, des Jeux inter alliés sont organisés par les autorités militaires, constituant le socle des futures rencontres internationales entre les nations. Champions d’avant-guerre qui ont survécu et néophytes qui se sont découverts un talent sportif participent, dans leurs régiments respectifs, à des phases éliminatoires avant de disputer la grande finale à Paris, du 22 juin au 6 juillet 1919. Ce développement n’aura de cesse de s’amplifier, touchant l’ensemble du pays et toutes les couches sociales.
Combien cependant, morts au champ d’honneur ou mutilés, n’ont pas cette chance de retrouver leur terrain de jeu favori ? Quelques chiffres suffisent à démontrer l’ampleur du désastre. Selon les données fournis par Michel Merkel dans son ouvrage, tous les sports en vogue sont touchés, du football (89 tués) au cyclisme (78), de l’athlétisme (52) à la boxe (27) et à l’escrime (23). Deux cent quinze licenciés du Racing Club de France, sur un effectif d’un millier, trouvent la mort dans les combats. L’équipe de France de rugby perd vingt-trois de ses joueurs sélectionnés. L’Aviron Bayonnais déplore la perte de sept joueurs majeurs ; l’U.S. Perpignanaise, huit de ses rugbymen champions de France 1914. Quatre joueurs du Stade Toulousain, champions de France en 1912, décèdent au front. La Ville Rose possède d’ailleurs un des rares monuments dédiés aux sportifs morts au combat. Erigé en 1925, place Héraklès, il mentionne les noms des cinq cent soixante-quinze rugbymen du Comité des Pyrénées morts pour la France en 14-18. C’est dire l’impact meurtrier de la guerre sur les effectifs sportifs.
Il serait ici trop long d’évoquer tous ceux qui ont apporté leur contribution au développement des pratiques sportives. Quelques noms, parmi les plus connus, permettent toutefois de mesurer combien la guerre n’a épargné personne. Et combien les champions français se sont faits une gloire patriotique d’aller combattre.
Octave Lapize, Lucien Petit-Breton et François Faber n’enfourcheront plus leurs vélos sur les routes du Tour de France. Le premier, coureur complet, avait gagné des courses aussi prestigieuses que Paris-Roubaix ou le Tour de France 1910. Au sommet de son talent et de la gloire, âgé de 27 ans, en dépit d’une réforme pour surdité, il s’engage dans l’aviation. Celui qui a crié, au sommet de l’Aubisque, à l’adresse des organisateurs, « Vous êtes des assassins, vous êtes des criminels » tombe, le 14 juillet 1917, près de Toul, sous les balles meurtrières d’un avion ennemi. Le second, Lucien Mazan, se construit, sous le pseudonyme de Petit- Breton, un palmarès marqué par deux Tours de France consécutifs (1907 et 1908) et des victoires prestigieuses comme Milan-San Remo. Délaissant son vélo au profit des taxis, il participe à la victoire de la Marne avant de trouver la mort, en service commandé, dans un accident de voiture, le 20 décembre 1917. À La Vie au grand air, il déclarait, prémonitoire, quelques mois plus tôt : « Hélas ! À la reprise des vélodromes, combien d’entre nous auront disparu qui étaient la gloire de notre sport ? » De nationalité luxembourgeoise mais français par sa mère, François Faber n’a rien à envier aux deux premiers. Vainqueur du Tour 1909, de Paris-Roubaix et de Milan-San Remo, il entre dans la Légion étrangère dès les premières semaines de la guerre. Celui que le public nomme « le Géant de Colombes » disparaît corps et biens le 9 mai 1915 dans la terre des tranchées du Pas-de-Calais.
Le nom de Jean Bouin brille au firmament de l’athlétisme d’avant-guerre. Multi-champions de France et recordman du monde de courses à pied, il détient en 1913 le record de l’heure, parcourant 19,021 km. Il connaît son heure de gloire aux J.O. de Stockholm de 1912 en terminant second du 5000 mètres à seulement 2/10e du vainqueur, le Finlandais Kolehmainen. Des éclats d’obus l’atteignent mortellement le 29 septembre 1914 près de Xivray (Meuse). De nombreux équipements sportifs portent aujourd’hui son nom ainsi qu’un challenge, disparu en 1995, dédié aux vaincus des demi-finales du championnat de France de rugby.
À l’époque, l’aviation, au même titre que l’automobile, est considérée comme un véritable sport tant les risques sont importants. Nouvelle arme de guerre, l’avion est utilisé en 1914 comme moyen d’observation avant d’être converti en arme de combat. Trois des plus grands pilotes y laissent la vie. Roland Garros, sportif touche-à-tout, s’engage dès le 2 août 1914 alors que ses origines réunionnaises lui évitent d’être mobilisé. Fait prisonnier en avril 1915, il s’évade en février 1918, réintègre l’aviation avant de succomber à un combat aérien, le 5 octobre 1918, la veille de ses trente ans. À son nom s’associent ceux de treize autres aviateurs dont Jules Védrines, tombé le 21 avril 1919 et Marcel Brindejonc des Moulinais, tué par erreur par deux avions français, le 18 août 1916 près de Verdun.
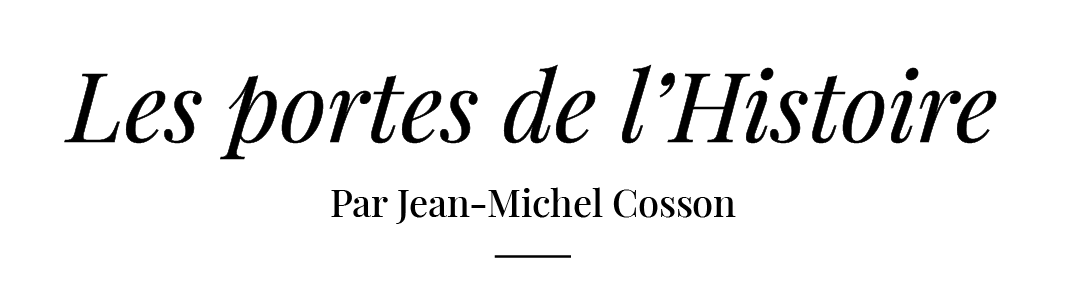
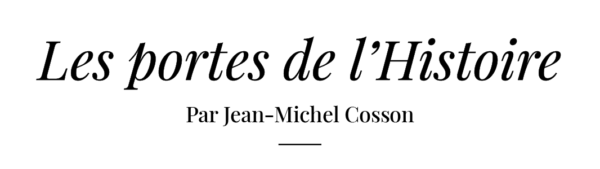
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !