François Villon. Le poète des chemins de traverse
Malfrat et poète, invité dans les cours royales, François Villon s’inscrit dans la lignée des mauvais garçons (Sade, Verlaine, Genet) qui tirent leur gloire d’une œuvre littéraire féconde.
Qui est François Villon ? Cette question mérite d’emblée d’être posée à la lecture des documents squelettiques qui nous sont parvenus, essentiellement judiciaires. Tant d’incertitudes s’expliquent par une vie faite de tours, de détours et de retours, le plus souvent pour échapper aux autorités. Suivre sa trace et son parcours se révèle ardu lui qui, de son propre chef, brouille les pistes avant de s’évanouir définitivement dans la nature, assorti d’un grand point d’interrogation, fixé sur l’année 1463. Comme un pied-de-nez à l’ennui. François Villon vient d’entrer dans sa trente-deuxième année.
L’entrée dans la carrière
« Je suis François dont il me poise… »
Son enfance ne se reconstitue pas sur des vraisemblances mais sur des apparences. Le petit François, né peut-être François de Montcorbier ou des Loges, voit le jour à Paris vers 1431. Une famille pauvre dont on ne sait rien. Recueilli ensuite par le chanoine de Saint-Benoît-le-Bestourné, au cœur du Quartier latin, Guillaume de Villon, qui lui donne outre son nom, une solide éducation. Quelles sont les raisons de ce recueillement ? Un père trop tôt disparu ? Une mère sans ressources ? « Femme, écrit-il à propos de sa génitrice, je suis povrette et ancienne, Qui riens de scay ; Oncques lettre ne leu ». Sans doute, le chanoine a-t-il détecté en ce gamin, certes impétueux et un brin sauvage, des dispositions intellectuelles propres à en faire un bon ecclésiastique. Car François Villon poursuit, après la maîtrise, des études de théologie qu’il délaisse, vers 1451-1453, au profit d’une vie plus aventureuse dans laquelle il côtoie, dans un curieux mélange humain, prêtres en rupture de ban, étudiants débauchés, anciens mercenaires de la guerre de Cent Ans, tous laissés-pour-compte et déracinés sociaux. En réalité, un vrai produit d’une époque dépourvue de repères.
En ce temps-là, l’université de Paris est un vivier de contestations au roi Charles VII, qui trouvent son apogée en 1453-1454 à l’occasion d’une grande grève des professeurs. Tous les cours sont alors suspendus, mettant les étudiants à la rue et dans les cabarets. De cette période, Villon exprime maints regrets :
« Bien sçay, se j’eusse estudié
Ou temps de ma jeunesse folle
Et a bonnes mœurs dédié.
J’eusse maison et couche molle.
Mais quoy ! je fuyoië l’escolle
Comme fait le mauvais enffant
En escripvant cette parolle
A peu que le cœur ne me fent ! »
Ainsi, François Villon est-il amené à fréquenter à la fois un milieu fortuné et vertueux, sous la protection de son tuteur, ce qui lui vaudra plus tard d’échapper à la pendaison et de mauvais sujets avec lesquels il allie plaisir et ribote. Aux côtés des catins, joueurs et escrocs, il apprend le jargon des mauvais garçons et les expédients utilisés pour arriver à leurs fins.
La bande des Coquillards
« Je congnois quand pipeur jargonne »
En ce jour du 18 décembre 1455, Dijon et la Bourgogne respirent enfin. Quelques heures plus tôt, douze coquillards ont été exécutés après un procès qui a débuté le 3 octobre 1455, mené par Jehan Rabustel, procureur de Dijon. D’autres exécutions suivront les années suivantes dont celles de trois faux-monnayeurs, bouillis dans une chaudière sur la place de Morimont, à Dijon, selon la loi condamnant la fabrication de fausse monnaie.
La liste des noms de ces condamnés qui nous sont parvenus fleure bon la fripouille et la cour des Miracles : Dimenche le Loup ; Jacquot de la Mer ; Nicolas le Bègue… Parmi eux, Regnier de Montigny et Colin de Cayeux, deux compagnons de Villon, pendus l’un et l’autre et dont le triste sort inspirera l’auteur des Ballades. De la mauvaise engeance, tous agresseurs de bois et de chemins, larrons esteveurs, crocheteurs, envoyeurs (meurtriers), planteurs (faux-monnayeurs), joueurs de dés et de paume, proxénètes…
Ceux que Villon exprime dans les vers suivants :
« Car, ou sois porteur de bulles,
Pipeur ou hasardeur de dés,
Tailleur de faux-coins, et tu te brûles
Comme ceux qui sont échaudés,
Traîtres parjurs de foi vidés,
Sois larron, ravis ou pilles,
Où en va l’acquêt, que cuidez ?
Tout aux tavernes et aux filles ! »
Leur histoire ainsi que leur formation remontent à la fin de la guerre de Cent Ans quand des milliers de mercenaires sont abandonnés sur routes et chemins, sans autre moyen de subsister que de s’adonner au brigandage. Le terme de « coquillard » naît alors de ces hommes, déguisés en faux pèlerins, qui vendent de fausses coquilles de Saint-Jacques sur les grandes routes des pèlerinages. Le terme se généralisera ensuite pour évoquer le brigandage.
Ces bandes qui couvrent une partie du territoire s’organisent d’une façon pyramidale. A leur tête, un « roi des coquillards ». Au-dessous, « des maîtres », « des biens subtils », « des maîtres longs » et des « apprentis » au sein desquels se regroupent envoyeurs (tueurs), coupeurs de bourses (vendangeurs), joueurs de hasard (beffleurs) et rats d’hôtellerie (blancs coulons).
Un jargon approprié, le jobelin, difficile à décrypter pour un non-initié, leur sert de signe de reconnaissance. A ce titre, les interrogatoires des coquillards permettent lors de leur procès de découvrir le sens de ces mots chers à Villon, qui en connaissait la teneur. Fait-il lui-même partie des coquillards ? Aucun document ne l’atteste. Tout au moins en est-il très proche !
En cavale !
« Jamais mal acquit ne profite » (Ballade des Proverbes) »
5 juin 1455. La vie de François Villon bascule soudain dans le crime. Ce soir-là, jour de la Fête-Dieu, il traîne du côté de Saint-Benoît en compagnie d’un prêtre débauché et d’une nommée Isabeau, une ribaude peut-être dégottée dans quelques estaminets du quartier. Passe un autre prêtre qui se met à les invectiver avant de sortir sa dague de sous sa soutane et de fendre la lèvre de Villon. Quand bien même blessé, Villon fond sur son agresseur, le touche de sa dague à l’aine avant de le jeter à terre puis de l’assommer d’un coup de pierre. Devant l’arrivée imminente de la garde, Villon prend ses jambes à son cou. Transporté au couvent des Cordeliers, l’homme qui se nomme Philippe Sermoise décède le lendemain. Villon, qui s’est fait soigner entre-temps chez un barbier, quitte Paris pour se faire oublier. Six mois durant, il se réfugie à Bourg-la-Reine où il se perd dans les bras d’une abbesse et de quelques moniales qui n’ont pas froid aux yeux. Toujours ça de pris ! Le temps, avec l’aide de Guillaume de Villon, d’obtenir deux lettres de rémission au nom de François des Loges dit Villon et de François de Moncorbier dit Villon, qui le blanchissent de tout acte criminel dans cette rixe. Lettres par décision royale aujourd’hui conservées au Trésor des chartes, permettant d’en savoir un peu plus sur sa vie et ses écarts.
De retour à Paris, Villon retrouve ses mauvaises fréquentations. Parallèlement, il écrit « Le Lais », un long poème de 48 strophes dans lequel il tourne en dérision bourgeois, autorités judiciaires et religieuses. Le soir de Noël 1456, il franchit une nouvelle étape en dérobant la nuit, avec l’aide de complices, cinq cents écus dans le coffre de la sacristie du collège de Navarre, dans ce Quartier latin qu’il connaît comme sa poche. Le larcin sera découvert trois mois plus tard, laissant le temps à Villon de filer de nouveau. A Angers cette fois, à la cour du roi René, beau-frère de Charles VII et surtout féru d’art et de poésie. La notoriété littéraire de Villon est parvenue en Anjou et le duc lui offre une place de choix, assurant sa subsistance. Mais le démon de l’aventure pousse Villon vers d’autres chemins et contrées.
Des protections bienvenues
« En mon pays suis en terre loingtaine/Je riz en pleurs et attens sans espoir/Bien recueilly, débouté de chascun… »
1458-1463. Cinq années qui s’égrènent durant lesquelles François Villon passe de l’ombre à la lumière, croupissant dans les basses-fosses de prisons sordides ou déclamant ses vers dans les riches salons de quelques protecteurs fortunés et puissants. Cinq années où il semble se ranger, compose avant de retomber dans ses travers criminels. Comme si, brusquement, son habit d’honnête citoyen se faisant trop étroit, il se plait à revêtir les oripeaux du malfrat. L’appel du large, des chemins inconnus et des voies sans issue le presse de partir. De revenir à ses amours d’aventures. A son corps défendant à en croire quelques vers dans lesquels il exprime ses regrets. Mais l’appel est trop fort, trop puissant pour ne pas y répondre. Et repartir encore… et toujours, pour finalement disparaître à jamais du radar de l’Histoire.
Mais, en ce début d’année 1458, François Villon se trouve à Blois, à la cour du duc d’Orléans. Ce vieil homme de soixante-quinze ans, petit-fils de Charles V et prisonnier des Anglais durant vingt-cinq longues années, s’est épris de poésie et ouvre sa cour à tous les poètes. Lui-même compose. Villon lui dédie trois ballades et puis s’en va ! Peut-être fâché ! Un chavirement de plus dans son existence !
L’été 1461, à Meung-sur-Loire, Villon croupit dans une basse-fosse de l’évêque d’Orléans, Thibault d’Assigny. La cause ? Nul ne le sait mais laisse imaginer quelques larcins ou quelques rixes où les dagues ont dansé puis meurtri les corps. Il ne reverra la lumière que le 2 octobre 1461 quand Louis XI fait son entrée solennelle à Meung-sur-Loire. Paris manque à Villon. Fin 1461, n’y tenant plus malgré le risque d’être arrêté, il rejoint la capitale, son protecteur Guillaume de Villon et ses amis. Débute alors sa grande œuvre : « Le Testament ».
François Villon ne s’est pas pour autant offert une bonne conduite. Le 2 novembre 1462, son passé le rattrape. Arrêté pour un banal larcin, la justice revient sur le cambriolage du collège de Navarre, conditionnant sa libération au remboursement de la part du butin – 120 livres – payable en trois ans.
A peine sorti, Villon retrouve dès la fin novembre l’ombre du cachot du grand Châtelet. Ce soir-là, avec une bande de coquins, ils prennent le notaire Ferrebouc et ses clercs à parti. S’ensuit une bagarre qui se termine au cachot. Après avoir subi la question de l’eau, Villon est jugé puis condamné à être étranglé puis pendu au gibet de Paris. Sa tête, dès lors, ne tient plus qu’au fil d’une corde. Sa requête a peu de chance d’aboutir, vu son passé. Profitant des longues heures à espérer, il écrit la ballade des Pendus.
« Frères humains, qui après nous vivez,
N’ayez les cœurs contre nous endurcis,
Car, si pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tôt de vous mercis.
Vous nous voyez ci attachés, cinq, six :
Quant à la chair, que trop avons nourrie,
Elle est piéça dévorée et pourrie,
Et nous, les os, devenons cendre et poudre,
De notre mal personne ne s’en rie ;
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !… »
Pourtant, sans doute grâce aux protections dont il bénéficie, le Parlement de Paris, le 5 janvier 1463, casse le jugement et finit par bannir Villon de Paris pour dix ans.
Trois jours plus tard, il quitte Paris. Clap de fin ! Sa trace se perd sur les routes incertaines, nous laissant ses ballades qui sont le sel de sa vie. En vers et contre tout !
De ses guenilles est né un prince, de l’aube lumineuse au soleil couchant. Prince des gueux et des saute-ruisseaux. Brûleur de vie. Affamé de liberté. Comme le furent plus tard ces « mauvais garçons », Sade, Paul Verlaine et Jean Genet. Inaccessibles dans l’écoulement de leur fleuve.
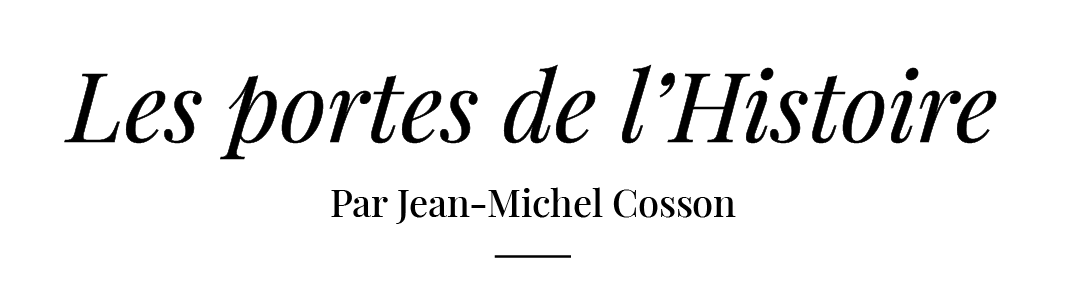
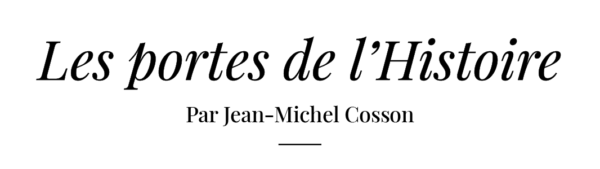
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !