Mona Lisa s’est envolée !
22 août 1911. Un vent de panique souffle sur le Louvre !
« Achetez Le Gaulois ! L’incroyable vol de La Joconde ! Achetez Le Gaulois ! »
L’homme qui saisit le journal tendu par le gamin, lui glissant une pièce de monnaie dans la main, se nomme Vincenzo Peruggia. À le regarder, personne ne pourrait se douter que celui qui presse le pas pour regagner sa modeste chambre de la rue de l’Hôpital Saint-Louis, dans le Xe arrondissement, vient d’accomplir, quelques heures plus tôt, le plus extraordinaire vol d’œuvre d’art, jetant l’émoi dans tout le pays.
Avec le sourire de celui qui a réussi, Perrugia entame la lecture : « Il faut se le répéter dix fois pour y croire et, malgré le mur vide, malgré la découverte du cadre d’où le panneau fut dévissé, malgré le néant des recherches d’une nuée de policiers fouillant le Louvre du haut en bas, il reste des sceptiques pour affirmer que ce n’est pas possible et que La Joconde, l’œuvre capitale de Léonard de Vinci, n’a pu être volée au Louvre. Le fait est, il faut le reconnaître, inouï; il demeure invraisemblable dans sa brutale réalité. Rien ne saurait mieux dépeindre le désarroi, l’affolement et la terreur que cette disparition a provoqués dans le personnel du Louvre, que ce mot que répétait avec accablement hier soir un des conservateurs, épuisé d’angoisse et peut-être de remords. La question du Maroc à côté de cela n’est qu’un banal incident. »
Aucune trace !
Vide ! L’emplacement est bien vide ! Ne demeurent à la place que quatre crochets entre deux tableaux de maître. Pour le brigadier Poupardin – le premier à avoir remarqué le pan de mur déserté –, il ne fait aucun doute que Mona Lisa s’est envolée. Et sûrement pas de son plein gré. À son côté, le gardien de salle, le copiste Louis Béroud et le secrétaire agent-comptable Galbrun restent bouche bée, abasourdis.
La recherche est lancée. Panique à bord du Louvre ! Fissa… Fissa… La Sûreté parisienne – le fameux 36 – galope au musée, flanquée d’une soixantaine d’inspecteurs. Fermeture des portes et des ouvertures donnant sur le toit ! Que personne ne sorte ! Le voleur peut encore se trouver dans l’enceinte du musée.
Rapidement, les limiers localisent le cadre Renaissance du tableau et la vitre qui recouvre d’ordinaire l’œuvre sous un petit escalier menant à La Victoire de Samothrace. Et sur le verre, une trace de doigt ! Pas un instant à perdre ! Le fameux Bertillon est dépêché sur place pour relever l’empreinte digitale et la comparer à celle des deux cent cinquante-sept employés du Louvre. Car il ne fait guère de doute que le coupable se trouve parmi eux. Patatras ! Bertillon fait chou blanc sur toute la ligne. Le directeur du Louvre, Théophile Homolle, n’a plus qu’à démissionner dans la foulée. À la presse désormais de s’emparer de l’incroyable nouvelle qui vient de tomber dans les rédactions et d’élaborer des suppositions sur le mobile du vol comme le fait Le Figaro en date du 23 août : « Ici, l’enquête ne peut que rencontrer des probabilités. Mais que fera le voleur de son merveilleux butin ? Le vendre ? A qui ? Quel est le mécène qui serait assez imprudent pour accrocher dans sa galerie une Joconde qu’on lui prouverait être celle du Louvre ? Des copies anciennes, on en connaît : par exemple celle de Woodburn, à Londres, celle de Lyversberg, à Cologne, celle de Munich, celle qui fit partie de la collection du cardinal Fesch, vendue en 1845 et dont quelques accessoires différaient des autres. Mais la Joconde du Louvre, celle dont le dessin original fit partie de la collection Villardi, à Milan, qui donc oserait le geste de l’acheter, si ce n’est pour faire immédiatement pincer le voleur ?
Qu’on se rappelle qu’il n’y a pas de prescription pour les biens de l’Etat […] Par conséquent, si le voleur de la Joconde a l’espoir d’en tirer les millions qu’elle vaut, il lui faudra déchanter : pour la loyauté des amateurs, et pour l’honneur des antiquaires, j’entends les grands antiquaires capables de risquer une fortune sur un objet unique, rare, incomparable, la négociation est tout à fait invraisemblable. Donc, le bénéfice ne pourrait venir que d’une revente à l’Etat. Il faudrait supposer au voleur une âme audacieuse et qui ne craindrait pas les aventures téméraires. »
Dans un Paris qui bruisse déjà du vol, Vincenzo Peruggia accélère le pas, l’œil aux aguets, son journal sous le bras. Lui sait !
L’ouvrier vitrier italien connaît bien le Louvre. Il a même vécu une histoire presque intime avec Mona Lisa puisque c’est lui qui a installé la vitrine de protection de La Joconde, quelques semaines plus tôt. Il lui a donc suffi de se rendre au Louvre le lundi, jour de fermeture, de se mêler sans être inquiété aux employés de service, de décrocher le cadre du tableau et de le cacher sous sa blouse. Enfin, de franchir les portes du Louvre avant de le déposer dans sa modeste chambre, sous le plateau de sa table. Peruggia a bien fait ! Quelques jours plus tard, un inspecteur cogne à sa porte. Interrogé, l’ouvrier vitrier ne laisse rien paraître de son émoi. Il ne sera plus inquiété dans l’enquête. L’inspecteur est passé bien près de la vérité !
Mona Lisa, Apollinaire et Picasso
Mais quelles raisons ont bien pu pousser Vincenzo Peruggia à prendre un tel risque ? En réalité, l’ouvrier vitrier n’a jamais véritablement dévoilé les raisons de sa folle entreprise : un amour fou pour Mona Lisa au point de l’enlever ? Mais pourquoi aurait-il alors tenté de la vendre deux ans plus tard ? Un geste patriotique pour restituer à l’Italie ce trésor que Peruggia croit avoir été dérobé par Napoléon ? C’est alors faire fi de l’Histoire, Mona Lisa ayant été achetée par François Ier à son cher Léonard. Manipulation politique dans une Europe déjà en crise ? Commande d’un faussaire argentin ? Ressemblance de Mona Lisa avec une amie d’enfance disparue ? Tout y est passé ! Car les pistes sont alors bien maigres. Aussi les inspecteurs se rattachent-ils au moindre indice et au moindre soupçon. C’est ainsi que la Sûreté générale débarque le 7 septembre chez Guillaume Apollinaire.
« L’enlèvement de la Joconde, écrit Le Journal, vient d’avoir une conséquence au moins inattendue : l’arrestation de M. Guillaume Kostraviski, plus connu sous le nom de Guillaume Apollinaire, homme de lettres et rédacteur à Paris-Journal. Cette arrestation, autour de laquelle on a fait le plus grand mystère, a été opérée, avant-hier soir, dans les circonstances suivantes :
On sait qu’à la suite de la disparition de la Joconde et de l’émotion que cet événement souleva dans le public, un personnage qui avait volé au Louvre des statuettes phéniciennes fut pris d’inquiétude et pensa que l’instant était opportun de restituer les objets dérobés.
Comme le voleur était d’origine slave, il s’adressa à M. Guillaume Apollinaire, qui le mit en relation avec Paris-Journal. Les statuettes furent rendues et, par l’intermédiaire de notre confrère, retournèrent au musée du Louvre.
C’est à la suite de ces faits que M. Guillaume Apollinaire vient d’être mis en état d’arrestation sous l’inculpation de complicité de vol par recel. »
Guillaume à table ! Le malheureux poète a eu la malchance d’engager un secrétaire qui est en fait une fieffée canaille. Parmi ses faits de haut vol, des statuettes primitives phéniciennes qu’il a chipées au Louvre avant de tenter de les revendre à Paris-Journal, quelques jours après le vol de La Joconde. Le problème, c’est qu’Apollinaire, associé avec Picasso, lui a acheté quelques mois plus tôt des statuettes similaires, croyant à une plaisanterie. Guillaume à table ! Quand l’auteur du Pont Mirabeau apprend la nouvelle du vol de La Joconde, il décide de les rendre au Louvre, par l’intermédiaire de Paris-Journal. Erreur fatale ! La police, sur les dents, débarque chez lui et l’interroge avant de le mettre sous dépôt pour recel. Vent de fronde dans le milieu culturel. Arrêté le 7 septembre, Apollinaire est libéré le 12.
Quant à la police, elle piétine. Nulle trace de La Joconde. À jamais perdue ? C’est du moins ce que tout le monde craint, le temps passant. Et pour combler le vide, l’administration du Louvre décide dès décembre 1911 de remplacer le célèbre portrait par le “Baldassare Castiglione” de Raphaël.
Sept mois de prison pour Peruggia
Peruggia aurait pu vivre une histoire d’amour solitaire. Un huis clos entre Mona Lisa et lui. Le tête-à-tête quotidien dans le secret de sa chambre durera deux ans. Puis l’Italien décide de regagner son pays natal, Mona Lisa en poche. La voilà revenue aux sources ! À Florence. Une renaissance.
Peruggia succombe aux sirènes de l’argent quand, répondant à la petite annonce d’un antiquaire florentin désireux d’acquérir des œuvres, il propose un rendez-vous. Et pas le moindre. Il s’agit pour l’antiquaire d’acquérir ni plus ni moins que La Joconde. Plaisanterie de mauvais goût ou pas, Alfredo Geri décide de se rendre au rendez-vous, mais accompagné du directeur du musée des Offices. Le 10 décembre 1913, les deux hommes gagnent l’hôtel Tripoli. Face à eux, un homme qui, discrètement, sort de son manteau La Joconde. L’œil avisé du directeur des Offices reconnaît aussitôt l’original. Dans les minutes qui suivent cette étonnante rencontre, ils avisent la police, qui cueille notre Italien sans coup férir.
La nouvelle fait sensation en Italie et en France. Mona Lisa, avant d’être restituée à la France, a même droit à un tour d’honneur patriotique à travers la péninsule italienne, de Rome à Milan. Fin de la cavale : La Joconde retrouve le Louvre le 31 décembre 1913 comme le révèle Le Petit Parisien en date du 5 janvier 1914.
« Dès dix heures, hier matin, les Parisiens ont été admis à défiler au Louvre, devant la Joconde qui, la veille, on le sait, avait réintégré son ancienne place. On n’accédait au salon Carré que par une seule entrée, place du Carrousel. En prévision de l’affluence, des vestiaires avaient été organisées sous les galeries couvertes du palais. Des agents en uniforme, d’autres en bourgeois, des gardes municipaux se tenaient à l’extérieur; il en était de même dans les galeries intérieures, dans les salles, où ils assuraient, avec le concours des gardiens du musée, une surveillance de tous les instants. »
Peruggia, de son côté, passe devant les juges italiens en juin 1914. Condamné à un an et quinze jours de réclusion, il n’accomplit que sept mois et huit jours avant d’être libéré. Entre-temps, un événement encore plus dramatique lui a volé la vedette. Désormais, il n’est plus question de la disparition d’une œuvre majeure mais de celle de millions d’hommes.
Perrugia, libéré, servira dans l’armée italienne avant de se marier, de rentrer en France et d’ouvrir un magasin… de peinture.
« Mon grand-père a volé Mona-Lisa, écrit son petit-fils, parce qu’il voulait faire quelque chose de retentissant contre le fait que Napoléon ait volé beaucoup d’œuvres d’art à l’Italie. Il a choisi Mona-Lisa parce que la toile était de petite taille et facile à transporter. »
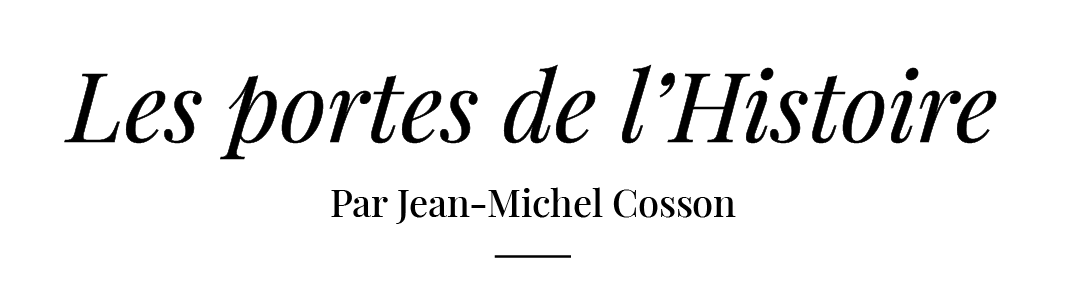
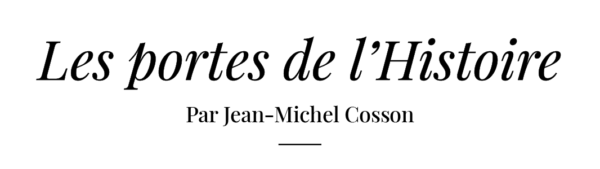
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !