On ne badine pas avec la mort
Affaire Jean Terry. Rodez et La Loubière. Cour d’assises de l’Aveyron. 22 juin 1910.
Intelligente, bonne, douce, travailleuse, d’un caractère enjoué, à seize ans, Adrienne Pons voit la vie lui sourire comme un beau fruit mûr et doré. Certificat d’études en poche, ses parents l’ont inscrite à l’Ecole supérieure de Rodez où Adrienne donne entière satisfaction à ses maîtresses. Sa voie est toute tracée. Elle sera institutrice, comme sa mère.
Le 18 avril 1910, pour Adrienne, est un jour comme tous les autres. Après avoir pris son petit déjeuner et embrassé sa mère une dernière fois, la jeune fille quitte le ferme familiale de Pessens pour rejoindre, par un chemin pentu et solitaire, la station ferroviaire de Canabols. La petite gare n’est pas très éloignée et l’écolière profite des premières lueurs du jour pour regarder la nature s’éveiller au printemps. En contrebas, l’Aveyron s’est nappée dans la nuit d’un chemin de brume qui suit le courant. De petits bouquets de fumée s’échappent convulsivement des fermes des alentours comme autant de bateaux à vapeur perdus sur la terre ferme.
Dans le train, Adrienne retrouve une camarade d’école, Gabrielle Cassan, âgée de treize ans, habitant la commune voisine de Gages.
De Canabols à Rodez, le train met une vingtaine de minutes pour atteindre la gare. Juste le temps de bavarder avant de gagner l’école Flaugergues où Adrienne et Gabrielle se séparent. Rendez-vous est pris pour le retour du soir.
A midi, Adrienne ne mange pas avec ses camarades, mais se rend à l’auberge de la rue Saint-Cyrice où elle déjeune en compagnie de son jeune frère, pensionnaire à Rodez. Ce jour-là, elle quitte l’établissement vers 13 heures 15. A 18 heures, les cours terminés, Adrienne Pons et Gabrielle Cassan descendent d’un pas joyeux la rue Saint-Cyrice, puis la côte Saint-Eloi.
Le train de 7 heures du soir en direction de Millau est entré depuis quelques minutes en gare quand les deux amies s’installent sur les bancs du wagon de troisième classe. De là, elles peuvent aiguiser leur curiosité espiègle à dévisager les voyageurs.. Elles sont bientôt rejointes par une amie de Gabrielle, Maria Vigouroux, une jeune apprentie de quinze ans, habitant Bedennes, commune de Montrozier.


A 19 heures, au signal du chef de gare, la locomotive secoue sa grosse carcasse d’acier, fait jaillir d’épaisses bouffées de vapeur, puis, démarre en petites secousses qui ébranlent les compartiments des wagons de voyageurs. Les trois jeunes filles aperçoivent alors sur le quai un homme qui s’élance vers le train pour agripper la rampe du compartiment voisin. Maria Vigouroux le reconnaît immédiatement comme étant Jean Terry, un mineur de fort mauvaise réputation, buveur et violent, qui loge chez un aubergiste de Gages, à proximité du domicile de ses parents. Plusieurs fois, sa mère l’a mise en garde de ne pas se retrouver seule en sa compagnie. Inquiète, Maria se confie à Gabrielle Cassan :
« Si Terry descend à Gages, il faut se faire accompagner chez nous par un employé des chemins de fer. »
Jean Terry est un introverti, un loup solitaire que de soudaines colères ou des pulsions sexuelles entraînent parfois hors de sa tanière pour se rassasier.
Né à Aurillac en novembre 1881, paresseux, dissipé, débauché, Jean Terry a très tôt eu maille à partir avec la justice, au grand désespoir de ses parents qui ne savent que faire d’un fils aussi inconséquent. Le 16 février 1901, le tribunal d’Aurillac le condamne pour vol à un mois de prison avec sursis. Comme il n’y a que le premier pas qui compte, il subira quatre condamnations supplémentaires, dont l’une pour menaces de mort.
Terry débarque à Rodez en 1908. Employé chez un camionneur de la ville, il est renvoyé presque aussitôt avant de trouver une place aux mines de Gages. Il prend alors pension chez Auguste Palous, aubergiste au Candelou, commune de Montrozier.
Le 18 avril 1910, jour de repos, Jean Terry se rend à la halte de Canabols et prend un aller et retour pour Rodez. Il n’y a guère de monde dans le comportement et son regard croise sans s’arrêter celui d’Adrienne Pons. Depuis plusieurs jours, il a remarqué cette belle jeune fille, portant sacoche d’écolière et robe de belle façon. Secrètement, il l’épie, la suit discrètement deux ou trois fois quand, de la gare de Canabols, la jeune Adrienne s’enfonce à travers bois pour rejoindre la ferme familiale. Rapidement, Jean Terry acquiert la certitude qu’Adrienne parcourt seule ce chemin, souvent désert à cette heure tardive.
Parvenu à Rodez, Terry passe la journée à déambuler de café en café sans boire outre mesure. Néanmoins, il ne peut s’empêcher de commettre quelques larcins parmi les commerçants de la ville. A l’hôtel du Commerce, il prend d’abord à partie une domestique, Marie Terral, qui refuse de lui prêter un couteau.
« J’en ai besoin pour ce soir », lui dit-il.
Continuant son chemin, il s’arrête chez un primeur auquel il chaparde une orange en criant :
« Celle-là est pour la blonde! »
L’heure venue, Terry descend à la gare de Rodez pour attraper le dernier train. Dans le compartiment voisin du sien s’est assise Adrienne Pons, sa beauté, sa joie de vivre et son innocence de jeune fille. Arrivé à Canabols, Terry descend du train en essayant de ne pas se faire remarquer. Aussitôt, il s’engage sur la grande route qui mène à Rodez, d’où, par un chemin qu’il a repéré, il réussit à devancer la jeune fille qu’il accoste dans un endroit désert.
A 21 heures, Hippolyte Pougenq, cultivateur à Pessens, finit de traire ses vaches quand François-Louis Pons l’interpelle à la porte de l’étable :
« Adrienne n’est pas encore rentrée. Ce n’est pas dans ses habitudes de traîner en route. Je pars à sa recherche.
-Je viens avec toi. La nuit tombe et il faut faire vite. »
Les deux hommes remontent le chemin emprunté par Adrienne, sans rien trouver. De plus en plus inquiets, ils décident de fouiller les bois des Palanges où il est facile de se perdre. A 3 heures du matin, ils doivent se rendre à l’évidence. Malgré les appels, les tours et les détours à travers bois, Adrienne demeure introuvable.
Le temps de prendre un morceau de lard sur une tranche de pain et les deux compères reprennent leurs recherches. Une heure plus tard, alors que le soleil commence à grignoter la nuit d’une lueur blafarde, un cri déchirant fait se dresser Hippolyte Pougenq. A quelques dizaines de mètres, François-Louis Pons vient de découvrir le corps de sa fille, à cinq cents mètres à peine de la station de Canabols. Et la vision qu’il en a le pétrifie d’horreur et de vengeance.
Propriétaire à Sainte-Radegonde, Ignace Ferrié a obtenu depuis quelques années la charge de cantinier du champ de tir, lieu d’entraînement pour les soldats du 122e R.I. De Rodez. Il est environ 9 heures du soir quand un inconnu pénètre dans la cantine et lui commande un verre de vin. En homme averti, le cantinier remarque sa nervosité, l’inconnu ne cessant de jeter des regards fréquents et inquiets vers la porte. Son écot payé, l’homme se lève et sort sans un mot. Ignace Ferrié se précipite vers la fenêtre et l’aperçoit deux fois en train de faire le tour du réduit de la cible.
« Encore un de ces maraudeurs qui tente de chaparder du matériel ! » pense-t-il en maugréant.
Muni d’une chandelle, Ignace Ferrié sort sur le pas de la porte, fait le tour du réduit et constate que la porte a bel et bien été fracturée. Pourtant, à l’intérieur, rien ne bouge !
« Le gars, se dit-il, se sera enfui en m’entendant. » Haussant les épaules, il décide d’aller se coucher.
Le lendemain matin, pour s’éviter des ennuis, le cantinier signale le fait aux autorités militaires de Rodez. Accompagné de quelques sapeurs, le sergent-chef Albin Salvatger se rend à la butte de tir et constate l’effraction. Sans hésiter, il ordonne à ses soldats de changer les cibles de place. C’est alors que l’un d’entre eux surprend un homme caché qui déclare aussitôt exercer le métier de trimardeur.
Après la découverte du corps d’Adrienne Pons, Hippolyte Pougenq a couru alerter la gendarmerie. Le Parquet, accompagné de la maréchaussée, se porte rapidement sur les lieux. Plusieurs témoins, susceptibles de fournir des renseignements sont interrogés à propos des passagers descendus avec Adrienne Pons au train de 19 heures. Un fait intéressant retient l’attention des enquêteurs. La garde-barrière, Maria Castan, décrit en particulier un homme de forte corpulence, au visage un peu bestial, portant casquette et habit de mineur. Les soupçons ne tardent pas à se porter sur jean Terry, bien connu des services de police. Vérification faite, il n’a pas couché à Gages. Les gendarmes acquièrent la certitude que Terry se cache dans la région. Ils se lancent alors à sa recherche.
Pierre Besombes, gendarme à Rodez, arpente le plateau de Sainte-Radegonde quand il apprend qu’un individu, répondant au signalement donné, se trouve au dépôt du champ de tir. Aussitôt rendu, il le reconnaît comme étant l’homme recherché et l’arrête sur le champ.
Dans une petite ville provinciale comme Rodez, où les rumeurs et les nouvelles se répandent aussi vite que les épidémies de peste, le meurtre d’Adrienne Pons fait l’effet d’une bombe. Dès l’annonce de l’arrestation du coupable présumé, une foule importante se rassemble à proximité de la prison. Quand Jean Terry arrive, encadré par les gendarmes, elle tente de le lyncher.
Le 22 juin 1910 s’ouvre devant les assises de l’Aveyron le procès de Jean Terry. M. Brocard, conseiller à la Cour d’appel de Montpellier, en assure la présidence, entouré de ses assesseurs, MM. Vandelet et Dijols. Le ministère public est représenté par M. Seilhan, procureur de la République. Quant à la défense de Terry, elle est assurée par un jeune avocat du barreau de Rodez, maître Colomb.
Dès 4 heures du matin, Terry est transféré de la prison au palais de justice pour éviter les manifestations qui ne manqueraient pas d’éclater sur son passage. Dans le climat passionnel qui entoure l’affaire, les autorités ont pris la sage décision de mettre en place un service d’ordre sans faille.
L’horreur du crime et la mauvaise publicité faite à l’accusé n’ont pas manqué d’attirer aux abords du palais de justice une foule compacte, qui se rue vers la salle d’audience dès l’ouverture des grilles.
A 8 heures trente, la Cour fait son entrée devant une salle archicomble et électrique, prête à s’enflammer au moindre incident. Pendant que le greffier donne lecture de l’acte d’accusation, Terry baisse les yeux. Sa physionomie prend alors un aspect extraordinairement farouche. Dans sa veste de bure des prisonniers, il paraît encore plus grand qu’on aurait pu l’imaginer. Ses mains énormes ressemblent à des battoirs. Contrairement à sa face allongée, son front est petit, plissé et ridé. Aux premières questions du juge, Terry répond d’une voix claire et métallique :
« A vingt ans, vous avez été condamné plusieurs fois pour vol ! lui demande le président.
-Oui, répond brièvement l’accusé.
-Et en 1907, pour une affaire d’assassinat à Aurillac, la gendarmerie vous a arrêté de nouveau !
-Je n’y étais pour rien.
Mon client, monsieur le Président, a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu dans cette affaire, intervient maître Colomb. Il ne peut donc être inquiété pour ces faits. »
Un murmure se répand dans la salle.
« Terry, racontez à la Cour ce qui s’est passé le 18 avril dernier ! poursuit le président.
-Je ne me rappelle pas ! »
Le président renouvelle sa question. La figure de Terry se ferme à l’évocation de la scène terrible. Ses sourcils se baissent, le nez se pince, la mâchoire remonte, s’accuse davantage et tout son visage exprime une certaine bestialité, accentuée par son attitude dégingandée. Terry déclare qu’il a voyagé le matin dans le même compartiment qu’Adrienne Pons. Il reconnaît ses pérégrinations dans les diverses auberges de la ville, mais prétend ne pas avoir eu l’idée arrêtée de commettre le crime. La défense de Terry est claire : pour obtenir les circonstances atténuantes, il doit à out prix se défendre d’un acte prémédité.
« Vous vous êtes pourtant rendu à l’auberge de Saint-Cyrice où déjeunait habituellement Adrienne Pons ? remarque le président.
-Je ne savais pas qu’elle s’y trouvait ! »
Au moment d’aborder les détails du crime et les rapports des médecins, le président requiert le huis clos. Sage décision qui interdira aux amateurs de sensations fortes de se pâmer d’horreur devant le récit du crime ou de s’insurger en manifestant à haute voix leur colère.
Le tribunal est alors le théâtre d’une scène surprenante. Tandis que les gendarmes font évacuer la salle, un groupe de dames de la bonne société ruthénoise se réfugie dans l’ombre de la tribune pour assister aux débats et éprouver le grand frisson aux déclarations des médecins.
Terry raconte avoir rencontré Adrienne Pons à l’endroit prévu. A sa vue, elle avait tressailli, songeant aux paroles de ses mies. De force, il l’avait prise par la main, puis l’avait emportée dans ses bras avant de la violer et de l’étrangler.
Le rapport du docteur Bonnefous est accablant. Avec conviction, il démontre que le crime de Terry a été prémédité, affirmant en substance que l’accusé est entièrement responsable de ses actes.
La fin de la matinée se termine par le long défilé des témoins. La tension monte d’un cran quand François-Louis Pons et Hippolyte Pougenq rappellent devant une salle muette et tremblante les circonstances de la découverte macabre de la jeune Adrienne.
L’audience de l’après-midi est consacrée au réquisitoire et aux plaidoiries. D’entrée, le procureur Seilhan, s’adressant aux jurés, avoue que le crime de Terry est « le plus monstrueux qui lui est été donné de voir, d’entendre parler au cours de sa longue carrière de magistrat ».
« Terry n’était pas ivre. Le crime est le résultat d’un plan, d’une volonté très nette qu’il est parfaitement possible de suivre tout le long de la journée. »
Avant de conclure :
« Terry est violent, paresseux, débauché. Son acte est celui d’un pervers, d’un responsable. La justice ne peut être que l’expiation capitale pour Terry. On ne peut lui accorder les circonstances atténuantes. »
La salle applaudit, mais déjà maître Colomb se lève pour entamer sa plaidoirie. Sa tâche promet d’être lourde, pénible et ingrate.
Au contraire du procureur Seilhan, l’avocat plaide l’irresponsabilité partielle de l’accusé, présentant son client comme un anormal et un détraqué.
« Il y a dans l’action abominable de Terry une part d’irresponsabilité due à des tares physiques. Vous, Messieurs les jurés, né cèderez pas à la pression de l’opinion publique ! »
Après lecture des questions, le jury se retire à 16 heures 40 pour délibérer. Les jurés ont à répondre à huit questions, relatives au vol, à la préméditation, au viol et à l’assassinat. En attendant, on sert à Terry une assiette de soupe. Quand quelqu’un lui demande ce qu’il pense du réquisitoire et de la plaidoirie, il répond :
« Je me demande comment ces gens-là peuvent parler si longtemps sans boire. »
Le jury regagne la salle à 17 heures 14, avec un verdict affirmatif sur toutes les questions et aucune circonstance atténuante. En conséquence, Terry est condamné à la peine de mort avec exécution sur une place publique de Rodez. Dans son box, l’accusé ne bronche pas. Nerveusement, il essaye de boutonner sa veste de grosse bure.
La salle accueille le verdict avec soulagement tandis que Terry, encadré d’agents, de gendarmes et de soldats, baïonnette au canon, est reconduit impasse des Capucins sous les huées et les coups de sifflet.
En 1910, Terry n’est pas le seul prisonnier à attendre dans l’antichambre de la mort. Six autres condamnés espèrent bénéficier d’une grâce présidentielle. Parmi eux, l’un des célèbres chauffeurs de la Drôme, Lamarque, qui redoute de rejoindre ses compagnons d’infortune, guillotinés l’année précédente.
Adversaire déclaré de la peine de mort, le Président Armand Fallières est longtemps demeuré fidèle à ses convictions. De 1906 à 1909, contre vents et marées, il a gracié à tour de bras cent trente-trois condamnés à mort. Mais le mécontentement avait gagné la population. Les quotidiens, notamment, n’hésitent pas à affirmer que, depuis l’élection de Fallières, les condamnés signent leur recours en grâce en haussant les épaules. Le Président ne dut céder qu’en 1909 devant une opinion publique en ébullition qui demandait la tête de Pollet, coupable d’avoir ensanglanté le département du Pas-de-Calais pendant trois ans. Cette année-là, se déroulera la double exécution de Besse et Simorre à Albi, suivie de la triple exécution des chauffeurs de la Drôme, accusés d’une vingtaine de crimes. En dépit de la volonté déclarée d’Armand Fallières, la guillotine revient donc en force, le bourreau n’est plus réduit au chômage et l’opinion publique manifeste sa satisfaction en acclamant Deibler et ses aides.
Pour Terry, l’affaire se présente donc mal. Les 9 et 11 août, Armand Fallières gracie deux criminels, Corbin et Magot. Mais le 13, comme si le Président voulait rétablir l’équilibre, il rejette la grâce de deux condamnés à mort en Algérie. Il part ensuite en croisière sans avoir répondu aux quatre lettres que lui fait parvenir l’avocat de Terry.
Après plus de soixante-dix jours d’attente, la situation devient intolérable. Les rumeurs les plus folles courent dans les rues de Rodez sur le sort réservé à Terry, suite aux informations parues dans la presse régionale. Le 4 septembre, le Courrier de l’Aveyron écrit notamment « qu’on attend pour se prononcer sur Terry qu’il soit statué en même temps sur le sort du dernier chauffeur de la Drôme, Lamarque, condamné à mort par la Cour d’assises depuis trente-sept jours. Cette attente aurait pour but de ne pas déplacer deux fois les bois de justice ». Car, pour la population, il ne fait aucun doute que Terry sera exécuté.
Le 13 septembre, les quotidiens dévoilent à des lecteurs de plus en plus avides de nouvelles à sensation l’entrevue que le Président Fallières a enfin accordée à maître Colomb. « Le Président était encore en pleine hésitation et il ne laissait rien transpercer de ses intentions. Il fut en particulier très frappé par l’exposé de l’avocat aveyronnais sur la nature psycho-physiologique de Terry. »
De retour à Rodez le 17 septembre, maître Colomb se rend à la prison pour parler à Terry de son entrevue. Il trouve son client étrangement détendu, fumant dans sa cellule et discutant avec ses gardiens. Terry lui fait alors part de son impatience d’aboutir rapidement à une décision.
C’est aussi le cas des Ruthénois, mais pour des raisons bien différentes. Toutes les nuits, sentant l’imminence de l’exécution, des attroupements considérables se forment autour de la prison, faisant craindre des débordements.
Un fait divers précipite la condamnation de Terry. Tandis qu’Armand Fallières réfléchit sur son cas, la police parisienne met la main sur un soldat coupable d’avoir commis des actes sadiques sur une fillette. La sanction, dès lors, est irréversible. Quatre jours plus tard, deux autres condamnés à mort sont exécutés à Oran. Pris dans cette spirale, rien désormais ne semble pouvoir sauver Terry de la guillotine.

Paris. Le 26 septembre 1910. Au ministère de la Justice.
« Monsieur l’exécuteur des arrêts criminels, le président de la République a rejeté hier le recours en grâce de Jean Terry. Voici votre ordre d’exécution. Veuillez prendre toutes les dispositions pour qu’elle se déroule le 29 septembre à Rodez dans les meilleures conditions.
-Vous pouvez avoir confiance, Monsieur le Directeur des Affaires criminelles et des grâces.
-Je sais, Deibler, je sais. »
Depuis qu’il a signé un long bail avec la guillotine -sa première tête est tombée sous le couperet le 12 janvier 1899, à Troyes- Anatole Deibler sait qu’on ne badine pas avec la mort. Muni de son ordre de mission, il organise aussitôt l’expédition dans ses moindres détails.
Deibler commence par donner rendez-vous à ses trois aides pour le lendemain soir. Puis il se rend rue de la Folie-Regnault, dans un hangar situé au coeur de Paris où la guillotine est entreposée en pièces détachées. Il ordonne alors de la faire transporter à la gare du Quai d’Orsay où un wagon plate-forme, obligatoirement bâché, lui est réservé. Revenu à son domicile, 39, rue de Billancourt, Anatole Deibler réserve deux chambres à Rodez pour la nuit du 28 au 29 septembre et en profite pour retenir le fourgon qui acheminera la machine sur le lieu d’exécution. Il est 3 heures de l’après-midi. Le temps de fumer une pipe et Deibler invite sa femme à flâner le long des boulevards.
L’habit ne fait pas le moine, encore moins le bourreau. Vêtu d’un pardessus noir et coiffé d’un melon, le regard bleu et perçant adouci par une barbe blonde bien taillée, Anatole Deibler débarque à Rodez avec ses aides le 28 septembre, au train de 9 heures 20, dans la plus stricte discrétion, comme l’exige d’ailleurs sa charge de fonctionnaire d’état. Un omnibus de l’hôtel Lacombe est chargé de les amener directement au palais de justice. L’exécuteur en chef s’entretient trois quarts d’heure avec le procureur de la république avant de rejoindre ses aides à l’hôtel de l’Univers. À 11 heures 30, il se rend à pied à la préfecture où l’attendent les autorités administratives, militaires et judiciaires. Il s’agit avant tout de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser le service d’ordre.
À la mairie de Rodez, place Adrien-Rozier, le maire Louis Lacombe, le préfet et le procureur de la république l’attendent. L’heure de l’exécution est rapidement fixée : 5 heures et 14 minutes. Reste le lieu où se déroulera l’exécution. La prison, trop proche de l’hôpital, ne permet pas ce genre de manifestation qui risquerait de choquer les malades. Du reste, son accès est trop étroit. Le procureur de la République propose alors le palais de justice, face à la maison Bousquet, boulevard Gally.
« La place est large, bien délimitée, il sera facile de contrôler la foule des curieux qui ne manquera pas de se déplacer. La guillotine sera dressée à l’extrémité de la partie du boulevard longeant l’entrée du tribunal d’un côté, l’hôtel de l’Univers et les immeubles Bousquet de l’autre. »
Le maire Louis Lacombe acquiesce et fixe les arrêtés municipaux qu’il a pris pour éviter tout incident.
« Dès 21 heures, le palais de justice sera complètement cerné par cent cinquante gendarmes à cheval et cinq cents soldats du 122e Régiment d’infanterie de Rodez. J’ai demandé au capitaine de gendarmerie que soient installées en batterie, dans la cour du palais, deux pompes à incendie ainsi qu’une ambulance du régiment avec tous ses accessoires. La rue Combarel qui mène de la prison au palais sera aussi bouclée. Tous les cafés devront fermer à l’heure réglementaire. Interdiction formelle de photographier. »
Satisfait, Anatole Deibler prend congé puis se dirige vers le palais de justice. Il examine les lieux, prend discrètement quelques mesures, puis s’éloigne incognito vers son hôtel où ses aides l’attendent pour déjeuner.
Tout l’après-midi, il règne dans les rues une étrange atmosphère où, dans un calme apparent, prend corps une effervescence diffuse. Par les derniers trains sont arrivés à Rodez de nombreux habitants des régions voisines qui déambulent dans les rues ou prennent d’assaut les cafés de la ville pour tuer le temps. Les conversations tournent la plupart du temps autour de l’exécution et bien des Ruthénois avouent leur désir de participer au cérémonial de la mise à mort. Personne, sur la place d’Armes ou près de l’évêché, n’a reconnu celui qui sera dans quelques heures l’exécuteur de leur sinistre passion. Car, en fin connaisseur de monuments historiques, Anatole Deibler ne manque pas de visiter la cathédrale dont il admire le clocher flamboyant.
A 20 heures, le centre de Rodez ressemble à un camp retranché. La rue Combarel a été transformée en bivouac par les soldats qui déambulent silencieusement tandis que les gendarmes, drapés dans leurs pèlerines, tirent leurs chevaux par la bride.
Il est deux heures du matin quand arrivent à la préfecture les membres accrédités, porteurs d’une carte spéciale et nominative, délivrée par le préfet de l’Aveyron. Il y a là des conseillers généraux, les publicistes accrédités, les autorités judiciaires et quelques privilégiés, tous guindés dans leurs habits du dimanche. Encadré par quatre gendarmes, le groupe se dirige vers le lieu d’exécution dans le cliquetis des harnachements des chevaux. L’heure tardive de l’exécution, fixée au lever du soleil, a sans doute dissuadé les habitants d’envahir trop tôt les rues et les abords immédiats du palais de justice. Mais, après 3 heures du matin, une véritable marée humaine se tient derrière les cordons de la troupe.
Une heure plus tôt, le réveil a sonné dans la chambre d’Anatole Deibler. L’exécuteur se lève, s’habille, puis, prend la précaution de passer dans la chambre de ses aides. Tous les quatre, après avoir déjeuné, descendent à pied à la gare. Les caisses plombées se trouvent déjà sur le fourgon. Douze gendarmes sont chargés d’accompagner le convoi lugubre qui doit passer par la rue Raynal et l’esplanade du Foirail. Le long des trottoirs, des ombres circulent, chuchotant à voix basse sur cet étrange cortège où, seuls, les sabots des chevaux résonnent dans le silence de la nuit.
Arrivés sur place, Deibler et ses aides se mettent aussitôt à monter le sinistre jeu de construction. Le travail est délicat et difficile. Avec un soin particulier, les exécuteurs assurent les madriers sur le sol ; ils vérifient avec un niveau d’eau la parfaite horizontalité de la construction. Puis, rapidement, ils fixent les deux grands bras au sommet desquels brille le couperet qu’un clair de lune argente.
Deibler est là pour tout éprouver. D’un geste vif, il déclenche par trois fois l’ouverture du couperet qui claque d’un coup sec tandis que les abords se remplissent encore de spectateurs venus assister au dernier acte de la vie de Terry.
La suite n’est qu’une lente et douloureuse approche de la mort, une marche funèbre au rituel sauvage. Dès la fin des préparatifs, le procureur Seilhan, le préfet Buellet, l’avocat de Terry, maître Colomb, l’abbé Brugier et quelques fonctionnaires se rendent à la prison. Un gardien ouvre la porte, sans bruit. Terry dort profondément. Les gardiens le secouent. Il se lève sur son séant, regarde avec surprise, dans le brouillard du sommeil, ces hommes qui se penchent sur son lit.
« Jean Terry, votre recours en grâce a été rejeté. Ayez du courage ! »
Imperturbable, étonnamment maître de lui, Terry saute de son lit et s’habille seul.
« Donnez-moi mon gilet, demande-t-il, je pourrais prendre froid et trembler ; et puis je veux l’emporter. »
Après s’être entretenu avec son avocat et l’abbé Brugier, Terry demande à entendre la messe. Quand le prêtre le fait communier, il paraît, pendant quelques instants, profondément réfléchir, puis regarde ses gardiens et leur envoie un sourire comme un remerciement.
Terry crâne devant la mort. Il la défie de lui imposer sa loi du repentir et refuse de s’abaisser devant elle en tremblant de peur. À cet instant, malgré les hommes qui l’entourent, il n’est déjà plus de ce monde. Y a-t-il un jour appartenu d’ailleurs, lui qui a vécu le plus souvent dans ses marges les plus extrêmes ? Héroïque, fataliste ou inconscient, Terry est un paradoxe dont l’attitude surprend et bouleverse. La messe finie, il traverse la cour pour se rendre au greffe où l’attendent les fonctionnaires.
« À vos rangs ! » leur crie-t-il.
À l’intérieur, il demande à écrire à sa mère. Une lettre rapide et sobre où Terry, pour une fois, exprime quelques sentiments :
« Ma chère mère, je t’écris au dernier moment pour te dire de ne pas te faire de mauvais sang. Je serai courageux jusqu’à la fin. Embrasse pour moi Louise M. Embrasse bien mon bébé qui est là-bas, ainsi que les frères et les sœurs. »
Puis il rajoute :
« J’ai demandé pardon de mes fautes à Dieu. »
Un gardien lui tend un verre de rhum sucré. Terry le prend, le lève et s’adressant aux personnes présentes :
« À votre santé, messieurs ! »
Après avoir fumé une cigarette et adressé son salut au docteur de la prison, il demande à parler au procureur de la République :
« J’ai une grâce à vous demander, monsieur le procureur. Je désirerai que mes gardiens qui ont eu tant de bonté pour moi depuis que je suis en prison, m’accompagnent jusqu’à l’échafaud. »
Le procureur accepte. Terry sourit. Ses gardiens sont devenus ses anges. Les seuls hommes, les derniers aussi qui, dans son existence, lui ont peut-être manifesté un peu de condescendance et de chaleur.
Deibler pénètre à cet instant dans la salle du greffe pour signer le registre d’écrou. Terry regarde curieusement l’exécuteur et, se tournant vers ses gardiens, leur dit en riant :
« Il a un beau bouc, cet homme-là ! »
Avant d’ajouter :
« Je vais mourir, il faut bien mourir un jour ; peut-être mourez-vous avant huit jours, avant un mois, chacun son tour. La guillotine est à Rodez, que voulez-vous, on ne voit pas tous les jours une machine comme ça !
Il remercie également son avocat, maître Colomb, à qui il déclare « qu’il lui serrera la cuillère devant l’échafaud ».
L’heure est désormais venue de se préparer pour la toilette funèbre. Tandis qu’on lui lie les mains et les avant-bras derrière le dos, Deibler lui échancre largement sa chemise à hauteur du cou. Terry ne bronche pas. Sans faiblir, il monte dans le fourgon, accompagné de l’aumônier et de son défenseur. Arrivé sur le lieu du supplice, il descend courageusement les sept à huit marches de l’escalier de la voiture pour se livrer aux mains des bourreaux. Un remous secoue la foule. Puis des cris : « Le voilà » suivis d’une galopade furieuse. Deux ou trois pas encore et Terry se trouve face à la guillotine. Dans un dernier élan, il s’adresse à la foule :
« Salut ! Où sont les gardiens ? »
Mais il n’a pas le temps d’obtenir une réponse. Les aides l’ont déjà solidement empoigné. Projeté sur la planche à bascule, sa tête s’est engagé dans la lunette. Deibler fait jouer le déclic. En un éclair, le couperet tombe, claque dans le silence. La tragédie n’a duré que quelques secondes.
Le panier où a été déposé le corps de Terry est placé dans le fourgon mortuaire, encadré de gendarmes, qui part au trot de deux chevaux vers le cimetière Saint-Cyrice. Il est exactement 5 heures 14. Un pâle soleil germe à l’horizon tandis que la foule se disperse peu à peu en commentant l’exécution. Déjà, Anatole Deibler et ses aides ont nettoyé et démonté la guillotine. Il est 6 heures, l’opération est terminée.
Aux premiers jours de l’année 1911, Madeleine F. reçoit une carte postale de sa cousine de Rodez.
« Toute la famille se joint à moi pour te souhaiter une bonne et heureuse année. À bientôt de te voir ! Grosses bises ! »
Au dos, un homme est représenté enchaîné, entouré de trois gendarmes en uniforme de parade. Au bas, la mention porte : « Jean Théry, le satyre, Assassin d’Adrienne Pons. »
Quant à Deibler, il aurait déclaré que Terry était le condamné le plus courageux qu’il avait rencontré.
Le nom de Terry sera évoqué deux ans plus tard lors d’un fait divers qui s’était déroulé à Aurillac, dans le Cantal. Terry avait un frère de lait, Augustin Alexandron, qui possédait la manie du suicide. Cet Augustin avait aussi le sens du spectacle macabre. En 1907, il avait déjà tenté de mettre fin à ses jours en se tranchant la gorge, mais ses amis l’avait arraché à la mort. Ce n’était que partie remise. Le 17 juillet 1912, il dit adieu à sa propriétaire et prend congé de sa compagne. À travers les carreaux de la cuisine, elle le voit allumer une mèche qui sort de sa bouche. L’explosion est immédiate. Un horrible spectacle s’offre alors à ses yeux. « La tête, rapporte le quotidien régional, n’était plus qu’une chose informe déchiquetée. Selon toute vraisemblance, il dut s’introduire une cartouche de dynamite dans la bouche, et elle fit explosion. »
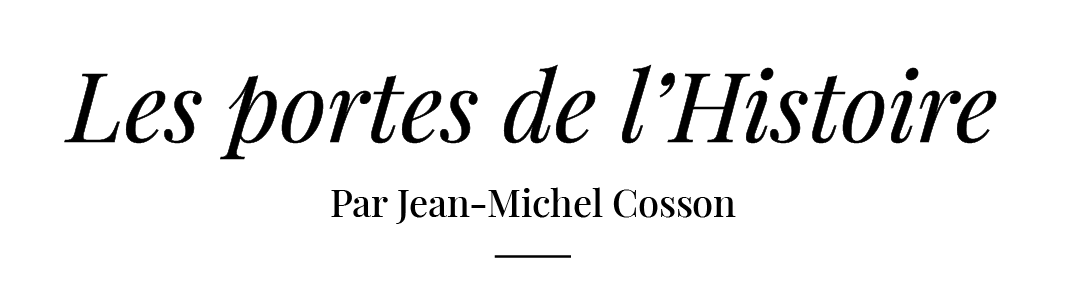
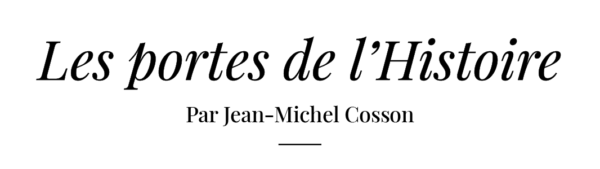
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !