RODEZ Le roman d’une ville (2)
Rue Séguy
La rue Séguy concerne seulement ses habitants. Oubliée du passant, leur regard entièrement capté par la masse tutélaire du clocher-cathédrale. A peine sert-elle de dérivatif pour qui, remontant la rue Frayssinous, veut rejoindre la rue de Bonald, évitant de fait la place de la Cité. Encore les édiles l’ont-ils déshabillée en accordant à saint Vincent, un moignon de rue à son extrémité. L’académicien, contemporain du siècle des Lumières, aurait pu être désappointé d’être ainsi dépouillé de quelques arpents si lui-même, à son corps défendant faut-il le préciser – il était mort depuis un siècle quand la municipalité ruthénoise l’honora de cette rue – n’avait rayé du plan urbain, la rue des Hebdomadiers, sans toutefois pouvoir l’effacer des mémoires. C’est que cette rue recèle une bien triste affaire. De celle qui, interminable, n’offre aux esprits que doute, mystère et imagination débordante. Dès lors, le passant n’y verra plus que des ombres, du sordide et du sang. Du fantastique aussi. Eugène Viala ne s’y est pas trompé. Son eau-forte dresse du lieu, clocher en arrière-plan, sa culpabilité, vouée à jamais à la vindicte. A la noirceur du crime.
Disparue en 1962 sous les coups des engins de chantier, la maison Bancal heurte l’histoire de la ville comme un drame sans fin.
Rue des Hebdomadiers. 1817. A quelques claquements d’ailes des pipistrelles de la cathédrale. Rue étroite. Sombre. Dépourvue d’un manteau de lumière. De jour et de nuit. Une voie pourtant pas plus mal famée que d’autres. Autrefois – c’est-à-dire avant que l’absolutisme tombe cul par-dessus tête – habitée par des prêtres assurant un service religieux hebdomadaire à la cathédrale. Désormais, quelques hôtels particuliers. De petits entrepôts. Surtout des maisons. Modestes. A deux étages. Tout au plus à trois. Au 605 de cette rue, la maison Vergnes. Propriétaire du lieu. Loueur sans vergogne. Jusqu’à la plus petite dépendance. Jusqu’au plus étroit cabinet. Mais après tout qui songerait différemment ! Un rez-de-chaussée. Deux étages. Un chien assis s’ouvrant sur le grenier. De quoi loger du monde et encaisser quelques mitrailles subsidiaires. Ainsi trouve-t-on au plus haut Antoine et Rose Palayret. Tous deux travailleurs de terre. C’est dire que le couple ne nage pas dans l’argent. Qu’une seule pièce suffit. Lit, table, chaises boiteuses. Vaisselles dépareillées. La pouillerie qui chaque jour leur mord les pieds. Au-dessous. Premier étage. Le couple Saavedra. Don Saavedra ! Visage froid de l’ancien alcalde de Léon qu’il se prétend avoir été. Réfugié espagnol arrivé en 1813 avec les troupes napoléoniennes. On imagine un parcours obscur. Fait de compromis. Peut-être d’allégeance. De collaboration. Respecté Don Saavedra pour son titre. Mais rien ne transpire hormis ce qu’il veut bien en dire. Et en espagnol, ce qui limite toute curiosité. Enfin, de l’autre côté du mur vit une femme seule, Marianne Ducros. Anonyme.
Tout en bas, les Bancal. Visez comme l’article est déjà péjoratif ! Soupçonneux ! Transgressant toute moralité ! Antoine Bancal. Maçon de son état. Journalier à l’occasion. Cinquantaine insignifiante. Sa femme, Catherine Burguière. Blanchisseuse. A voir son visage sur les lithographies du temps, un curieux sentiment de pitié et d’effroi nous saisit. Est-il possible de si grandes différences dans les traits ? Dans l’expression ? Qui font d’un visage sans attrait – front couvert, cheveux et sourcils châtain clair, nez pointu, visage ovale et maigre, yeux roux, bouche moyenne – le masque hideux d’une créature vouée au péché. Et donc au crime. Et donc à l’infamie.
Avec ça, une flopée de gosses ! Trois garçons en bas âge et deux filles. L’aînée, Marianne. 19 ans. Serveuse à l’occasion. Quelques fifrelins supplémentaires pour le foyer. Les trois gniards couchent au rez-de-chaussée. Même lit. Mêmes draps. Magdeleine (9 ans) et Marianne, au-dessus du couloir d’entrée. Second étage. Du moins quand la chambre n’est pas occupée. C’est qu’il faut vivre. Car plusieurs fois par semaine, la femme Bancal loue la chambre à quelques soldats flanqués de gourgandines. Alors on se serre comme un peu au rez-de-chaussée. Les mauvaises langues racontent que la petite Magdeleine et sa sœur serviraient parfois… Bref ! Il faut bien payer le loyer à ce fripon de Vergnes. Du moins jusqu’en juin. Car les Bancal songent à partir. Pour trouver moins cher. A quoi tient parfois d’être mis hors de l’histoire. D’éviter de sombrer dans l’abîme.
Une fois franchi le couloir d’entrée, une cour. Un puits au centre comme dans la plupart des maisons de la ville. En face une écurie, surmontée de deux pièces. L’une sert de chambre à Marie Bedos, fileuse. L’anonymat de la misère lui a appris la compassion. Elle loge la nuit dans son réduit une mendiante. Et puis, voisinant, Anne Benoit et Jean-Baptiste Collard. Ces deux-là vivent à la colle depuis deux ans. Elle : blanchisseuse. Un visage tout en rondeur. De la timidité dans son regard. A moins que ce ne soit de la tristesse. Lui : un gaillard qui n’a pas froid aux yeux. Ancien soldat au bataillon du train. Le genre protecteur sur la cicatrice frontale duquel Anne Benoit a planté son regard de midinette.
Et contigüe, confrontant le mur de l’écurie, la maison d’Antoine-Bernardin Fualdès.
Ce petit matin-là, donc. Tandis que Catherine Bancal puise l’eau au puit de la cour ; tandis que Jean-Baptiste Collard s’en va se louer à la journée dans les fermes voisines ; tandis que Don Saavedra, assis dans un fauteuil usagé, se réfugie dans ses souvenirs ibériques et qu’Anne Benoit chantonne, fenêtre de sa chambre ouverte, l’affaire Fualdès plane déjà sur la ville comme une réputation maudite.
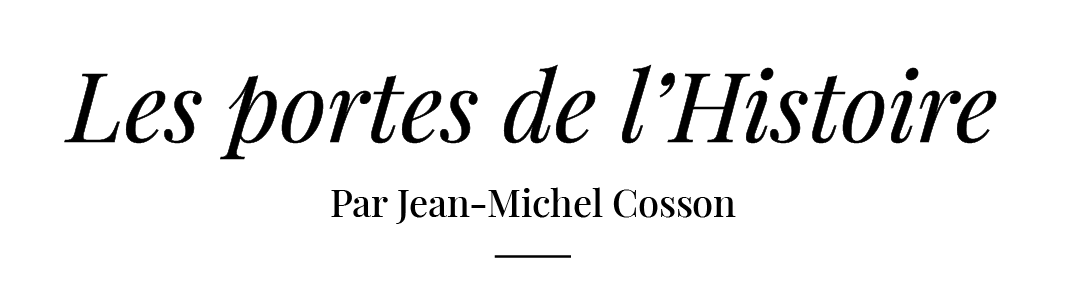
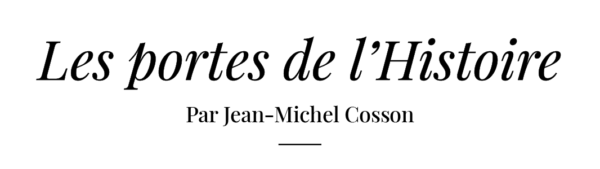
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !