Explorateurs aveyronnais (2)
Un Aveyronnais au Far West
Gissac, François d’Albis de, (Gissac, 1828 – 1897)
Né à Gissac dans le Sud-Aveyron le 29 septembre 1828, il est le fils aîné d’Alexandre de Gissac, ancien capitaine de dragons.
A vingt ans, on le retrouve chez les Jésuites de Brugelette, dans le Hainaut, qui lui dispensent des cours de philosophie ; en 1860, âgé alors de 32 ans, il épouse Marguerite de Puységur qui lui donne un fils unique, Pierre.
En 1863, il est admis comme membre de la Société française d’Archéologie et assiste à l’ouverture du Congrès de Rodez le 4 juin ; il y est qualifié de propriétaire à Gissac. On perd ensuite sa trace pendant dix-huit ans avant de le retrouver… dans le Kentucky, à Paris, petite ville du Comté de Bourbon, ayant été contraint de s’exiler définitivement aux Etats-Unis.
Il résidera successivement à Dauville, bourgade du même Etat, ensuite à Waco, au sud-Ouest de Dallas (Texas), où des découvertes archéologiques l’ont peut-être attiré, et enfin à Cairo sur le Mississipi, à l’extrême sud de l’Illinois.
François de Gissac sera toujours chaleureusement félicité par la Société des Lettres pour chacun de ses dons, demandant parfois certaines choses en échange comme des culots de cartouches pour son fusil !
Ainsi, grâce à son dévouement et à sa « curiosité encyclopédique », sans toutefois omettre son réseau d’amis, d’archéologues ou d’amateurs patiemment constitué sur place, le musée Fenaille sera doté de près de 900 pièces constituant sans doute « l’une des collections d’archéologie américaine les plus complètes et les plus prestigieuses en France ou même en Europe ! » selon l’archéologue ruthénois Lucien Dausse, précisant que celle-ci se compose essentiellement « d’armes et d’outils en pierre provenant du Bassin du Mississipi ou de la côte du Pacifique, magnifiques témoins d’une industrie très évoluée qui remonte bien au-delà de 1492 et souvent de plusieurs millénaires. »
Il est important de préciser que les conditions de vie de notre aveyronnais sont plutôt précaires ; vivant à l’auberge et ne disposant que du maigre revenu de son travail, il n’est pas en mesure, par exemple, d’acheter des livres.
Cela ne l’empêchera pas de prospecter villages ou nécropoles mis au jour par des travaux agricoles et d’y recueillir de nombreux objets anciens qu’il étudie et classe scrupuleusement.
Ses connaissances sur place lui permettront aussi d’enrichir sa collection. Ainsi pour acquérir d’un vieil épicier des silex préhistoriques manquants dont il veut doter la Société des Lettres, François de Gissac obtient qu’une lettre officielle de remerciements avec « un gros cachet rouge » soit adressée à ce brave commerçant.
Mais notre Aveyronnais mettra peu à peu un terme à ses envois face au « mercantilisme croissant des collectionneurs et surtout devant la préemption légitime des savants américains avec lesquels il conserve les meilleurs relations. »
« Les Peaux-Rouges ou Indiens de l’Amérique du Nord sont pénétrés d’un respect jaloux et superstitieux pour leurs noms de famille. Ils regardent ces noms comme un dépôt précieux et sacré, le conservant inconnu de tous, enveloppé du plus profond et impénétrable mystère, toujours ignoré, même des femmes et des enfants de la famille et révélé aux jeunes hommes seulement alors qu’ils sont reçus au nombre des guerriers de la tribu. Les Indiens croient que leur nom de famille est une part d’eux-mêmes et est identifié à leur personne et à leur race dont il est l’essence même. Si ce nom était connu, un ennemi pourrait l’insulter, le maudire ou bien le soumettre à quelque sortilège ; et ils en seraient inévitablement affectés, soit dans leur santé, soit dans leurs entreprises, soit même dans leur courage, ou bien encore dans leurs familles et dans leur prospérité. Les calamités les plus terribles ne manqueraient pas de fondre sur eux. Tandis que si leur nom reste inconnu et par conséquent à l’abri de toute attaque, de tout sortilège ou enchantement, ils peuvent aisément s’affranchir de toute mauvaise influence dirigée contre eux, au moyen des charmes ou des incantations prescrites par le sorcier de la tribu. Cependant comme il est nécessaire que chacun puisse être connu, distingué et désigné par quelque appellation particulière, l’usage a établi que tout individu à sa naissance recevrait un surnom qui remplacerait dans la pratique le vrai nom resté caché et secret. Lorsque un enfant vient de naître, le premier des témoins de sa naissance qui sort de la tente ou wigwam, ordinairement le père, prononce à haute voix des paroles désignant le premier objet qui frappe sa vue ou attire son attention. Ces paroles deviennent le surnom du nouveau-né, et par ce surnom seul il sera connu et désigné jusqu’à sa mort. Il suit de là que les Indiens portent des surnoms parfois très gracieux ou très poétiques, mais aussi très singuliers ou même ridicules. Voici quelques-uns de ces surnoms : Le Taureau assis, Pluie dans la face ; La queue mouchetée ; Fleur qui penche ; L’oiseau bleu qui gazouille, Graisse du dos du Buffle, etc.
Mais lorsque le guerrier au terme de sa vie sera reçu par le Grand-Esprit dans les grandes et giboyeuses prairies du monde supérieur et éternel dans lesquels il n’y a ni méchants enchanteurs à redouter, alors, mais alors seulement, le brave se revêtira de son vrai nom, le nom de sa race, conservé à travers les siècles, vierge de toute atteinte et pur de toute souillure. »
Un Aveyronnais au Congo
Guiral, Léon, (Espalion, 1858 – Libreville (Togo), 1885)
Après des études au lycée de Rodez, il travaille aux Magasins du Louvre à Paris. Attiré par les voyages et la zoologie, il s’engage dans la Marine et embarque pour l’expédition chargée de ravitailler les postes installés par Savorgnan de Brazza dans l’Ogoué. Durant son séjour de deux ans au Congo, où il rencontre l’explorateur Stanley, il collectionne les insectes avant de rentrer à Paris à cause de la maladie. En 1882, paraîtra dans Le Bulletin d’Espalion, son « Journal de Voyage ». Le Museum d’Histoire Naturelle reçoit sa collection de 912 sujets dont certains sont inconnus des scientifiques. Rétabli, le gouvernement le charge en 1884 d’une mission sur les côtes équatoriales françaises, avec son cousin Salesses, de Rodez. C’est en remontant le fleuve jusqu’au lac N’Jela qu’il meurt d’épuisement, le 25 novembre 1885.

« L’Européen qui se voit menacé pour la première fois par les démonstrations guerrières des Batékés, ne peut se défendre d’une certaine émotion ; mais en pareille circonstance, le sang-froid est la principale qualité qu’il faut montrer ; en en faisant preuve on peut se tirer d’un mauvais pas beaucoup plus sûrement que si l’on s’apprêtait à se servir de ses armes. » Bulletin d’Espalion (1882)
« Les Batékés sont en général grands et maigres ; la teinte noire de leur peau est extrêmement foncée. Leur physionomie indique ordinairement un caractère rusé et méchant, mais leurs traits présentent souvent une finesse et une pureté qu’on ne rencontre pas chez les peuples de l’Ogoué.
Leurs yeux, dont le blanc tranche doucement sur le noir intense de la peau, sont très vifs et très mobiles. Leur voix aiguë est un peu saccadé ; ils parlent avec une volubilité qui devient surtout remarquable dans les conversations animées et dans les discussions, une langue qui doit avoir de grands rapports avec celle des peuples du Haut-Ogoué.
Les femmes sont presque toutes bien faites de corps et jolies de figure… mais ce qui est bien fâcheux, c’est que les dures nécessités de leur condition s’ajoutent à d’autres causes pour leur donner de bonne heure les caractères physiques d’une vieillesse prématurée. » Bulletin d’Espalion (1883)
Un Aveyronnais le long du Nil
Vayssière, Jean-Alexandre, (Espalion, 1817-1860)
Dans les récits de Chateaubriand et des grands explorateurs, il trouve la source de sa passion qui l’entraîne d’abord vers Paris puis en Afrique où il accomplit son service militaire et s’initie à la langue et aux mœurs des Arabes. Libéré de ses obligations, il rejoint l’Egypte et fait la connaissance d’un aventurier, M. Arnaud, passionné de chasse et fumeur invétéré d’opium. À tous les deux, ils décident d’explorer la vallée du Haut Nil et l’Abyssinie, allant de ville en ville et de campement en campement ; Arnaud tombé malade, Vayssière profite de l’hospitalité d’un brick français pour revenir à Djeddah puis, via l’Egypte, en France où il rapporte « une prodigieuse collection de quadrupèdes, d’oiseaux, de végétaux et dans chaque genre des espèces nouvelles ». Revenu en Egypte, il s’engage dans un nouveau périple, chassant pour son propre compte de 1858 à 1859 et descendant le Nil, chargé d’ivoire et de pelleteries destinées au musée national. Dès lors, on perd tout contact. Sans doute, a-t-il été tué en 1860 alors qu’il descendait le Nil. Lors de son retour en France en 1849, Vayssière s’était lié d’amitié avec Alexandre Dumas père. L’année suivante, il publia dans la Revue des Deux Mondes ses « Scènes de voyages dans l’Hedjaz et l’Abyssinie » puis dans Le Moniteur Universel en novembre 1853, un récit de ses voyages « En Abyssinie ».
« Vayssière avait toutes les qualités du méridional ; il était vif, ardent, spirituel, pittoresque, courageux jusqu’à la témérité, et ce qui le liait avec moi du lien indissoluble de la sympathie, chasseur enragé… » Alexandre Dumas
« Le 18 novembre 1853, une bande de Schellouks indigènes appartenant à une tribu pillarde se présente. Ils sont vêtus de pagnes, de peaux d’antilopes, armés de lances. Ils sont en tournée de chasse ; ils se montrent bienveillants et fournissent d’excellentes indications. Un peu plus loin, le même jour, on rencontre une autre bande de la même tribu qui se livre à la pêche, et chasse l’hippopotame et le crocodile. La navigation est difficile à travers d’immenses bancs de roseaux de 15 à 20 pieds de haut. La barque fait jaillir d’innombrables étincelles ; ce sont des lucioles semblables à celles de l’Europe.
Le 25 novembre, navigation à travers les marais fangeux couverts de hautes herbes d’ambok, de grandes graminées sur lesquelles voltigent les libellules et les papillons. Le fleuve se développe ici sur une très grande largeur. Au loin, sur la terre ferme, on aperçoit d’énormes arbres, tamarissiers, minoès, le cacarmout des arabes, couverts de fleurs semblables à celles des pommiers de France ; des convolvulus, des cucurbitacées dont les troncs gigantesques ressemblent à des colonnes de temple. La grue royale dont les nids sont posés sur les hautes branches, jette au vent du soir un cri éclatant. Le paysage est saisissant de beauté. » Bulletin d’Espalion. (1923)
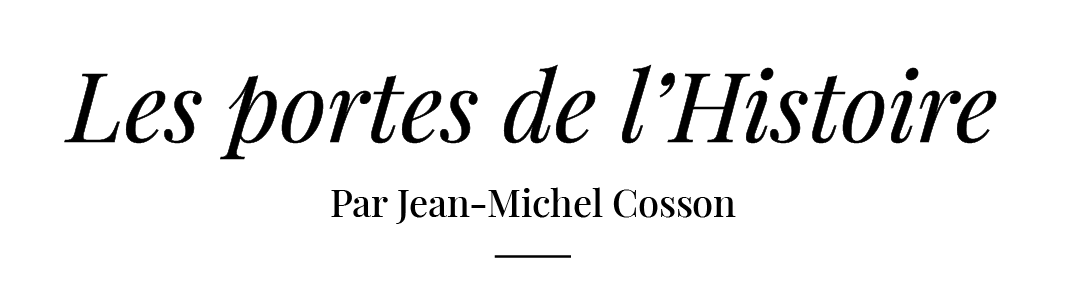
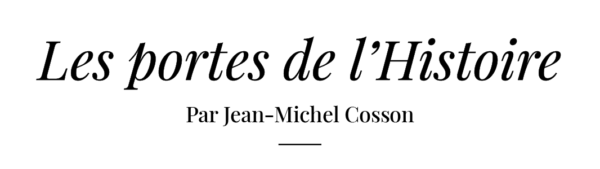
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !